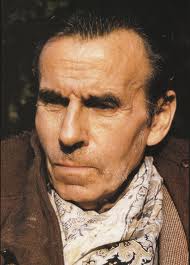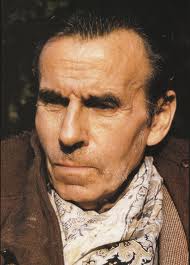|
SES GUERRES
" Bas les cœurs "
27 octobre 1914 - Louis Destouches se porte volontaire pour franchir les lignes ennemies. Celui qui deviendra Céline découvre " d'un coup la guerre tout entière ".
On lui a donné une croix étoilée, une belle médaille et il a même eu droit à une page dans L'Illustré national ! Il devrait en être fier, le maréchal des logis Louis Destouches. Sur son lit d'hôpital il a envie de pleurer. Comme un môme. Il n'a que vingt ans. Et ce n'est pas une gosseline gironde qui l'a déniaisé, mais la guerre ! Comme ça, d'un coup, d'un seul, sans tendresse, ni câlins. Il avait des illusions. Avant. Il suffit de voir son portrait officiel quand il est devenu maréchal des logis. Faraud, il était. Et comment encore avec sa moustache naissante !
 Mais les illusions, il les a vite perdues. Il était " puceau de l'horreur ". Parce que l'horreur, on ne l'imagine pas. Mais quand on l'a vue, on ne Mais les illusions, il les a vite perdues. Il était " puceau de l'horreur ". Parce que l'horreur, on ne l'imagine pas. Mais quand on l'a vue, on ne peut plus l'oublier. Encore moins la décrire. Du moins, lui, il ne peut pas. Il y a trop de bruit dans sa tête. peut plus l'oublier. Encore moins la décrire. Du moins, lui, il ne peut pas. Il y a trop de bruit dans sa tête.
Au Val-de-Grâce, on le soigne pour son bras - Louis n'a pas voulu être anesthésié quand le chirurgien a dit qu'il allait retirer la balle, de crainte qu'on ne l'ampute en catimini -, mais c'est son crâne qui souffre. Pour le bras, il pourrait supporter. Mais quand les fusants, les shrapnels et les gros noirs vrombissent à ses oreilles, Louis voudrait hurler. On ne se plaint pas quand on est un héros. Un décoré. Louis ravale ses larmes.
C'était le 27 octobre. Ca faisait près de trois mois qu'il était au front. A l'est, puis dans les Flandres. Du côté de Poelkapelle. On se tirait dessus avec ceux d'en face, sans se voir, sans se connaître, presque à bout portant. Des morts, il y en avait partout. Et des sans-bras, des sans-jambes. Des qui tenaient leurs tripes. Souvent on avait tellement peur qu'on avait même peur de la peur. Mais on y allait. On en redemandait presque. Pour ne pas penser. Ca , c'est le pire. Penser !
Avant, quand il avait fait son service dans les cuirassiers, Louis croyait que la guerre ce serait comme à la parade du mois de juillet. Sabre au clair. Crinière au vent. Et la foule qui applaudit en agitant des petits drapeaux. Eh bien non ! La guerre c'est une vraie vacherie, une boucherie dans des champs qui " bavent l'eau sale ". On patauge. On retraite. On perd cent mètres. On les regagne. Ca sert à quoi de perdre ou de gagner cent mètres ?
N'empêche, le 27 octobre, alors qu'on ne lui demandait rien, Louis s'est porté volontaire. Les officiers de liaison, eux, ne voulaient pas y aller. Le feu est trop nourri, disaient-ils. Mais Louis s'est avancé. Pourquoi ? Allez savoir ! Pour se montrer un homme peut-être. Alors, voilà, il est parti dans la boue. A cheval. Avec les ordres à transmettre pour la bataille. Sous la pluie. En plein orage de feu. Tout d'abord il y a eu l'explosion d'un obus. Louis a été projeté et sa tête a heurté un arbre. Puis il a senti une brûlure au bras. Mais peut-être confond-il. La balle l'a peut-être frappé avant que l'obus ne le sonne. De toute façon, ça change quoi ?
Quand il s'est réveillé, Louis était dans une ambulance de campagne, près d'Ypres. Après il a été transporté à l'hôpital auxiliaire d'Hazebrouck et de là au Val-de-Grâce.
Destouches regarde sa croix, sa médaille et la page de L'Illustré national. Il est représenté à cheval. Au grand galop. En grand uniforme de cuirassier. Des bobards ! Pourquoi en racontent-ils à l'arrière ? Pour le moral ? Louis, ça le démoraliserait plutôt cette comédie. Et toutes les grimaces qu'ils font à l'arrière ? Le cœur sur la main. A chanter des chants patriotiques. A feindre de penser aux petits gars. A se priver de dessert pour le prouver.
Ce qui le dégoûte aussi, c'est que dans les services d'observation où il a été placé, on commence à le regarder de travers quand il se plaint du bruit dans sa tête. Comme s'il simulait ! Comme s'il voulait tirer au flanc. Il voudrait les y voir.
Il voudrait les y voir tous les planqués entrer dans des villages calcinés ! Sous le tac-tac-tac des mitrailleuses. Ou les entendre chanter quand un cavalier a perdu sa tête. Ca éclabousse du sang de partout, un cavalier sans tête. Ca vous poursuit le jour et la nuit. Surtout la nuit. On s'imagine soi-même. Et on a beau savoir qu'un mort, avec ou sans tête, c'est un mort. Qu'il ne sent plus rien. On se met à trembler. Sangloter. Comme un môme. Irina.de Chikoff.
(Le Figaro hors-série, Ceux de 14, Les écrivains dans la Grande Guerre, Réédition du n° 79 paru en juin 2013).
*********
LETTRE A SES PARENTS
Argonne, vers le 10 septembre 1914 (Annoncé comme partiellement inédit) :
Chers parents,
Je reçois à l’ instant 3 cartes et une lettre de vous. J’ai mis le papier de maman dans ma poche mais en général les blessures sont peu grave [sic] ou mortelles, il n’y a guère d’alternative. La lutte s’engage formidable, jamais je n’ai vu et verrai tant d’horreur, nous nous promenons le long de ce spectacle presque inconscients par l’ habitude du danger et surtout par la fatigue écrasante que nous subissons depuis un mois. Il se fait avant la conscience une espèce de voile. Nous dormons à peine 3 heures par nuit et marchons plutôt comme des automates mus par la volonté instinctive de vaincre ou de mourir. Pas de nouveau sur le champ de bataille. Presque sur la même ligne de feu depuis 3 jours. Les morts sont remplacés continuellement par les vivants à tel point qu’ ils forment des monticules que l’on brûle et qu’ à certains endroits on peut traverser la Meuse à pied ferme sur les corps allemands de ceux qui tentèrent de passer et que notre artillerie engloutit sans se lasser. La bataille laisse l’impression d’une vaste fournaise où s’engloutissent les forces vives de deux nations et où la moins fourbue des deux restera la maîtresse.
Envoyez plutôt un mandat tous les 8 jours. Vos lettres recommandées elles arrivent. Et toujours des cartes, cela va vite. Votre fils qui vous embr[asse]. Et du courage il en faut beaucoup.
Dest[ouches].
[Au recto :]
Nous n’avons pas vu de réservistes, ils jouent à la guerre dans le parc de Rambouillet.
Dites bonjour pour moi à tout le monde, et bien que les Allemands prétendent être à Paris sous 8 jours. Ce n’est que sur nos corps qu’ ils passeront, mais nous passerons plutôt sur les leurs. Nous avons toute confiance en Joffre.
(Le Petit Célinien, 30 novembre 2013).
*********
L'ORDRE DANS BERLIN APRES LES BOMBES...
... Cherchons un hôtel ! cette ville a déjà bien souffert... que de trous, et de chaussées soulevées !... drôle, on n'entend pas d'avions... ils s'intéressent plus à Berlin ?... je comprenais pas, mais peu à peu j'ai saisi... c'était une ville plus qu'en décors... des rues entières de façades, tous les intérieurs croulés, sombrés dans les trous... pas tout, mais presque... il paraît à Hiroshima c'est beaucoup plus propre, net, tondu... le ménage des bombardements est une science aussi, elle n'était pas encore au point... là les deux côtés de la rue faisaient encore illusion... volets clos... aussi ce qu'était assez curieux c'est que sur chaque trottoir, tous les décombres, poutres, tuiles, cheminées, étaient amoncelés, impeccable, pas en tas n'importe comment, chaque maison avait ses débris devant sa porte, à la hauteur d'un, deux étages... et des débris numérotés !... que demain la guerre aille finir, subit... il leur faudrait pas huit jours pour remettre tout en place... Hiroshima ils ne pourraient plus, le progrès a ses mauvais côtés... là Berlin, huit jours, ils remettaient tout debout !... point... là les deux côtés de la rue faisaient encore illusion... volets clos... aussi ce qu'était assez curieux c'est que sur chaque trottoir, tous les décombres, poutres, tuiles, cheminées, étaient amoncelés, impeccable, pas en tas n'importe comment, chaque maison avait ses débris devant sa porte, à la hauteur d'un, deux étages... et des débris numérotés !... que demain la guerre aille finir, subit... il leur faudrait pas huit jours pour remettre tout en place... Hiroshima ils ne pourraient plus, le progrès a ses mauvais côtés... là Berlin, huit jours, ils remettaient tout debout !...
Les poutres, les gouttières, chaque brique, déjà repérées par numéro, peints jaune et rouge... là vous voyez un peuple s'il a l'ordre inné... la maison bien morte, qu'un cratère, tous ses boyaux, tuyaux hors, la peau, le cœur, les os, mais tout son dedans n'empêche en ordre, bien agencé, sur le trottoir... comme l'animal aux abattoirs, un coup de baguette, hop ! vous rattraperait tous ses viscères ! hop !... se remettrait à galoper !
Paris aurait été détruit vous voyez un peu les équipes à la reconstruction !... ce qu'elles feraient des briques, poutres, gouttières !... peut-être deux, trois barricades ?... encore !... là ce triste Berlin, je voyais dabs, daronnes, dans mes prix, et même plus vioques, dans les soixante-dix, quatre-vingts... et même des aveugles... absolument au boulot... à bien tout ramener au trottoir, empiler devant chaque façade, numéroter... les briques, ici ! tuiles jaunes, par là !... éclats de vitre dans un trou, tout !... pas de laisser-aller !... pluie, soleil, ou neige Berlin a jamais fait rire, personne ! un ciel que rien ne peut égayer, jamais... déjà à partir de Nancy, vous avez plus rien à attendre...
(Nord, Folio, 1991, p. 54).
*********
LE " VOYAGE " DE CELINE DU CÔTÉ DE COMINES
Les habitants de Comines (petite bourgade wallonne, près d'Ypres) savent-ils qu'un des grands écrivains de ce siècle a séjourné dans leur région en 1914 ? Et que ce séjour, pourtant bref, lui inspira quelques pages de son roman le plus fameux, Voyage au bout de la nuit ?
Dans quelles circonstances Louis-Ferdinand Céline, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fut-il conduit jusque sur les bords de la Lys en octobre 1914 ? C'est ce que relate Francis De Simpel dans le tome XXIII des Mémoires de la société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, une publication dont chaque livraison annuelle est attendue avec impatience par tous les Cominois passionnés d'histoire locale.
 Mais revenons au " voyageur ". Le dimanche 4 octobre 1914, alors que Français et Allemands se font face dans le Nord, débarque du train, à Armentières, la 6ème brigade de cuirassiers français. Parmi les hommes du 2ème escadron du 12ème régiment, le maréchal des logis Louis Destouches, dont personne sans doute, y compris lui-même, n'imagine qu'il deviendra vingt ans plus tard, sous le nom de Céline, un des romanciers français les plus célèbres. La mission du 12ème " cuir " est de tenir les ponts sur la Lys à Houplines et Frelinghien. Mais revenons au " voyageur ". Le dimanche 4 octobre 1914, alors que Français et Allemands se font face dans le Nord, débarque du train, à Armentières, la 6ème brigade de cuirassiers français. Parmi les hommes du 2ème escadron du 12ème régiment, le maréchal des logis Louis Destouches, dont personne sans doute, y compris lui-même, n'imagine qu'il deviendra vingt ans plus tard, sous le nom de Céline, un des romanciers français les plus célèbres. La mission du 12ème " cuir " est de tenir les ponts sur la Lys à Houplines et Frelinghien.
Ce qu'il ne fera pas. Dès le lendemain et les jours suivants, les troupes allemandes, enfonçant les positions françaises, occupent la vallée de la Lys. Petit épisode de la " Grande Guerre " qui faillit pourtant bien être fatal au maréchal des logis Destouches : au retour d'une mission de reconnaissance sur la rive gauche de la Lys, dans les bois de Ploegsteert, un trompette est tué à côté de lui et son lieutenant s'affale sur sa monture, atteint à la cuisse. Destouches sauve l'officier en le ramenant dans les lignes françaises, ficelé sur son cheval.
Voilà pour les évènements vus par l'historien. Que deviennent-ils sous la plume de l'écrivain Céline ? Un étrange et sinistre... voyage au bout de la nuit. Chargé d'une mission de reconnaissance vers Noirceur-sur-la-Lys, " ville de tisserands " (Comines-France selon Francis De Simpel), le brigadier Bardamu part seul, la nuit. Traversant un village, il aperçoit une lueur au-dessus d'une porte. Il cogne, insiste, cogne encore, jusqu'à ce qu'une femme lui ouvre.
On l'informe que les dragons allemands sont passés tantôt : ils ont brûlé une maison près de la mairie puis ici ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre... Comme il jouait sur le Pont Rouge, en les regardant passer... Tenez ! qu'elle me montra... il est là...
Quel rapport avec la réalité ? Le Pont Rouge existe vraiment à Warneton. Quant à l'enfant, un témoin rapporte qu'un adolescent a été transpercé d'un coup de lance par Uhlan, le 5 octobre 1914, près de Deulémont...
Poursuivant vers Noirceur, Bardamu rencontre un déserteur : J'en ai assez, moi, qu'il répétait, je vais aller me faire paumer par les Boches. Puis à Noirceur, c'est la rencontre avec le maire, " un homme épais et barbu " (Désiré Ducarin, maire de Comines-France à l'époque ?)
Le récit de Céline mélange donc des éléments réels à d'autres fictifs ou transposés. Une conclusion s'impose cependant, estime Francis De Simpel : Louis-Ferdinand Céline avait conservé un souvenir assez précis du passage du maréchal des logis Destouches, dans la vallée de la Lys, en octobre 1914.
(Jacky Legrain, Francis De Simpel, " L'écrivain Louis-Ferdinand Céline et la vallée de la Lys, au début d'octobre 1914, in BC n° 140, mai 1994, p. 17).
*********
CARTE de CORRESPONDANCE MILITAIRE à ses PARENTS
[Argonne, vers le 10 septembre 1914.]
J'ai mis le papier de maman dans ma poche mais en général les blessures sont peu graves ou mortelles, il n'y a guère d'alternative.
La lutte s'engage formidable, jamais je n'ai vu et verrai tant d'horreur, nous nous promenons le long de ce spectacle presque inconscients par l'habitude du danger et surtout par la fatigue écrasante que nous subissons depuis un mois.
Il se fait avant la conscience une espèce de voile. Nous dormons à peine trois heures par nuit et marchons plutôt comme des automates mus par la volonté instinctive de vaincre ou de mourir.
Pas de nouveau sur le champ de bataille. Presque sur la même ligne de feu depuis 3 jours. Les morts sont remplacés continuellement par les vivants à tel point qu'ils forment des monticules que l'on brûle et qu'à certains endroits on peut traverser la Meuse à pied ferme sur les corps allemands de ceux qui tentèrent de passer et que notre artillerie engloutit sans se lasser.
La bataille laisse l'impression d'une vaste fournaise où s'engloutissent les forces vives de deux nations et où la moins fourbue des deux restera la maîtresse...
(Lettres, 14-15, Bibliothèque de la Pléiade, 19 octobre 2009, p. 104).
LE CAPITAINE SCHNEIDER à FERNAND DESTOUCHES
près d'Ypres, le 30 octobre 1914.
Cher Monsieur, il se confirme que la blessure de votre fils que malheureusement je n'ai pu voir moi-même ne serait pas grave. Il a été atteint d'une balle dans les circonstances suivantes : le 27 courant, chargé avec quelques cuirassiers du régiment d'établir la liaison entre des éléments d'infanterie et le commandement, à l'attaque de Poëlkapelle, traversant à plusieurs reprises des zones les plus dangereuses, il a été, ce jour-là à 18 h frappé d'une balle au bras.
Vous pouvez rassurer madame Destouches, cette blessure n'est, paraît-il, pas grave, il n'est même pas question, je crois, de fracture. Mais ce que je tiens surtout à vous redire, c'est combien le courage de votre fils a été admirable. Depuis le début de la guerre on le trouve d'ailleurs partout où il y a du danger, c'est son bonheur, il y est plein d'entrain et d'énergie !
Le 27, il marche sans compter, même quand ce n'est pas son tour, sous un feu formidable qui depuis quatre jours est un roulement de tonnerre ininterrompu. Fusillade, mitrailleuses, obus, rien ne l'arrête, et au poste de Commandement du général de Division où j'étais, le Commandant de l'Infanterie a rendu compte que ces cuirassiers s'étaient conduits comme des héros ! Ce sont les termes que le colonel a reproduits en citant votre fils à l'ordre du régiment, en faisant l'éloge de sa belle conduite. Je ne sais encore où il aura été évacué, je vous tiendrai au courant de ce que je saurai, il vous écrira sans doute lui-même prochainement.
Je vous adresse avec mes compliments et mes voeux pour une guérison rapide, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Capitaine Schneider 12e Cuirassier.
(Lettres, 14-37 b, La Pléiade, 19 octobre 2009, p. 119).
*********
FOUDRES D'ESCAMPETTE...
Si c'était par la force des mots on serait sûrement Rois du Monde. Personne pourrait nous surpasser question de gueule et d'assurance. Champion du monde en forfanterie, ahuris de publicité, de fatuité stupéfiante, Hercules aux jactances.
Pour le solide : la Maginot ! le Répondant : le Génie de la Race ! Cocorico ! Cocorico ! Le vin flamboye ! On est pas saouls mais on est sûrs ! En file par quatre ! Et que ça recommence !
Tout de même y a une grosse différence entre 14 et aujourd'hui. L'homme il était encore nature, à présent c'est un tout retors. Le troufion à moustagache il y allait " comptant bon argent " maintenant il est roué comme potence, rusé pitre et sournois et vache, il bluffe, il envoie des défis, il emmerde la terre, il installe, mais pour raquer il est plus là. Il a plus l'âme en face des trous. C'est un ventriloque, c'est du vent. C'est un escroc, comme tout le monde. Il est crapule et de naissance, c'est le tartufe prolétarien, la plus pire espèce dégueulasse, le fruit de la civilisation. Il joue le pauvre damné, il l'est plus, il est putain et meneur, donneur fainéant, hypocrite. Le frère suçon du bourgeois.
Il se goure de toutes les arnaques, on lui a fait la théorie, il sait pas encore les détails, mais il sait que tout est pourri, qu'il a pas besoin de se tâter, qu'il sera jamais assez canaille pour damer là-dessus le dirigeant, qu'il aura toujours du retard pour se farcir après tant d'autres. C'est de l'opportunisme de voyou, du " tout prendre " et plus rien donner. L'anarchisme à la petite semaine. C'est de la bonne friponnerie moyenne, celle qu'envoye les autres à la guerre, qui fait reculer les bataillons, qui fait du nombril le centre du monde, la retraite des vieux une rigolade, l'ypérite pour tous un bienfait.
Au nom de quoi il se ferait buter le soldat des batailles ? Il veut bien faire le Jacques encore, il a du goût pour la scène, les bravos du cirque, comme tous les dégénérés, mais pour mourir, alors pardon ! il se refuse absolument ! C'est pas dans le contrat d'affranchi. Monsieur se barre à vitesse folle. Que le théâtre brûle il s'en balotte ! C'est pas son business !
Et puis d'abord c'est général, les chefs veulent pas mourir non plus. Vous remarquerez que les grands despotes, les présidents, les forts ténors, les rois, les princesses, tout ça se déhotte, fonce au couvert, dès que l'aventure tourne aigre, vacille... Foudres d'escampette. Pas un qui paye de sa personne. Sauver la viande c'est le suprême serre. Pendant les plus farouches exhortes, pendant qu'ils affolent au massacre, ils quittent pas leur " Shell " du regard. C'est leur vraie Madone ! Pas si cul de se faire étendre !
(Les Beaux draps, Ecrits polémiques, Editions 8, Août 2017, p. 517).
*********
" Des canons ! des hommes ! des munitions ! " qu'ils exigeaient sans jamais en sembler las, les patriotes. Il paraît qu'on ne pouvait plus dormir tant que la pauvre Belgique et l'innocente petite Alsace n'auraient pas été arrachées au joug germanique.
C'était une obsession qui empêchait, nous affirmait-on, les meilleurs d'entre nous de respirer, de manger, de copuler. Ça n'avait pas l'air tout de même de les empêcher de faire des affaires les survivants. Le moral était bon à l'arrière, on pouvait le dire. "
(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1968, p.88).
*********
LES " JOURNEES "...
Nous nous retrouvions le plus souvent dans un café d'à côté. Les blessés de plus en plus nombreux clopinaient à travers les rues, souvent débraillés. A leur bénéfice il s'organisait des quêtes, " Journées " pour ceux-ci, pour ceux-là, et surtout pour les organisateurs des " Journées ".
Mentir, baiser, mourir. Il venait d'être défendu d'entreprendre autre chose. On mentait avec rage au-delà de l'imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l'absurde, dans les journaux, sur les affiches, à pied, à cheval, en voiture.
Tout le monde s'y était mis. C'est à qui mentirait plus énormément que l'autre. Bientôt, il n'y eut plus de vérité dans la ville.
(Voyage au bout de la nuit, Folio, Gallimard 1968, p. 59).
*********
L'AVENIR POUR LES LÂCHES...
Tout ce monde pleurait d'abondance, dans le parloir, sur le soir surtout. L'impuissance du monde dans la guerre venait pleurer là, quand les femmes et les petits s'en allaient, par le couloir blafard de gaz, visites finies, en traînant les pieds. Un grand troupeau de pleurnicheurs ils formaient, rien que ça, dégoûtants.
Pour Lola, venir me voir dans cette sorte de prison, c'était encore une aventure. Nous deux, nous ne pleurions pas. Nous n'avions nulle part, nous, où prendre des larmes.
- Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand ? me demande-t-elle un jeudi.
- Je le suis ! avouai-je.
- Alors, ils vont vous soigner ici ?
 - On ne soigne pas la peur, Lola. - On ne soigne pas la peur, Lola.
- Vous avez donc peur tant que ça ?
- Et plus que ça encore, Lola, si peur, voyez-vous, que si je meurs de ma mort à moi, plus tard, je ne veux surtout pas qu'on me brûle ! Je voudrais qu'on me laisse en terre, pourrir au cimetière, tranquillement, là, prêt à revivre peut-être... Sait-on jamais ! Tandis que si on me brûlait en cendres, Lola, comprenez-vous, ça serait fini, bien fini... Un squelette, malgré tout, ça ressemble encore un peu à un homme... C'est toujours plus prêt à revivre que des cendres... Des cendres c'est fini !... Qu'en dites-vous ?... Alors, n'est-ce pas, la guerre...
- Oh ! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand ! Vous êtes répugnant comme un rat...
- Oui, tout à fait lâche, Lola, je refuse la guerre et tout ce qu'i y a dedans... Je ne la déplore pas moi... Je ne me résigne pas moi... Je ne pleurniche pas dessus moi... Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils neuf cent quatre-vingt-quinze millions et moi tout seul, c'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux : je ne veux plus mourir.
- Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand ! Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur Patrie est en danger...
- Alors vivent les fous et les lâches ! Ou plutôt survivent les fous et les lâches ! Vous souvenez-vous d'un seul nom par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de Cent ans ?... Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms ?... Non, n'est-ce pas ?... Vous n'avez jamais cherché ? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papiers devant nous, que votre crotte du matin... Voyez donc bien qu'ils sont morts pour rien, Lola ! Pour absolument rien du tout, ces crétins ! Je vous l'affirme ! La preuve est faite ! Il n'y a que la vie qui compte. Dans dix mille ans d'ici, je vous fais le pari que cette guerre, si remarquable qu'elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée...
A peine si une douzaine d'érudits se chamailleront encore par-ci, par-là, à son occasion et à propos des dates des principales hécatombes dont elle fut illustrée... C'est tout ce que les hommes ont réussi jusqu'ici à trouver de mémorables au sujet les uns des autres à quelques siècles, à quelques années et même à quelques heures de distance... Je ne crois pas à l'avenir, Lola...
Lorsqu'elle découvrit à quel point j'étais devenu fanfaron de mon honteux état, elle cessa de me trouver pitoyable le moins du monde... Méprisable elle me jugea, définitivement.
Elle résolut de me quitter sur-le-champ. C'en était trop. En la reconduisant jusqu'au portillon de notre hospice ce soir-là, elle ne m'embrassa pas. Décidément, il lui était impossible d'admettre qu'un condamné à mort n'ait pas en même temps reçu la vocation. Quand je lui demandai des nouvelles de nos crèpes, elle ne me répondit pas non plus.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de Poche, 1968, p.69).
*********
ASSAUT GAGNANT.
Après un repos, on est remonté à cheval, quelques semaines plus tard, et on est reparti vers le Nord. Le froid lui aussi vint avec nous . Le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rencontrait guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs, par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s'en allait plus loin dès qu'on les apercevait. A chaque rencontre, deux ou trois cavaliers y restaient, tantôt à eux, tantôt à nous. Et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient à vide et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à troussequins bizarres, et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du Jour de l'an. C'est nos chevaux qu'ils venaient rejoindre, amis tout de suite. Bien de la chance ! C'est pas nous qu'on aurait pu en faire autant ! frais comme ceux des portefeuilles du Jour de l'an. C'est nos chevaux qu'ils venaient rejoindre, amis tout de suite. Bien de la chance ! C'est pas nous qu'on aurait pu en faire autant !
Un matin, en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Saint-Engence invitait les autres officiers à constater qu'il ne leur racontait pas des blagues. " J'en ai sabré deux ! " assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c'était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça.
- Il a été épatant ! Bravo, Sainte-Engence !... Si vous l'aviez vu, messieurs ! Quel assaut ! l'appuyait le capitaine Ortolan.
C'était dans l'escadron d'Ortolan que ça venait de se passer.
- Je n'ai rien perdu de l'affaire ! Je n'en étais pas loin ! Un coup de pointe au cou en avant et à droite !... Toc ! Le premier tombe !... Une autre pointe en pleine poitrine !... A gauche ! Traversez ! Une véritable parade de concours, messieurs !... Encore bravo, Sainte-Engence ! Deux lanciers ! A un kilomètre d'ici ! Les deux gaillards y sont encore ! En pleins labours ! La guerre est finie pour eux, hein, Sainte-Engence ?... Quel coup double ! Ils ont dû se vider comme des lapins !
Le lieutenant de Sainte-Engence, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. A présent qu'Ortolan s'était porté garant de l'exploit, il était rassuré et il prenait du large, il ramenait sa jument au sec en la faisant tourner lentement en cercle autour de l'escadron rassemblé comme s'il se fût agi des suites d'une épreuve de haies.
- Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance et du même côté ! Tout de suite ! - s'affairait le capitaine Ortolan décidément excité. - Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d'autres derrière... Tenez, vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos quatre hommes !
C'est à moi qu'il s'adressait le capitaine.
- Et quand ils vous tireront dessus, et bien tâchez de les repérer et venez me dire tout de suite où ils sont ! Ce doit être des Brandebourgeois !...
(Voyage au bout de la nuit, Livre de Poche, 1968, p. 36).
*********
PAS DEFENDUE LA GUERRE !
Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir, je l'ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer.
Ce colonel, c'était donc un monstre ! A présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi s'arrêteraient-ils ? Jamais je  n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses.
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique.
On est puceau de l'Horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? A présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu... Ça venait des profondeurs et c'était arrivé.
Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination ? On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise ? Abominable erreur ? Maldonne ? Qu'on s'était trompé ? Que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats ! Mais non ! " Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie ! " Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes, par un agent de liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là ! Mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus.
Donc pas d'erreur ? Ce qu'on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu ! Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre !... Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre le charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules.
(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1968, p.19).
*********
LA GUERRE.
La guerre est présente dans toute la production de Céline. Les personnages évoluent la plupart du temps d'un bombardement à l'autre, ou alors sont habités par la peur : Bardamu dans la boue sanglante de 1914, Céline sous les bombes à Orléans ou à Paris dans Féerie pour une autre fois, Céline encore dans l'Allemagne en feu de D'un château l'autre, Nord et Rigodon. Et Mort à crédit, le roman de l'avant-guerre, de l'enfance de Ferdinand, est tout de même ponctué d'explosions, celle de l'automobile de Courtial qui volatilise la jeune institutrice, celle du coup de fusil qui éclate la tête de Courtial.
Dès le séjour africain et dans les lettres à Simone Saintu, Louis-Destouches profite de toutes les occasions pour évoquer la guerre : en août 1916, alors que la jeune fille lui parle d'une offensive sur le front, le futur écrivain note : " Pourtant chaque fois que j'entends parler d'offensive... je me représente un soldat quel qu'il soit, mort, tué, sanglant, râlant, dans la boue rouge. " (Lettre de Campo, Cameroun, 22 août 1916).
Dans la correspondance avec Elie Faure ou avec Erika Irrgang et Evelyne Pollet, les années 1914-1917 sont volontiers rappelées ; en 1947, lorsqu'il écrit à la femme d'Albert Milon qui vient de mourir, Céline note : " Il emporte avec lui une bonne moitié de nos plus chers souvenirs communs, de nos plus épiques épreuves... Il emporte aussi nos pauvres espoirs nos douloureuses illusions si blessées... nos sacrifices nos héroïsmes si inutiles... " (Lettre de décembre 1947 citée par F. Gibault).
Dès la première lettre à Garcin, le 1er septembre 1929, le ton est donné : " ... cette expérience de 1914 dont je ne parle jamais sauf aux initiés, très rares... ", "... nous avons côtoyé l'enfer... ". Le 21 mars 1930 : " D'abord la guerre, dont tout dépend... " Dans la lettre n° 4, il est encore question de " souvenirs du front ". Et puis cette lettre de septembre 1930, ô combien explicite : " Des semaines de 14 sous les averses visqueuses, dans cette boue atroce et ce sang et cette merde et cette connerie des hommes, je ne me remettrai pas, c'est une vérité que je vous livre une fois encore, que nous sommes quelques-uns à partager. " lettre de septembre 1930, ô combien explicite : " Des semaines de 14 sous les averses visqueuses, dans cette boue atroce et ce sang et cette merde et cette connerie des hommes, je ne me remettrai pas, c'est une vérité que je vous livre une fois encore, que nous sommes quelques-uns à partager. "
En mai 1933, en avril 1934, Céline redit à Garcin cette obsession absolue : "... vous le savez mon vieux, sur la Meuse et dans le Nord... j'ai bien vu cet effilochage atroce, gens et bêtes et lois et principes, tout au limon, un énorme enlisement - je n'oublie pas. Mon délire part de là. "
Il est permis de s'interroger sur cette obsession célinienne. Louis Destouches s'est engagé en 1912 et pour trois ans au 12° régiment de cuirassiers à Rambouillet. En 1913, il est nommé brigadier et en 1914, maréchal des logis. Dès la déclaration de guerre, il est envoyé sur le front.
Témoins et critiques reconnaissent volontiers l'importance qu'on revêtu pour Céline la découverte de la vie militaire et surtout les quelques mois de présence au front. Mme Edith Lebon se souvenait très bien du jeune Destouches de 1918, enjoué et parfois enthousiaste, mais qui se fermait et s'assombrissait dès qu'il était question du conflit, et qui semblait traumatisé par les scènes vécues. " Il n'aimait pas en parler ", me confia-t-elle, se rappelant notamment que, lors d'une conversation avec le professeur Follet, son futur beau-père, il avait évoqué la peur, une peur immense qui le poursuivait et lui apparaissait comme une preuve de lâcheté. (Entretiens en 1977 et 1980 à Lannilis dans le Finistère et à Paris).
Henri Mahé, à qui je demandais si Céline faisait souvent allusion à l'expérience de la guerre, me répondit : " Non. Mais lorsqu'il évoquait ses souvenirs de 14, on sentait qu'il avait mal. [...] Il n'oubliait pas les copains tués ou blessés, la boue et le sang des champs des Flandres, la connerie des officiers du commandement, la vacherie universelle... " (Entretiens juillet 1970).
En août 1914, prolongeant l'expérience militaire et la virilité tapageuse et débraillée des casernes, survient la guerre, suprême initiation. A la laideur et à la triste agitation des quartiers succèdent les bourbiers tragiques des champs de bataille et la fréquentation de cette monstrueuse entité : la mort, banale et nauséabonde. Louis Destouches découvre avec stupeur la réalité des corps hachés par la mitraille, vidés de leur contenu, broyés, éclatés, dissous, gigantesque et dramatique débâcle, total effondrement et catastrophe insupportable.
De cette découverte il ne se remettra jamais. Il est initié pour toujours, comme le sera Bardamu. En Argonne et dans les Flandres, Louis Destouches a contracté une nausée qui ne l'abandonnera plus.
(Pierre Lainé, Lettres à Joseph Garcin 1929-1938, Ecriture, 2009).
*********
CELINE OU LE " MARKETING " DE L'ANCIEN COMBATTANT. On connaît les faits : le 31 juillet 1914, le cuirassier Destouches quitte la caserne de Rambouillet. Son régiment manœuvre vers le Nord et entre peu à peu dans la guerre. Le 27 octobre, le soldat se porte volontaire pour une mission de reconnaissance au cours de laquelle il est blessé au bras. Un mois plus tard, il reçoit la médaille militaire dans la cour du Val-de-Grâce et s'empresse d'aller parader dans les rues de Paris. On sait également combien le thème de la Grande Guerre habite l'œuvre de Céline. Dans les romans d'abord, puisqu'il est présent dans cinq d'entre eux : Voyage au bout de la nuit, Casse-Pipe, Guignol's Band I et II et Nord. Dans les discours périphériques ensuite, les lettres, les articles et les entretiens, quand le romancier fait référence à son statut d'ancien combattant, et, plus particulièrement, à son invalidité ou ses décorations.
Ce qui est moins évident en revanche, c'est combien le thème martial varie en fonction du contexte d'énonciation. Dans cette perspective, il est possible de faire apparaître trois grandes périodes. Premièrement, les années patriotes : le jeune Destouches devance l'appel en 1912, s'efforce de satisfaire ses supérieurs et se voit promu maréchal des logis peu avant la déclaration de guerre. Dans les lettres qu'il rédige au front, le cavalier, bien conscient des risques encourus, consent sans hésiter au sacrifice national. La période ce convalescence et le séjour à Londres vont sans doute ébranler ses premières convictions, mais c'est véritablement à partir de 1917, suite au départ en Afrique, que les vertus de l'abnégation patriotique sont radicalement remises en cause. Pour le jeune réformé exilé, la guerre devient incohérente et outrageusement stupide. La distance semble avoir fait office de démobilisation culturelle et Destouches nourrit peu à peu un individualisme critique doublé d'un antimilitarisme qui culminera en 1932 avec la publication de Voyage au bout de la nuit.  On se souvient notamment de la description de la mort du capitaine, gisant dans son sang, appelant sa mère au secours cependant que Robinson lui ordonne de fermer sa gueule. La Seconde Guerre mondiale impulsera par la suite un nouvel élan : le traitement thématique de 14-18 s'en trouvera alors modifié. Compromis du fait de ses relations avec l'ennemi, isolé au Danemark et poursuivi par la justice française, le romancier ne cessera de proclamer et son pacifisme et son patriotisme. On se souvient notamment de la description de la mort du capitaine, gisant dans son sang, appelant sa mère au secours cependant que Robinson lui ordonne de fermer sa gueule. La Seconde Guerre mondiale impulsera par la suite un nouvel élan : le traitement thématique de 14-18 s'en trouvera alors modifié. Compromis du fait de ses relations avec l'ennemi, isolé au Danemark et poursuivi par la justice française, le romancier ne cessera de proclamer et son pacifisme et son patriotisme.
Les stigmates et les décorations hérités de la Première Guerre viendront appuyer son propos : les blessures justifieront la haine des armes et les médailles confirmeront l'amour de la patrie. Dans les romans, le protagoniste égoïste et désenchanté du Voyage cèdera sa place au réfractaire invalide et persécuté car viscéralement pacifiste. Ce constat s'applique particulièrement pour Guignol's Band, dont on rappelle qu'il a été commencé et publié pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus d'évoluer selon le contexte, la représentation de la guerre semble varier en fonction de l'identité du destinataire. Par exemple, il n'est pas rare de lire des propos nostalgiques sur l'armée, adressés à un ancien camarade de campagne, qui contrastent totalement avec le discours général de l'écrivain public. De même, il arrive à l'auteur, dans telles lettres ou tels entretiens, de défendre le prestige de 14-18 avec autant de ferveur qu'il peut en mettre à affirmer, ailleurs, l'absurdité de cette boucherie organisée.
La figure de la Première Guerre mondiale ne saurait être considérée comme un bloc monolithique et statique. Bien au contraire, elle change en permanence pour s'adapter à ce que l'écrivain nommait le " ton de l'époque " (1). La mémoire de 14-18 a ceci de particulier qu'elle a touché et touche encore beaucoup de Français. Jusque dans les années 1970, tous les foyers comptaient un Poilu mort ou blessé au champ d'honneur. Disparu en 1961, Céline a probablement pressenti le désintérêt mémoriel des nouvelles générations. Mais avant de passer pour des vieillards séniles, conservateurs et naïvement patriotes, les anciens de 14 ont longtemps joui d'un prestige symbolique que le jeune Destouches a lui-même éprouvé au lendemain de sa démobilisation. A Londres, par exemple, ce qu'il appelait sa " batterie de cuisine " (2), c'est-à-dire ses médailles, lui ouvrit maintes fois les portes du monde de la nuit. Plus tard, à partir des années 1930, Céline insista volontiers sur son invalidité et ses décorations. Dans certaines de ses lettres, qu'elles soient adressées au jury du Goncourt ou à l'administration , mais également sur sa carte de visite (3), il appose à sa signature son statut d'ancien combattant.
Au-delà de l'avantage symbolique, Céline tira un profit matériel de son engagement. Il bénéficia des faveurs accordées aux démobilisés pour passer son baccalauréat et suivre des études de médecine. Il profita également d'une pension dont il rappelait régulièrement qu'elle lui avait été volée. Et, pendant la Seconde Guerre, au temps des restrictions, il n'hésita pas à mobiliser son passé de soldat pour obtenir des passe-droits. Le 24 décembre 1941, il envoya ces quelques mots au responsable du ravitaillement de la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris : " Gen Paul mutilé 100 % et moi-même 70 % de guerre demandons aux hautes autorités si nous avons droit à un supplément alimentaire ? "
(Charles-Louis Roseau, Spécial Céline n°2, sept. oct. 2011). (1) : A un journaliste qui l'interrogeait sur les causes de son engagement, le romancier répondit : " Je voyais ça très brillant, et puis l'histoire des cuirassiers de Reichshoffen, cela me paraissait quelque chose de très brillant, je dois dire. Et puis c'était brillant parce que c'était le ton de l'époque. " (In interview avec Louis Pauwels et André Brissard, Radio-Télévision française, 1962).
(2) : Georges Geoffroy, témoin des années londoniennes, raconte : " C'est là, quelque temps plus tard, que je vis arriver Louis Destouches avec sa " batterie de cuisine " (Destouches dixit) : Médaille militaire et Croix de guerre [...] Certains soirs, nous fréquentions le milieu, le " milieu français " bien entendu. Ou bien Louis m'entraînait au music-hall (la batterie de cuisine suffisait pour entrer gratuitement), ou à des spectacles de ballets. (Céline en Angleterre, L'Herne, Paris, réédition 2007).
(3) : En 1939, alors qu'il tentait de s'installer à Saint-Germain-en-Laye, le docteur Destouches fit imprimer des cartes avec le texte suivant : " Dr Louis F. Destouches, Lauréat de la Faculté de Paris, Réformé militaire, Médaille militaire, Médecine générale, Consultations tous les jours de 1 à 3 h. " (Lettre à Victor Carré, L'Année Céline 1993, Tusson, Du Lérot, 1994).
*********
Au dessus de nos
têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer
l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui
veulent vous tuer, dans l'air chaud d'été.
Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les
lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que vingt
ans d'âge à ce moment-là. Fermes désertes au loin, des églises vides et
ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée,
tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qu'ils nous eussent laissé en
confiance tout ce qu'ils possédaient, leur campagne, les charrettes, brancards
en l'air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et même les vaches,
un chien avec sa chaîne, tout, quoi. Pour qu'on se trouve bien tranquille à
faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. se trouve bien tranquille à
faire ce qu'on voudrait pendant leur absence.
(...) Je me pensais aussi (derrière un arbre) que j'aurais bien voulu le
voir ici moi, le Déroulède dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il
faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon.
Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal,
mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans
doute. La guerre décidément, n'était pas terminée ! Notre colonel il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement.
(...) On est puceau de l'Horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? A présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu... Ça venait des profondeurs et c'était arrivé.
(...) Donc pas d'erreur ? Ce qu'on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu ! Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre !... Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre le charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules.
(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1956, p.18).
*********
On avait remarqué ça nous autres, une nuit qu'on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours du côté du canon. On en approchait pas beaucoup, pas de trop, on le regardait seulement d'assez loin le village, en spectateurs pourrait-on dire, à dix, douze kilomètres par exemple. Et tous les
 soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon, ça se répétait, on en était entourés, comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages. soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon, ça se répétait, on en était entourés, comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages.
On voyait tout y passer dans les flammes : les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière.
Ça se remarque bien comment que ça brûle un village, même à vingt kilomètres. C'était gai. Un petit hameau de rien du tout qu'on apercevait même pas pendant la journée, au fond d'une moche petite campagne, eh bien, on a pas idée la nuit, quand il brûle, de l'effet qu'il peut faire ! On dirait Notre-Dame ! Ça dure bien toute une nuit à brûler, un village, même un petit, à la fin on dirait une fleur énorme, puis, rien qu'un bouton, puis plus rien. Ça fume et alors c'est le matin.
Les chevaux qu'on laissait tout sellés, dans les champs à côté de nous, ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l'herbe, sauf un, qui prenait la garde, à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder la nuit passe bien mieux, c'est plus rien à endurer, c'est plus de la solitude.
Malheureux qu'ils n'ont pas duré les villages... Au bout d'un mois, dans ce canton-là, il n'y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au canon. Elles n'ont pas existé huit jours les forêts. Ça fait encore des beaux feux les forêts, mais ça dure à peine.
Après ce temps-là, les convois d'artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils qui se sauvaient, dans l'autre. En somme, on ne pouvait plus, nous, ni aller, ni revenir ; fallait rester où on était. On faisait queue pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campements sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en plein champs, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l'ont perdu. C'est à partir de ces mois-là qu'on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouades, et que le gendarme s'est mis à être cité à l'ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956, p.34).
*********
|