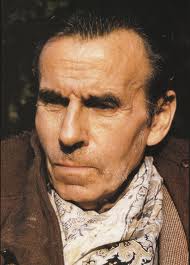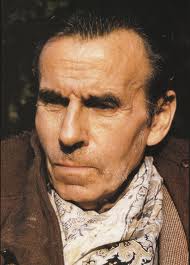|
SES
VISITES
Qu'ils soient
artistes, auteurs, journalistes, amis ou admirateurs,
personnalités connues ou moins connues, tous
n'attendirent pas 1951 et son retour d'exil pour
s'approcher de lui.
Ces visites, toutes différentes, confirment bien l'irrésistible
attraction exercée sur le monde littéraire, politique et
artistique par le phénomène...
Nous
allons découvrir celles de :
Marcel AYME (1951), François-Marie BANIER (1996), Guy
BECHTEL (1958), Pierre
BERGÉ (années 50), Evelyne BLOCH-DANO (2007), Yves
BOISSET (années 50), Claude BONNEFOY (1961), Arno
BREKER, William
BURROUGHS (1958), Roland CAILLEUX (1961), Jean CALLANDREAU (1957), Jacques CHANCEL (1958), Jacques D'ARRIBEHAUDE
(1960), Georges de CAUNES (1948), Pierre DESCARGUES
(1957), Max DESCAVES (1932), René-Héron de Villefosse (1947), Philippe DJIAN (2012), Dominique FABRE (1954), Luc FOURNOL (1958), Hélène
GALLET (1929), Henri GODARD, André HALPHEN (1961), Marc HANREZ (1959), Milton HINDUS (1948), Mikaël
HIRSCH (1952), Lazare IGLESIS (1961), Jacques
IZOARD (1959), Marc LAUDELOUT (1978), Jean LAUNAY
(1932), Hervé Le BOTERF (1959), Robert MASSIN (1947), Armin MOHLER (1956), Pierre MONNIER (1948), Jacques OVADIA (1958), André PARINAUD (1957), Louis PAUWELS (1959), Elizabeth PORQUEROL (1933), Henri
POULAIN (1936), Françis PUYALTE (1992), Jacques ROBERT
(1947), Claude SARRAUTE (1961), Denise THOMASSEN
(1948), J.M. TURPIN-DESTOUCHES
(1961), Pierre VALS (1943), Guy VIGNOHT
(1959), Ole
VINDING (1948), Louis-Albert ZBINDEN (1957).
***
Pendant les premières années d'exil (de 1945 à 1947),
les époux Destouches souhaitèrent la venue de quelques
visiteurs seulement : Gen Paul, Marie Bell, Naud,
Zuloaga, Marie Canavaggia...
Ce n'est qu'à partir de 1948, alors que leur situation s'était un peu
stabilisée et que le temps devenait long, qu'ils
acceptèrent de nombreuses visites. Mais toujours avec
prudence, Céline craignant que les autorités danoises,
la presse communiste ou l'ambassade de France n'en
prennent ombrage. L'échec avec Milton Hindus renforça la
méfiance de Céline.
Selon le
témoignage d'Erna Rasmussen, tous n'eurent pas le même
statut. Il y avait ceux qui étaient logés et
participaient à l'intimité du couple, tels Pierre
Monnier et Henri Mahé. Ceux, les plus nombreux, auxquels
on proposait un pique-nique, l'unique table - celle sur
laquelle travaillait Céline - ne pouvant recevoir que
quatre couverts. Ceux qui étaient reçus debout, ou
devant la porte. Enfin, ceux qui étaient éconduits.
CEUX QUI FURENT REÇUS...
A Copenhague :
En
1946 :
Eliane Bonabel, illustratrice et spécialiste des
dessins de mode, amie des années trente à Clichy, le 27
janvier.
En
1947 :
René Héron de Villefosse, historien, et sa femme
Madeleine, du 7 au 13 novembre.
Robert Massin, alors journaliste, le 13 octobre.
En
1948 :
Henri Philippon, pour l'éditeur Fasquelle, en janvier.
Jean-Gabriel Daragnès, imprimeur et illustrateur, de Montmartre,
venu présider l'Exposition du livre français à
Copenhague, en janvier.
Philippe-André Crozier, assureur, et Jacqueline Moreau, danseuse à
l'Opéra, amis d'Henri Mahé, le 20 janvier.
Daragnès revient en avril.
A Korsor :
En 1948
:
James Laughlin, éditeur américain, le 25 mai.
Ole Vinding, écrivain danois, le 12 juin.
Ernst Bendz, professeur d'université et écrivain suédois, en août.
Pierre Monnier, dessinateur, avec Victor Soulenq, folkloriste
auvergnat, en septembre.
Ercole et Gabrielle Pirazzoli, beau-père et mère de Lucette, en
septembre.
François Gillois, journaliste à l'Indépendance française, le
2 novembre.
Pierre Monnier, en décembre.
En
1949 :
Charles Frémanger, éditeur, le 20 janvier.
Raoul Nordling,
consul de Suède, le 27 mars.
Ercole et Gabrielle Pirazzoli, au printemps, à Skovly.
Georges Geoffroy, bijoutier, ami des années 1914, vers juin.
Henri Mahé, peintre et ami des années 1930, avec Pierre Delrieux,
marchand de tableaux, les 7 et 8 juillet à Skovly.
Georges de Caunes, journaliste, le 15 juillet (cette visite n'est
attestée dans aucune lettre).
Milton Hindus, universitaire américain, du 20 juillet au 11 août.
Mme Dupland, Danoise de Copenhague, en août.
Le pasteur Löchen et les Sales, en août, et ultérieurement à
plusieurs reprises.
Ole Vinding, écrivain danois, le 5 octobre.
Jacques Mourlet, négociant en vin, ami de Quimper, en novembre, à
Skovly.
Pierre Monnier, en décembre.
André Pulicani, réassureur, ami de Montmartre, à une date
incertaine.
En
1950 :
Marcel
Aymé, en mars.
André Pulicani, le 18 mars.
Me Antoine, voisin de la rue Girardon à Montmartre, en juillet.
Gabrielle Abet, épouse de Gen Paul, vers le 6 novembre.
En
1951 :
Pierre Monnier, du 6 au 10 janvier.
Marcel Aymé, du 8 au 11 mars.
Jean-Louis Tixier-Vignancour, avocat de Céline, le 19 mars.
Jeanne Feys-Vuylsteke, admiratrice belge, en avril.
CEUX DONT LES VISITES N'ONT PU ETRE SITUEES DANS LE
TEMPS :
Antoine Ribière, représentant de Michelin à
Copenhague, et M. Allard, son adjoint, venant avec le
pasteur Löchen.
M. Sales, représentant de l'Oréal, également à Copenhague, fit
également plusieurs visites.
Jean Perrot, homme d'affaires, voisin de la rue Girardon.
VENUS SOUVENT, CERTAINS EN VOISINS :
Johannes Vilhem Jensen, romancier danois, prix
Nobel.
Knud Ottostrom, le pharmacien de Korsor.
Helga Pedersen, magistrate. Elle passait souvent ses week-ends dans
la maison de ses parents, " Hulby Mollegaard ", à 3 km
de Klarskovgaard.
Ole Vinding, poète, essayiste et journaliste danois, qui habitait à
Skyttevaenget, à 15 km de Klarskovgaard, à partir du 12
juin 1948.
Ernst Bendz, professeur d'université et écrivain suédois, vivant à
Göteborg : " Notre seul défenseur, hélas en
Scandinavie, si béotienne ! Prétentieuse et ignare !
(...) Il est vieux, malheureusement très vieux ! On va
encore le perdre ! Quel aimable et très distingué
caractère ! (...) Il était professeur à l'université de
Göteborg. Il était linguiste consommé... " (Lettre à
Pierre Monnier, 18 décembre 1950).
Hartvig Frisch, ministre de l'Education nationale.
Plusieurs de ces visiteurs, venus manifester leur
attachement et leur amitié, présents dans l'œuvre de
l'écrivain ou dans ses biographies, méritent d'être
connus autrement que par la simple mention de leur nom.
(Images d'Exil L.F. Céline 1945-1951, Copenhague-Korsor, E. Mazet et
P. Pécastaing, Du Lérot, 2004, p.225).
Marcel AYME
Du 8 au
11 mars 1951, profitant d'une représentation de
Clérambard à Copenhague, Marcel Aymé se rend à
Klarskovgaard pour voir l'exilé. On peut imaginer Marcel
Aymé écoutant avec émotion Céline.
Les deux écrivains se reverront régulièrement à Meudon. Marcel Aymé sera
des rares amis à être invités à l'enterrement de Céline.
En 1961, il préfacera chez Emmanuel
Vitte l'étude poétique de Nicole Debrie sur Céline :
" Céline avait la haine du mal sous toutes ses formes,
sous tous ses déguisements et ses oripeaux. Il était
devenu écrivain comme il était devenu médecin, par une
seule et même vocation. "
En 1963, en ultime hommage à son ami qu'il considérait comme un
immense écrivain, il donnera à L'Herne le long et
beau témoignage " Sur une légende " :
" Ce qui me paraît surprenant, c'est qu'on ait pu accuser Céline
d'avoir collaboré avec les Allemands et même d'avoir été
pour eux un ami et un auxiliaire. [...] Céline
nourrissait à l'égard des Allemands une méfiance et une
hostilité qui venaient de loin. [...] La défaite de 1940
fut pour lui une humiliation et quoi qu'il eût dit
auparavant, une surprise douloureuse. Il la ressentit
comme un affront qui lui eût été fait personnellement et
n'y voulut jamais d'autre explication que la trahison,
le manque de cœur d'une armée qui s'était laissée
embarbeler, disait-il, sans combattre. C'est un chapitre
sur lequel il refusa toujours la discussion... "
Pour
Marcel Aymé, il n'y avait pas de doute, le dossier
Céline était vide en ce qui concerne les incriminations
légales de trahison et de collaboration. Demeurait
seulement son antisémitisme, lequel, malheureusement
pour lui, bénéficia de son génie de littéraire.
(Images d'Exil L.F. Céline 1945-1951, Copenhague-Korsor, E. Mazet et
P. Pécastaing, Du Lérot, 2004, p.280).
François-Marie BANIER
François-Marie
Banier n'aime pas que l'on évoque son " affection pour
les vieilles dames ". Selon nos informations, le
principal protagoniste de l'affaire Bettencourt a
assigné ce mercredi en diffamation les éditions
Taillandier pour avoir publié cette expression dans une
récente biographie de l'épouse de Louis-Ferdinand
Céline. Au cœur
 de
sa plainte, en effet, un passage de Madame Céline,
le livre consacré par David Alliot à Lucette Destouches,
la veuve de l'auteur de Voyage au bout de la nuit.
Il y est raconté qu'en 1996, Lucette Destouches, 84 ans
à l'époque, songeait à vendre sa grande maison de Meudon
en viager. Une maison mythique dans laquelle l'écrivain
avait écrit ses derniers romans, avant de s'éteindre, en
1961. de
sa plainte, en effet, un passage de Madame Céline,
le livre consacré par David Alliot à Lucette Destouches,
la veuve de l'auteur de Voyage au bout de la nuit.
Il y est raconté qu'en 1996, Lucette Destouches, 84 ans
à l'époque, songeait à vendre sa grande maison de Meudon
en viager. Une maison mythique dans laquelle l'écrivain
avait écrit ses derniers romans, avant de s'éteindre, en
1961.
Selon David Alliot, c'est Angelo Rinaldi, ancien critique littéraire
talentueux de L'Express, qui aurait présenté son
ami François-Marie Banier, " dont l'affection pour les
vieilles dames n'est plus à démontrer ", à madame
Destouches. Finalement, la transaction ne se serait pas
faite, l'avocat de l'octogénaire coupant court à ce
projet de viager.
" Ce Banier était précieux, excessif, outrancier. "
Dans son assignation, Me Merlet, l'avocat de François-Marie Banier, estime
que ce passage " insinue " que son client " aurait
profité d'un manque de lucidité de Lucette Destouches,
en référence directe avec l'affaire Bettencourt ". Il
réclame donc 10 000 euros de dommages et intérêts et la
suppression du passage dans toutes les rééditions de
l'ouvrage. Il joint également à sa plainte une
(savoureuse) attestation écrite d'Angelo Rinaldi
contestant s'être entremis entre son ami et Lucette
Destouches, précisant au passage qu'il n'était " pas un
agent immobilier travaillant au noir "...
De son côté, Taillandier fera sans doute valoir que la visite de Banier à
Meudon a été évoquée par... Lucette Destouches
elle-même. C'était dans un livre de souvenirs paru en
février 2017, Lucette Destouches, épouse Céline
(Grasset), signé Véronique Robert-Chovin. " Ce Banier
était précieux, excessif, outrancier, il y avait quelque
chose de faux dans sa façon de parler ", y
confiait-elle notamment.
(L'Express, Jérôme Dupuis, 28 mars 2018).
Guy BECHTEL
Le
27 novembre 1958, Louis-Ferdinand Céline accorda un
entretien à Guy Bechtel, alors chargé d'établir une
édition grand public de Rabelais pour le Club du
Livre. Cet entretien servit l'année suivante de préface
à l'ouvrage. Mais il fut passablement expurgé et les
passages où Céline débordait de son sujet ne furent
évidemment pas retenus.
Un gâchis certain puisque Céline avait une lecture fort peu académique de
Rabelais et qu'au fond une seule histoire l'intéressait,
la sienne. Seule lui importait l'urgence de parler,
d'exprimer sa douleur et sa rage, d'exalter une langue
qui ne soit pas émasculée et de vitupérer " tous ces
larbins qui veulent parler comme le maître ".
Nous publions ici cet entretien, dans son intégralité et en
respectant sa verdeur primitive.
Avec
Robert Poulet, j'arrive vers quatre heures de
l'après-midi chez Louis-Ferdinand Céline, dans son
extraordinaire pavillon de banlieue, à Bas-Meudon. Il
vient à notre rencontre, monstrueux, voûté au point
qu'on le croirait bossu, en grimaçant. Il porte un vieux
pyjama autrefois bleu, sale à vomir, et là-dessus deux
pull-overs troués et une peau de mouton. Son pantalon, à
braguettes déboutonnée, sort d'une friperie modeste. En
murmurant des phrases incompréhensibles, décousues,
râlant, rotant, borborygmant,
lâchant sans ordre cris, mots, épiphonèmes, se tordant,
contorsionnant, se liant et déliant comme un nœud
de vipères poisseuses, et je boîte à gauche et je boîte
à droite, et murmurant encore, le souffle court, avec
des rires qui montrent ses dents sales, il nous
introduit dans son bureau, qui est un zoo.
Le perroquet siffle et dit : " Coco ! ", les chiens aboyent, les chats
sautent, hurlent, griffent, tirent la laine des
coussins, et des oiseaux pépient dans toutes les cages
qui encombrent la pièce.
Il
se met à me parler d'une traite.
- Faut que je vous parle de Rabelais ?
Ça
se fait beaucoup de demander leur avis aux gens. Tout le
monde et sur n'importe quoi... On fout ça en disque... A
Brigitte Bardot, qu'on demande son avis... Mais ce
qu'elle dit, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire ?
Est-ce qu'elle dit qu'elle a un beau cul ? Non, alors on
s'en fout. Mais ça fait un disque. Et les Duhamel et
compagnie, tout le Figaro, quoi ! Qu'est-ce que
ça écrit, un Duhamel, hein ? Moi, j'aime pas, je suis un
puriste.
Rabelais, vous faites une édition de Rabelais ? C'est pour qui, votre
truc ? Pour les gens bien, hein ? Pour qui ? Pour les
familles, je parie... Si c'est pour les familles, faut
me le dire, pour que je ne dise pas de saloperies...
Non, pas expurgé ?
Vous voulez que je vous parle de Rabelais ? D'accord.
Vous écoutez ? Alors je peux y aller, hein ? J'ai
fouillé encore ce matin l'Encyclopédie, alors maintenant
je sais. Y a tout là-dedans, la grande encyclopédie. On
fait des carrières formidables avec l'Encyclopédie.
Justement, j'ai cherché à " Rabelais "...
Non, voilà ce que je vais dire. Avec Rabelais, on parle toujours de ce
qu'il faut pas. Vous savez, on dit, on répète, et
partout et partout : " C'est le père des lettres
françaises ". Et puis, il y a de l'enthousiasme, des
éloges. Ça
va de Victor Hugo à... à... A qui ? A Balzac, à
Malherbe.
Le père des lettres françaises, ah là là ! C'est pas si simple. En
vérité, Rabelais, il a raté son coup, il a pas réussi.
Ce qu'il voulait faire c'est un langage pour tout le
monde, un vrai, il voulait démocratiser la langue. Une
vraie bataille... La Sorbonne, il était contre, les
docteurs et tout ça... Tout ce qui était reçu et établi,
le roi, l'Eglise, le style, il était contre.
Non, c'est pas lui qui a gagné, réussi. C'est Amyot, le traducteur de
Plutarque : il a eu beaucoup plus de succès que
Rabelais. C'est sur lui, sur sa langue, qu'on vit encore
aujourd'hui. Rabelais
avait voulu faire passer la langue parlée dans la langue écrite, un
échec. Tandis qu'Amyot, les gens maintenant veulent toujours et encore
de
 l'Amyot,
du style académique, duhamélien. Ça,
c'est écrire de la merde : du langage figé. Les colonnes du Figaro,
qui se flatte d'avoir des rédacteurs qui écrivent bien, en sont pleines.
Le Figaro, c'est un cloaque à verbe bien filé, à phrases bien
conduites, avec, à la fin de l'article, une petite astuce innocente. Pas
dangereuse, pas trop forte, pour ne pas effrayer le public. De la vraie
merde, je continue. l'Amyot,
du style académique, duhamélien. Ça,
c'est écrire de la merde : du langage figé. Les colonnes du Figaro,
qui se flatte d'avoir des rédacteurs qui écrivent bien, en sont pleines.
Le Figaro, c'est un cloaque à verbe bien filé, à phrases bien
conduites, avec, à la fin de l'article, une petite astuce innocente. Pas
dangereuse, pas trop forte, pour ne pas effrayer le public. De la vraie
merde, je continue.
Rabelais a vraiment voulu une langue extraordinaire et riche. Mais les
autres, tous, ils l'ont émasculée cette langue, pour la rendre
duhamélienne, giralducienne et mauriacienne. Ainsi, aujourd'hui, écrire
bien, c'est écrire comme Amyot, mais ça, c'est jamais qu'une langue
de traduction.
Germaine Beaumont a dit une fois, en lisant un livre : " Ah ! que c'est
beau à lire, on dirait une traduction ! " Voilà qui donne le ton. C'est
ça, la rage moderne du Français : faire et lire les traductions, parler
comme dans les traductions. Moi, y a des gens qui sont venus me demander
si je n'avais pas pris tel ou tel passage dans Joyce. Oui,
on me l'a demandé ! C'est l'époque... parce que l'anglais, hein, c'est à
la mode... Moi, je parle
l'anglais parfaitement, comme le français. Aller prendre quelque chose
dans Joyce. Non je le parle pas, ce putain de langage qui me fait
chier... Comme Rabelais, j'ai tout trouvé en français.
Lanson (et c'était pas un zigoto), il dit : " Le Français n'est pas très
artiste ". Pas de poésie en France, tout est trop cartésien. Il a raison
évidemment. C'est le cas d'Amyot, voilà... C'est un pré-cartésien, et
c'est ainsi que tout a été gâché. Pas le cas de Rabelais : un artiste.
Rabelais, oui, il a échoué, et Amyot a gagné. La postérité d'Amyot,
c'est tout Gallimard, tous ces petits romans émasculés. Des milliers par
an. Mais, des romans comme ça, moi, j'en chie un à l'heure. Or, on ne
publie que ça. Où est la postérité de Rabelais ? La vraie littérature ?
Disparue. La raison en est claire. Faudrait comprendre une fois pour
toutes (assez de pudibonderie !) que le français est une langue
vulgaire, depuis toujours, depuis le traité de Verdun. Seulement ça, on
veut pas l'accepter et on continue de mépriser Rabelais.
" Ah ! c'est rabelaisien ", qu'on dit parfois. Ça
veut dire, hein, attention, c'est pas délicat, ce truc-là... Ça
manque de correction... Délicat, délicat... Et le nom d'un de
nos plus grands écrivains a ainsi servi à façonner un adjectif
diffamatoire. Monstrueux ! Or c'était un type très fort Rabelais,
écrivain, médecin, juriste, évêque. Il a eu des emmerdements, le pauvre,
même de son vivant, il passait son temps à essayer de ne pas être brûlé.
Non, la France peut plus comprendre Rabelais : elle est devenue
précieuse. Ce qui est terrible à penser, c'est que ça aurait pu être le
contraire. La langue de Rabelais aurait pu devenir la langue française.
Mais il n'y a plus que des larbins : ils sentent le maître et veulent
parler comme lui. Vive l'anglais, la retenue plate ! Rabelais, vous
direz, ça sent bien un peu le système, mais quoi, ce type il a été
traqué par la persécution catholique, il battait en brèche les
puissants. Ça
sentait bien un peu le fagot, ce qu'il faisait.
Voilà
ce que je voulais vous dire. Le reste (imagination, pouvoir de création,
comique, etc.), ça ne m'intéresse pas. La langue, rien que la langue,
voilà l'important. Le
reste, tout ce qu'on peut dire d'autre, ça traîne partout. Dans les
manuels de littérature, et puis lisez l'Encyclopédie. Si vous en voulez
plus, allez demander à d'autres, à tous ces grands écrivains qui eux,
doivent avoir " des idées sur Rabelais ". Ah ! j'en connais...
Montherlant, tiens, il se prendra la tête entre les mains... Les gars à
message, quoi... Il vous dira avec sérieux sûrement quelque chose comme
: " Moi, j'ai consacré tant d'années à Rabelais ". Mauriac aussi, il
doit avoir des idées sur Rabelais : " Rabelais, ah ! quel prodigieux
inventeur de mots ! ", qu'il vous dira. Ceux-là, c'est rien que des
bavards !
Faut s'en tenir à ce que j'ai dit : le langage. A ce qui est intéressant
chez Rabelais : son intention un peu démagogique d'attirer le public en
parlant comme lui. Je comprends, moi. Rabelais était médecin et
écrivain, comme moi. Ça
se voit : la crudité juste. C'était un bon anatomiste d'ailleurs, et,
prodigieux pour l'époque. Il opérait
déjà. Si, si il a même inventé un appareil chirurgical.
Il
devait pas croire beaucoup en Dieu, mais il n'osait pas le dire.
D'ailleurs, il a pas mal fini : il a pas eu de supplice. Ça
a été après, le supplice, quand il a académisé et égorgé le français
qu'il parlait pour en faire une littérature de bachot et de brevet
élémentaire.
- Robert Poulet : On a fait un français maigre, alors qu'il y
avait un français gras.
- Céline : Pire, squelettique. Même Balzac a rien ressuscité.
C'est de l'académisme, plat, plat ! C'est la victoire de la raison.
La raison ! Faut être fou ! On peut rien faire comme ça, tout émasculé.
Ils me font rire. Regardez ce qui les contrarie : on a jamais réussi à
faire raisonnablement un enfant. Rien à faire, il faut un moment
de délire pendant le coït.
Mais non, en littérature, faut rester propre. Alors on met aujourd'hui
des points de suspension quand il se passe quelque chose. Et puis ça
continue bien tranquillement comme ça : " La duchesse le lendemain... la
comtesse... les invitait à la réception... à cinq heures ". Comment
c'est ?
- La duchesse sortit à cinq heures.
- Ouais... Oh ! Je ne recommande pas l'érotologie, ça me dégoûte, mais
ce qui est terrible, c'est ce langage trop poli.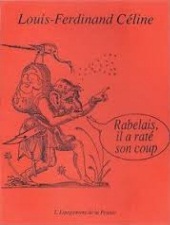
Ce
qu'il y a de bien chez Rabelais, c'est qu'il mettait sa peau sur la
table, il risquait. La mort le guettait, et ça inspire, la mort ! C'est
même la seule chose qui inspire, je
le sais, quand elle est là, juste derrière. Quand la mort est en colère.
Il était pas bon vivant, Rabelais. On dit ça, c'est faux. Il travaillait.
Et, comme tous ceux qui travaillent, c'était un galérien. On aurait bien
voulu l'avoir, le condamner. Avoir les curés au cul, c'était comme la
mort. Autres galères. Celles du pape, ça a existé, c'est vrai. Et là,
les gars, il fallait qu'ils rament ; qu'ils ramassent comme dirait
Duhamel.
Bardamu, aussi. Ah ! les imparfaits du subjectif. J'ai eu dans ma vie le
même vice que Rabelais. J'ai passé mon temps à me mettre dans des
situations désespérées. Je me suis rendu soigneusement odieux. Comme
lui, je n'ai donc rien à attendre des autres. J'ai qu'à attendre des
glaviots de tout le monde. Ça
gueule encore, à Meudon. Le maire, tous, ils veulent ma peau. On met
encore des ordures dans ma boîte aux lettres. Sur les murs, qu'ils
écrivent aussi... Contre Céline, le pornographe... C'est du propre,
votre de Gaulle.
Vous avez vu son bide, à de Gaulle ? C'est gros, c'est gros. Y a quelque
chose. Y va crever, avec un gros ventre comme ça. Tout pourri,
là-dedans. Doit avoir un cancer, un truc comme ça...
Il était à Londres pendant la guerre. Le caviar, quoi... Moi, j'ai
souffert. A Sigmaringen, je soignais les gars. Y a que moi qui
voulais... Déat, Abetz... On m'aime pas, et pourtant je me suis dévoué.
On m'a pris mon appartement, un gars à de Gaulle. Un colonel. Ils ont
tout vendu aux Puces : trois camions de déménagement. Et la prison :
deux ans au Danemark. Souffert, oui... Mon ex-femme a jamais voulu me
revoir. Ma fille non plus. Elle est mariée, elle a six gosses. Elle est
jamais revenue. Ah ! elle est pas fière d'être la fille de Céline...
C'est du monde bien, quoi... Sa naissance, on n'en parle pas : c'était
sans doute rien qu'un petit accident. Pendant ce temps-là, moi, vieux,
pauvre, je mange juste une patate le soir. Je regrette rien ! Je
regrette jamais !
Quelle
vie, mais je m'en fous. Le Cameroun, où j'ai failli crever...
L'Amérique, tout... J'aime pas ceux qui voyagent aujourd'hui. Les
touristes... Ils vont rien voir. Rien du tout. Vous voulez que je vous
dise !
Vous savez ce qu'ils vont voir quand ils voyagent ? Leur bitte, rien que
leur bitte. On voyage pour aller baiser ailleurs. Ah ! le cul des
postières ! Et leur con ? Ça,
c'est un mot qui est dans Rabelais. Plusieurs fois.
J'écrirai encore. Là sur ma table, un roman. Ca s'appelle Nord,
tout simplement. Nord, comme le sud, comme l'est, comme l'ouest.
2 300 pages déjà. Ça
fera trois mille de mon écriture. Encore un an de travail.
L.F.
Céline nous raccompagne en boitillant ; sautant, bossu et laid, d'une
pierre sur l'autre dans le sentier, avec des grâces de pieuvre molle.
L'écrivain français peut-être le plus génial du siècle, sûrement le plus
original, c'est cette défroque : sorte de Quasimodo intouchable. Du
premier étage du pavillon arrivent les notes d'un piano. Sa seconde
femme, qu'on dit toute de douceur, délicate, son contraire, gagne de
l'argent en donnant des leçons de danse.
- Elle est encore en train de faire sauter les grenouilles ! dit-il.
Il se traîne, en s'appuyant sur mon épaule. C'est maintenant, un homme à
éclairs. Il y en a ; il n'y en a pas. Ça
dépend du moment. A ce paysan qui joue paradoxalement au paysan, il
reste peu, mais encore quelque chose. Pendant deux heures, ce qu'il n'a
pas osé me dire, il n'a cessé de le suggérer ; cette langue que Rabelais
n'a pas réussi à imposer en littérature, lui Céline l'a répandue, fait
vivre même pour ceux qui la haïssaient.
La nuit est tombée, avec quelque brume. Autour de lui, ses chiens
hurlent. Il est encore plus irréel dans cette soirée d'hiver, humide,
puante de banlieue. Longtemps, il regarde ma 11 CV traction-avant.
- Une voiture de fellaga, vous avez une voiture de fellaga !
Puis il me claque au nez la porte de son jardin.
(Guy Bechtel, Rabelais ou la crudité juste, Magazine-Littéraire n°4,
2002).
Pierre BERGÉ.
Les
chiens aboyèrent et se jetèrent sur la grille lorsque
nous arrivâmes à Meudon, rue des Gardes, pour rencontrer
Louis-Ferdinand Céline. La lecture du Voyage
m'avait terrassé lorsque à quinze ans j'ai découvert ce
qu'était l'écriture, comment on pouvait tordre les mots,
faire jaillir des images, des épithètes et cracher à la
face du monde. A cette époque je ne savais rien de
Céline, de sa vie, de son comportement pendant la
guerre. L'antisémitisme m'était inconnu. Aussi lorsque
Daragnès, trois années plus tard, m'apprit qu'il
récoltait un peu d'argent pour l'envoyer à Céline, au
Danemark, je mis la main à la poche, même si elle était
presque vide.
Lorsque
Céline revint en France, j'avais, bien sûr, tout appris,
mais mon admiration pour l'écrivain était restée la
même. Aussi, lorsqu'on m'offrit de le rencontrer, je ne
pouvais qu'accepter avec joie. Que dis-je ? Avec
fébrilité ! Pensez : c'est comme rencontrer Proust,
Genet, Claudel, Valéry. Ce que j'avais déjà fait avec
Giono. Je dois avouer que je n'éprouvais aucun dégoût,
aucun rejet. Flaubert s'était dressé contre la Commune,
d'autres contre Dreyfus et Péguy aimait les " justes
guerres ". Ce qu'a fait Céline est impardonnable, mais
qui parle de pardonner ? Donnons plutôt la parole à D.
H. Lawrence : " Ne faites aucune confiance à l'artiste.
Faites confiance à son œuvre. La vraie fonction d'un
critique est de sauver l'œuvre des mains de son
créateur. "
Aussi, lorsqu'on m'offrit de le rencontrer, je ne
pouvais qu'accepter avec joie. Que dis-je ? Avec
fébrilité ! Pensez : c'est comme rencontrer Proust,
Genet, Claudel, Valéry. Ce que j'avais déjà fait avec
Giono. Je dois avouer que je n'éprouvais aucun dégoût,
aucun rejet. Flaubert s'était dressé contre la Commune,
d'autres contre Dreyfus et Péguy aimait les " justes
guerres ". Ce qu'a fait Céline est impardonnable, mais
qui parle de pardonner ? Donnons plutôt la parole à D.
H. Lawrence : " Ne faites aucune confiance à l'artiste.
Faites confiance à son œuvre. La vraie fonction d'un
critique est de sauver l'œuvre des mains de son
créateur. "
Ne nous y trompons pas : en me rendant chez
Louis-Ferdinand Céline, j'allais à la rencontre d'un des
plus grands écrivains français, pas à celle d'un saint.
Je ne fus pas déçu ! Une espèce de pavillon, des chiens
qu'il fallut enchaîner, le chat Bébert qui n'avait plus
qu'un œil, après avoir parcouru la moitié de l'Europe,
sa femme, Lucette Almanzor, belle et secrète, qui se
prétendait la victime de tout, de tous, de Gallimard,
des communistes, des Juifs, de la terre entière. Il
devait se protéger : ses chiens ne servaient pas à autre
chose. Dieu sait s'ils coûtaient cher à nourrir !
Je me rappelle la fascination qui s'était emparée de
moi. Je le regardais, étonné de son allure négligée,
presque sale, alors qu'il avait écrit sa thèse sur
Semmelweis, l'homme de l'aseptisation. Je n'ai rien noté
de cette conversation. Aujourd'hui je le regrette. Au
détour d'une phrase, après qu'il eut dit tout le mal
qu'il pensait de ses confrères, je lui ai demandé s'il
avait lu Henry Miller. " Miller ? Miller ?
s'interrogea-t-il, encore un de mes petits plagiaires !
" Je lui ai dit que non, que c'était mieux que ça, que
grâce au Voyage des écrivains comme Miller
existaient, qu'il devait en être heureux, fier, que
c'était lui qui avait ouvert les portes du langage, que
les mots s'étaient envolés comme des oiseaux retenus
prisonniers. Ça ne l'intéressait pas. Il était l'objet
d'un complot, n'en démordait pas. Pourtant il détestait
les Allemands, les avait toujours haïs. Il disait " les
Boches ". Quant à Hitler, il n'avait pas assez de mépris
pour en parler.
Il
nous raccompagna jusqu'à la route, le soir tombait, les
chiens aboyèrent de nouveau. Il ferma soigneusement à
clef la grille du jardin, nous salua de la main une
dernière fois puis alla rejoindre ses fantômes
(Pierre Bergé, Les jours s'en vont, je demeure, Gallimard, 2003).
Visite d'Evelyne BLOCH-DANO (Magazine
littéraire, 2007).
" La maison n'a plus rien à voir avec ce qu'elle
était ", m'a prévenu François Gibault. Elle a brûlé
en 1968. Pourtant, je la reconnais. Un peu moins
délabrée, certes, des fenêtres neuves, un portail grand
ouvert, mais l'impression est la même : l'abandon.
Nous avons rendez-vous dans la matinée, Mme Destouches dort. On nous a
autorisés à venir pendant son sommeil. Agée de 94 ans,
elle habite toujours route des Gardes. Nous faisons le
tour de la propriété. Le jardin est plus petit que dans
mon souvenir, mais plus coquet ; un atelier en désordre
; un terrain en friche derrière la maison, à flanc de
colline, entre dépôt d'encombrants et arrière-cour de
ferme. Une baignoire surréaliste, un canapé en rotin.
On risque un coup d'œil
par les fenêtres. Des ustensiles exotiques, une cage
avec un perroquet. Tiens ! Serait-ce Toto, l'affreux
Toto, le perroquet de grade, perché sur l'épaule de son
maître qui lui avait appris à chanter Dans les
plaines de l'Asie centrale de Borodine, et qui
chassait les visiteurs à coups de bec ?
Une
voiture remonte l'allée, c'est Marie-Ange, la jeune
femme qui s'occupe de Lucette Destouches depuis plus de
dix ans. Elle nous invite à entrer pour nous réchauffer
autour d'un café. On mesure le degré de mythification
d'un auteur à l'émotion étrange qu'on ressent à pénétrer
chez lui. Le temps, la mort, ont transformé la visite en
intrusion pieuse.
J'ai beau savoir qu'une partie des lieux a changé, que le bureau a quitté
le coin de la salle pour migrer dans la cuisine ; j'ai
beau haïr l'antisémite qui appelle à la haine et hurle
avec les loups ; j'ai beau distinguer un grand écrivain
d'un grand styliste (c'est la dimension de l'homme qui
fait la différence), je suis impressionnée. Pour un peu,
on baisserait la voix.
"
Faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé ",
claironne-t-il encore en 1957. Depuis son retour du
Danemark, en 1951, et l'amnistie grâce à un subterfuge
de son avocat, Tixier-Vignancour, il s'est installé dans
cette villa du XIXe siècle, sans confort mais assez
grande pour loger l'atelier de danse de Lucette et leur
ménagerie.
Céline à Meudon, le livre de photos rassemblées par David Alliot
restitue le personnage aigri, négligé, anguleux, voûté
qui consacre désormais ses jours à écrire et à
interpréter face à la presse le rôle du grand
Vitupérateur. Il soigne de temps à autre, toujours
gratuitement, les pauvres. " Nous n'avions pas un sou
et nous vivions comme des clochards. Notre installation
faisait fuir la clientèle normale ", confiera
Lucette à Véronique Robert.
Mais le succès revient, énorme, avec la trilogie allemande, et avec lui,
les contrats juteux. " On est de la gloire ou on ne
l'est pas ! " écrivait Céline. Il l'est. Ses
manuscrits s'arrachent à prix d'or. Et sur sa tombe,
aujourd'hui, les admirateurs disposent des cailloux.
(BC
n°284, mars 2007).
Visite
du réalisateur Yves BOISSET. Dans les années 1950, il se
rend à Meudon.
C’est
en rentrant du tournage passionnant mais éprouvant de
Liberté I que j’eus la chance inespérée de
rencontrer fugitivement Louis-Ferdinand Céline.
J’avais à l’époque une fiancée adorable. Elle
s’appelait Evelyne, préparait une licence d’histoire de
l’art, et se passionnait pour la danse classique. Un
samedi de printemps, elle me demanda de venir la
chercher à la sortie de son cours de danse. C’était à
Meudon chez une certaine Mme Destouches.
- Lucette ?
Elle me regarda abasourdie.
- Oui. Lucette Destouches ! Tu la connais ?
- Son mari est écrivain ?
- Non, je crois qu’il est médecin. Mais je ne l’ai
jamais vu. Il paraît que c’est un vieil ours assez
désagréable.
J’avais depuis toujours une admiration un peu
horrifiée pour Céline. J’avais dévoré Mort à crédit
et Voyage au bout de la nuit, et suivi dans
ses récits autobiographiques son parcours chaotique. Je
savais qu’il vivait retiré dans une petite maison à
Meudon où sa femme animait sous son vrai nom, Lucette
Destouches, un cours de danse classique.
C’est donc le cœur battant que je sonnai en fin de
journée à la grille du pavillon de banlieue de Mme
Destouches. C’était une dame d’un certain âge un peu
méfiante mais très charmante.
Lorsque je lui demandai s’il lui paraissait possible
de rencontrer son mari, elle se referma comme une
huître. Il ne voulait voir personne en dehors de
quelques amis intimes et se méfiait comme de la peste
des gens qui prétendaient l’admirer. Surtout des jeunes
qu’il tenait volontiers pour foutriquets hypocrites.
Comme elle aimait beaucoup Evelyne, elle promit
pourtant d’intercéder en ma faveur auprès de son mari.
 Le samedi suivant, je sonnai à nouveau à la grille du
pavillon de meulière pour venir chercher Evelyne. J’eus
à peine le temps de saluer Mme Destouches que
j’entendis, venue de nulle part, la voix graillonneuse
de Céline. Le samedi suivant, je sonnai à nouveau à la grille du
pavillon de meulière pour venir chercher Evelyne. J’eus
à peine le temps de saluer Mme Destouches que
j’entendis, venue de nulle part, la voix graillonneuse
de Céline.
- Il est là, l’ahuri ?
Encouragé par cette aimable invitation, Mme Destouches
me désigna, derrière une haie, une petite tonnelle.
Installé devant une masse de papiers, Céline était
engoncé dans une pelisse élimée, un gros cache-col
autour du cou malgré la chaleur de cette fin
d’après-midi.
Il me jeta à peine un regard, visiblement plus
intéressé par les charmes d’Evelyne, avant de coasser
avec un ricanement :
- Vous avez bien de la chance, jeune homme. Elle est
charmante votre petite danseuse. Alors, comme ça, vous
êtes dans le cinéma ?
Je lui expliquai mes activités d’assistant. Il
n’avait pas l’air passionné par les exploits de Maurice
Ronet et de Corinne Marchand dont il ignorait jusqu’à
l’existence. Mais il manifesta un brusque intérêt
lorsque j’évoquai Michel Simon que je venais de
rencontrer et qui m’avait convié à visiter le musée
d’objets érotiques qu’il avait constitué dans sa maison
de Noisy.
- Il paraît que c’est un salopiot, mais c’est un foutu
bon acteur. Si ces abrutis s’étaient décidés à tourner
le Voyage au bout de la nuit, je l’aurais bien vu
en Bardamu. On m’a dit que chez lui, c’était bourré de
cochonneries. Vous me raconterez ça la prochaine fois.
J’étais fou de joie. Grâce à Michel Simon, c’était
presque une invitation à revenir.
Peu après, l’interprète de Boudu sauvé des eaux
et de L’Atalante me reçut en compagnie de sa
guenon Zaza à laquelle il ne cessait de manifester une
tendresse troublante. Il assurait d’ailleurs qu’elle
pratiquait les plus exquises fellations qu’il ait
connues en cinquante ans de pratique.
Michel Simon collectionnait les objets érotiques
depuis l’âge de douze ans. Et son musée secret révélait
des trésors impressionnants. Emouvants même, comme il se
plaisait à le dire sans détour.
- Quand je vois ces petites merveilles, moi ça me fait
bander. Il y avait des sièges phalliques fabriqués pour
le comte de Choiseul, un énorme pénis en argent ciselé
ayant appartenu à la Grande Catherine de Russie, des
sexes de femmes en caoutchouc et même un phallus
phénicien en verre qui datait de plus de vingt siècles.
Mais la pièce qui m’a le plus impressionné reste sans
doute le fameux vélo d’appartement de Michel Simon qui
préfigurait la machine à branler de Boris Vian dans son
roman Et on tuera tous les affreux. De la selle
de ce vélo surgissait à chaque tour de pédale un
vigoureux phallus de cuir censé donner au cycliste un
plaisir sans égal.
Au moment de nous séparer, Michel Simon ne manqua pas
d’entonner de sa voix sarcastique et fracassée le
sulfureux « Notre Père » des Rouilles encagées de
Benjamin Péret :
- « Notre Père qui êtes au Con
Que votre cul soit défoncé. »
Evidemment, le récit de cette escapade enchanta Céline
qui me réclamait toujours plus de détails scabreux sur
les trésors artistiques détenus par Michel Simon. Au
grand dam de Mme Destouches qui trouvait tout cela bien
choquant.
Par la suite, mes relations mondaines s’étant un peu
distendues avec Evelyne, je n’eus plus l’occasion de
revoir Louis-Ferdinand Céline.
(La vie est un choix,
Plon, 2011, Spécial Céline n°5).
Claude BONNEFOY, " Dernier adieu à sa
jeunesse. Quelques semaines avant sa mort L.F. Céline a
raconté l'histoire de ses vingt ans ", Arts, n°832, août
1961.
Nous
étions chez lui, à Meudon. Il avait fait sortir les
chiens, le chat. Seul le perroquet était resté avec
nous. Drapé dans sa robe de chambre, assis dans un
fauteuil, tournant le dos à sa table de travail, Céline
parlait. Il était fatigué, malade, épuisé par des années
d'exil et de misère. Mais dès qu'il parlait, il était
présent, puissant, intarissable. Souvent il s'arrêtait
sur une idée, sur un mot, les reprenait, les ressassait,
comme un cheval qui piétine avant le départ, puis il
s'envolait littéralement, sa pensée bondissait, ses
phrases faisaient flèche, il devenait lyrique, il était
le grand Céline.
Mais s'il monologuait, c'était aussi pour échapper aux questions.
- Qu'est-ce que vous voulez savoir ?... Ma jeunesse ?
Mais ça n'intéresse personne... Ça
a si peu d'importance. Ce n'est rien, ma jeunesse ça
n'existe plus... Vous feriez mieux de demander à
d'autres... Ça
leur ferait plaisir de parler d'eux... Ils ont une
carrière à faire, ils y croient... L'Académie...
Moi, aujourd'hui, on ne m'aime pas... Et puis c'est triste, ma
jeunesse... Vos lecteurs, ils veulent des choses gaies,
le monde est bien assez moche comme ça... Alors,
inventez, c'est pas moi qui vous contredirai...
Déjà, il parlait d'autre chose, de littérature. Il oubliait Louis
Destouches, le jeune homme qu'il avait été. Il
oubliait Louis Destouches. Il était Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain.
Pourtant, il détestait les écrivains. Ecrire, ce seul
mot le mettait en fureur. Il y revenait sans cesse.
Destouches. Il était Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain.
Pourtant, il détestait les écrivains. Ecrire, ce seul
mot le mettait en fureur. Il y revenait sans cesse.
- Ecrire ?... Qu'est-ce que ça veut dire ?... ça
m'horripile !... C'est bien écrit... il écrit bien, elle
écrit bien... Regardez comme
c'est filé, comme c'est charmant !... Je ne peux pas
supporter ça... Ils font des phrases, c'est facile... La
création, la vraie, ça demande une grosse concentration
intellectuelle, anormale, pas naturelle... J'en parle en
médecin... C'est presque un
suicide... Quand on en est incapable, on donne dans le
charlatanisme... On reste accroché à Bordeaux, à
Bourget...
Tout le monde me dit " lisez ça ". Je regarde... eh bien rien... c'est
plat, insipide, ça n'est pas fait, un réalisme
merdeux... Ces littérateurs ont moins de style qu'un
rédacteur à la préfecture, qu'un pion de lycée à qui on
demande d'être clairs... Le monde littéraire, c'est un
cirque. Vive les chevaux de bois !... Ah ! si on m'avait
dit que j'écrirais, quand j'étais jeune !... Quelle
rigolade !
(...) - Comment avez-vous fait vos études de médecin ?
- Je potassais, tout seul. Je suis un enfant de la
communale. J'avais une vraie passion pour la culture. Je
voulais tout savoir.
Et puis, j'avais toujours cette volonté folle d'être
médecin, de sortir de ces situations miteuses... J'avais
toujours des petits manuels dans les poches. Dès que je
pouvais, je les dévorais, dans la journée pendant une
pause, ou le soir... J'ai tout appris comme ça, le
latin, le grec, les mathématiques, la littérature.
Finalement j'ai passé mon bachot, en 1912, à dix-huit
ans, puis je me suis engagé au 12e cuirassiers la même
année.
- De cette vie n'avez-vous pas d'autres souvenirs que
celui d'un labeur incessant, d'une course permanente
après un salaire de famine ?
- Je peux vous parler des mœurs
de l'époque, des distractions. Oh ! elles n'étaient pas
nombreuses pour nous les distractions !...
Tenez, je me souviens d'un détail. Sous les portes cochères le matin, il
y avait des bonnes femmes qui vendaient du café au lait,
pour les employés... C'était vers 1900. Ça
a disparu assez vite.
1900. Je me souviens de l'Exposition. J'avais un oncle qui faisait le
boniment. Sur le bord de l'eau, il y avait les pavillons
de toutes les nations. La porte monumentale, place de la
Concorde, m'impressionnait beaucoup... Ce qui m'avait le
plus frappé ? Le chocolat ! Je n'en avais jamais vu
autant. Il défilait sur de grandes plaques de zinc.
J'étais très épaté, fasciné !...
Ça
me séduisait encore plus que les trottoirs roulants.
Mais en 1912, il était militaire, dans la cavalerie.
- J'étais à Rambouillet... J'étais un militaire bien
docile. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Pour ça,
j'avais l'habitude... J'ai dû apprendre à monter à
cheval. Des chevaux, je n'en avais jamais approché. Au
début, c'était effroyable, je tombais tout le temps...
C'était dur, presque plus dur que les prisons du
Danemark et celles-ci étaient pourtant pas roses, une
infection !... On n'avait pas le temps de chômer au 12e
cuirassiers. On nous réveillait à cinq heures... Il
fallait s'occuper de quarante-cinq chevaux. C'est fou ce
que ça peut demander comme travail, les chevaux...
Finalement, je savais bien tout faire. J'ai fini
maréchal des logis.
Pour le 14 juillet, on défilait à Longchamp. Il y avait des gens jusque
dans les arbres pour regarder passer la revue. On nous a
envoyé dans les grèves aussi. Je me souviens d'un 1er
Mai, rue des Pyramides, où nous nous sommes trouvés face
à des travailleurs révolutionnaires qui nous jetaient
des pierres. Ils étaient peu nombreux, une quarantaine à
peu près. Le 12e cuirassiers, composé de paysans bretons
qui parlaient à peine le français, ne risquait pas de
fraterniser. C'était pour cela qu'on nous appelait... Ce
qui était étonnant, c'était le consentement du peuple à
mener une vie de cochon. Les révolutionnaires étaient
souvent traités de voyous, même par le peuple. Moi-même,
je ne croyais pas à l'époque que ces gens-là pouvaient
apporter quelque chose. On ne se rendait pas compte. On
respectait l'ordre, la discipline. La question ne se
posait pas. (Quand elle se pose c'est déjà fini.)
 (...) Rentré en France, réformé, rendu à la vie civile,
Céline dut à nouveau gagner sa vie. Il rêvait toujours
de médecine. Il allait l'aborder par la bande, en
devenant conférencier.
(...) Rentré en France, réformé, rendu à la vie civile,
Céline dut à nouveau gagner sa vie. Il rêvait toujours
de médecine. Il allait l'aborder par la bande, en
devenant conférencier.
- J'ai été embauché par la fondation Rockefeller. On
parcourait toute la Bretagne en camion. Avec nous, il y
avait un Breton canadien qui trimbalait sa femme et ses
cinq enfants.
On faisait des conférences dans les écoles sur la tuberculose. On
en faisait jusqu'à cinq ou six par jour. Les paysans à
qui on s'adressait et qui parlaient surtout patois ne
comprenaient pas toujours nos explications... Ils
écoutaient sagement, sans rien dire... Ils regardaient
surtout les films... Très instructifs, les films... On
voyait des mouches se promener sur le lait... La
pellicule cassait toutes les cinq minutes, ou sautait.
Ça
ne faisait rien... On réparait...
Moi, je m'étais remis à l'étude... Toujours tout seul. J'ai passé mon
second bachot. Puis je me suis inscrit au P.C.N. Mais je
n'aurais jamais pu faire mes études de médecine si je ne
m'étais pas marié. Je suis entré dans une famille
médicale. A Rennes. J'ai épousé la fille d'un
directeur... Puis j'ai fait ma médecine dans des
conditions normales, tranquillement... Rien à dire sur
cette période...
C'est à Clichy qu'il écrivit le Voyage au bout de la nuit, qu'il
devint Louis-Ferdinand Céline (du nom de sa mère).
Pourquoi est-il devenu écrivain ?
- J'aurais mieux fait d'être psychiatre ! Pourquoi ? Pas
par vocation. Je n'y avais jamais pensé. Mais je
connaissais Eugène Dabit... Il venait d'avoir un gros
succès avec son Hôtel du Nord... J'ai pensé : "
J'en ferais bien autant. Ça
m'aiderait à payer le terme. " Alors je m'y suis mis, à
fond, cherchant un langage, un style chargé d'émotion,
direct... J'ai horreur des phrases... du langage bien
filé... des petites inventions faciles... C'est très dur
de se concentrer... La tête c'est un muscle... Il faut
l'entraîner, tous les jours...
Le livre a fait du bruit. Ça
m'a empêché de faire de la médecine... Je regrette, la
médecine, c'était ma vocation. Je n'aurais jamais dû
écrire... Mon désir était de devenir psychiatre. Cela
aurait mieux valu. J'aurais soigné les fous, dans un
asile. On m'aurait respecté. On m'aurait craint aussi...
Un médecin des fous, on croit toujours qu'il est un peu
fou, lui aussi... J'aurais été bien avec le procureur,
avec les gendarmes, avec tous ces gens-là. On m'aurait
fichu la paix... Le travail m'aurait plu... L'univers de
l'asile, cela fait comme une couche isolante. C'est
parfait. C'est très bien d'être médecin des fous. Vous
êtes utile, vous êtes indispensable ! Tandis que la
littérature... les livres... Voyez où ça mène !
Arno
BREKER.
C'est en 1940, à
l'Institut allemand de Paris, que je fis la connaissance
de Louis-Ferdinand Céline. A cette époque, il comptait
déjà parmi les plus importants écrivains français. Je
connaissais son œuvre écrite
; lui, mon œuvre sculpté.
Céline était de ceux qui, malgré les différents permanents entre la France
et l'Allemagne, aimaient et comprenait mon pays. " La
réconciliation définitive et la coopération
 entre
nos deux pays, voilà qui importe grandement ", me dit-il
lors de notre première rencontre. entre
nos deux pays, voilà qui importe grandement ", me dit-il
lors de notre première rencontre.
Tout de suite, l'envie me
prit de réaliser son portrait, tant les traits,
fortement, spirituellement marqués de son visage, me
fascinèrent d'emblée. Ce qu'il y avait, physiquement, de
particulier chez lui, c'était une divergence entre le
volume de la tête et la maigreur du cou, qu'il avait
décharné - divergence que j'allais équilibrer par un
cache-col comme il en portait toujours vers la fin de sa
vie.
Avant la guerre, je lui
trouvais toujours une grande élégance. C'est seulement
après celle-ci qu'il prit cette allure de bohémien du
XIXème. Comme on le sait, il était entouré d'une
quantité de chats et de chiens, et il vivait dans une
grande bâtisse un peu délabrée, à Meudon. C'est là que
j'allai le voir, encore peu de temps avant sa mort, en
1961.
L'atmosphère de sa maison était typiquement française. Les meubles et les
objets qu'il avait autour de lui se distinguaient par un
air d'immuabilité tant ils semblaient figés sur place
depuis des décennies. La poussière et la patine du temps
s'étaient mis à les couvrir d'un étrange silence.
Cet après-midi là, Céline me
regarda longuement dans les yeux, parla très peu, sembla
véritablement avoir tout dit dans ses livres. Les
quelques mots qu'il prononça eurent trait à l'existence
humaine, à son passage sur terre, à l'éternité.
Quand je pris congé, Céline
me dit : " Ce n'est pas un adieu : nous nous reverrons.
" Lui prenant les mains, je lui répondis, ému : " Mon
cher, mon grand ami, espérons ! "
(Arno Breker, extrait de Hommage à Louis-Ferdinand Céline, BC n° 103,
avril 1991, p. 11).
William
BURROUGHS.
BOCKRIS
- Si je ne me trompe, tu as rencontré Céline peu de
temps avant sa mort ?
BURROUGHS - Cette expédition pour voir Céline a été organisée en 1958
par Allen Ginsberg qui avait eu son adresse par
quelqu'un. C'était à Meudon, de l'autre côté de la Seine
exactement. Nous avons fini par trouver un bus qui nous
a déposés à un carrefour indiquant de nombreuses
directions : " Tout droit, messieurs... " Nous
avons marché sur cinq cents mètres dans ce voisinage de
banlieue en pente, petites maisons minables recouvertes
de crépi effrité - cela ressemblait un peu aux faubourgs
de Los Angeles - et soudain nous avons entendu une
cacophonie de chiens qui aboyaient. Des gros chiens,
vous pouviez le deviner d'après les aboiements. "
Ça doit être là ", a dit
Allen.
Céline est
arrivé en criant après ses chiens, puis il a fait
quelques pas dans l'allée et nous a fait signe d'entrer.
Il semblait content de nous voir et manifestement nous
étions attendus. Nous nous sommes assis à une table dans
une cour pavée à l'arrière d'une maison de deux étages
et sa femme, qui enseignait la danse - elle avait une petite école de danse - a apporté du café.
petite école de danse - a apporté du café.
Céline ressemblait exactement à ce à quoi nous nous attendions. Il
portait un costume foncé, enveloppé d'écharpes et de
châles. De temps en temps on entendait les chiens,
enfermés dans un terrain clôturé derrière la villa, qui
hurlaient et
aboyaient. Allen demanda s'ils avaient jamais tué
quelqu'un et Céline répondit : " Non, je les garde juste
pour le bruit. " Allen lui donna quelques livres,
Howl, quelques poèmes de Gregory Corso et mon livre
Junky. Céline jeta un regard négligent sur les
livres et les mit de côté de façon évidente. Il n'avait
manifestement pas l'intention de perdre son temps. Il
était là dehors, à Meudon. Céline pensait qu'il était le
plus grand écrivain français, et personne ne faisait
attention à lui. Alors vous comprenez, il y avait
quelqu'un qui venait le voir... Il ignorait totalement
qui nous étions.
Allen lui
demanda ce qu'il pensait de Beckett, Genet, Sartre,
Simone de Beauvoir, Henri Michaux, tous les noms qui lui
passaient par la tête. Il agitait sa main fine veinée de
bleu en signe de rejet : " Chaque année il y a un
nouveau poisson dans l'étang de la littérature. Ce n'est
rien, ce n'est rien, ce n'est rien ", disait-il en
parlant d'eux.
- Etes-vous bon docteur ? demanda Allen.
- Ma foi... je me défends, répondit-il.
Etait-il en bons termes avec ses voisins ? Non, bien sûr.
" J'emmène mes chiens au village à cause des juifs. Le receveur des postes
détruit mon courrier. Le pharmacien n'exécute pas mes
ordonnances... " Les aboiements des chiens ponctuaient
ses paroles.
Nous nous
sommes carrément attaqués à un roman de Céline. Et il
nous a dit combien les Danois étaient salauds. Ensuite
une histoire sur un débarquement de bateau pendant la
guerre ; le bateau avait été torpillé et les passagers
étaient hystériques, alors Céline les mit tous en rang
et leur injecta à chacun une bonne dose de morphine ;
ils devinrent tous malades et vomirent partout sur le
bateau.
De l'allée, il nous fit au revoir de la main tandis que les chiens
grondaient et sautaient contre la barrière.
(Victor Bockris, Avec William Burroughs, Notre agent
au bunker, Denoël, 1985, in D'un Céline l'autre, D.
Alliot, 2011, p.1016).
Roland CAILLEUX. AVEC LOUIS-FERDINAND CELINE.
J'arrive chez Céline en avril ou mai 1961, pas
de chien, ce qui me surprend. La maison paraît moins
barricadée. Je sonne ou je ne sonne pas, alors
qu'autrefois il était impossible de pénétrer dans son
blockhaus et qu'il venait lui-même vous ouvrir, l'air
méfiant. Je traverse donc le jardin et je l'aperçois à
la fenêtre. Je passe par-derrière et le trouve toujours
le même, plutôt mieux, bien entendu pas rasé, comment
fait-il pour avoir toujours une barbe de quatre jours ?
Il ne me sers pas du " Cher Confrère " qu'il m'administrait à tout
hasard, ne sachant pas, ayant oublié, ou bien parce
qu'il pensait que ça se fait. Il me tutoie bien entendu,
je lui dis " vous ".
J'étais
bien décidé, puisque j'étais sans Roger Nimier, tout à
fait seul mais bien loin d'imaginer que ce serait ma
dernière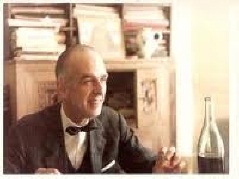 rencontre avec lui, à ne pas laisser s'égarer
l'entretien et à lui parler de ce qui me tenait à cœur,
l'essentiel, à savoir son art, plus précisément son
style.
rencontre avec lui, à ne pas laisser s'égarer
l'entretien et à lui parler de ce qui me tenait à cœur,
l'essentiel, à savoir son art, plus précisément son
style.
J'ai
toujours admiré Céline, c'est pour moi le plus grand
génie français contemporain de la littérature et sans
doute le plus grand génie mondial. Je ne crois pas que
pareil individu, on en voie plus d'un par deux siècles,
il est grand et génial surtout parce qu'il a créé un
langage.
Dieu sait si j'admire Proust et si j'admire le style de Proust, mais
Céline me paraît plus grand. Je vais plus loin, je le
trouve plus grand que Rabelais (qui d'ailleurs ne m'a
jamais passionné, ce qui tient à son langage un peu
désuet, mais surtout à son didactisme, à sa folie
d'énumération, à sa scatologie un peu monotone, à son
côté sorbonnard malgré tout).
De plus,
moi qui ai connu pas mal d'écrivains, j'ai, comme tout
le monde, été déçu quand je les ai rencontrés, à part
Marcel Aymé (mais il parlait peu) et surtout Céline et
Ivy Compton-Burnett. Gide, que j'ai très bien connu,
était différent, dans sa conversation, de son œuvre,
je préférais son œuvre.
Mais ce n'était pas mal. Ivy Burnett a été
merveilleusement intelligente pendant les quatre heures
de conversation que j'ai eues avec elle, mais je ne l'ai
vue que quatre heures. Mais Céline que j'ai vu souvent
et longuement avait, en plus, le même génie verbal quand
il parlait que quand il écrivait. Et c'est ce qui est
unique. Il y avait du phénomène en Céline, tout cela
était on ne peut plus naturel en plus, il n'y avait qu'à
enregistrer sur magnétophone et tous les épigones
pouvaient s'aligner.
Ils sont nombreux. Je me rappelle mon ami Rebatet
catastrophé et pulvérisé d'admiration à l'apparition du
Voyage ; il avait commencé un grand livre et
Céline venait de lui couper l'herbe sous le pied. Je
crois me rappeler qu'il m'a dit avoir déchiré tout ce
qu'il avait écrit. Mais Rebatet n'a publié Les
Décombres et Les Deux Etendards que bien
après Sartre qui reste le plus célèbre des élèves de
Céline. Un élève doué, mais pas très élégant. S'il a mis
en exergue de son premier livre une phrase de Céline, il
n'en a plus beaucoup reparlé depuis. Céline s'en est
chargé.
Queneau avait débuté avant Céline. On n'en parlera pas.
Mais tout le monde est bien d'accord pour constater
qu'avec l'apparition du Voyage il y a eu quelque
chose de changé dans la littérature en France. Un coup
de tonnerre dans un ciel serein. La guerre s'annonçait
par Céline. Et il a fait coup double, quelques années
après un second chef-d'œuvre,
plus prodigieux que le premier. Mort à crédit
paraissait. Gide ne l'avait pas lu (pas plus qu'il
n'avait lu L'Age d'homme de Michel Leiris que je
lui ai fait découvrir également et qu'il n'a pas aimé).
Il m'a dit n'avoir pas pu l'achever, bien sûr. C'était
un Si le grain ne meurt... normal.
Pour Céline, il a commis un article dans La Nouvelle Revue Française
qui n'est pas ce qu'il a écrit de meilleur. Lui qui
repérait les talents inconnus et qui avait une si grande
curiosité aura tout de même passé à côté de Proust qu'il
a refusé pour Gallimard et de Céline car son article ne
parle pas du génie de Céline, mais beaucoup trop de ses
outrances politiques (car je crois que l'article auquel
je fais allusion est consacré à Bagatelles pour un
massacre).
Aragon, dont la compagne Elsa Triolet a traduit le Voyage, livre de chevet de Staline, ne s'est pas non
plus foulé pour rendre hommage au grand homme. Ceci
d'ailleurs n'est qu'un exemple de l'attitude de la
gauche qui avait mis Céline sur le pavois (il avait fait
un discours sur la tombe de Zola avec eux) jusqu'au jour
où Céline partit en U.R.S.S. et en rapporta Mea
culpa.
Immédiatement toute la gauche déchanta. Le génie
n'était plus un génie. Céline n'était plus avec nous, il
avait touché à la hache, il s'était moqué de Prolo-roi
et comment qu'il avait parlé des hôpitaux et des
infirmières soviétiques !
C'est le même phénomène qui a joué contre André Gide lequel présidait les
meetings communistes, côte à côte avec Aragon et ces
Messieurs. Je me souviens de la gueule que faisait André
Gide, obligé de subir un discours idiot d'Aragon tentant
de prouver qu'Apollinaire n'était pas un grand poète
parce qu'il avait eu le malheur d'écrire : " Dieu que la
guerre est jolie. "
Quelque temps après notre Déroulède nous faisait tous chier. Etait-il
pour cela devenu un mauvais poète, c'est la question ?
Donc
j'arrive chez Céline. Et on commence à parler. Droit au
but, je lui dis que je trouve insensé qu'on n'ait pas
encore écrit un grand livre sur son style. Il me répond
:
" Ils peuvent pas, ils savent pas. "
- Enfin, quoi, depuis que je vous ai vu, il a tout de
même paru un bouquin à l'étranger, une thèse en
Sorbonne, un article intelligent ?
- Mon cul. Bien, pas question. Je suis l'affreux. Ils
ont des ordres. Céline c'est de la dynamite. Tu perds ta
carrière si tu parles de moi.
- D'abord ils ne sauraient pas. Regardez, même Poulet,
il vous a pourtant vu assez longuement. Quelle idée
funambulesque de vous avoir fait parler autrement que
vous faites. Il avait qu'à apporter un dictaphone et
puis d'ailleurs ce qu'il vous fait dire, c'est pas ça.
- Mais non, c'est un con. Y a personne je te dis.
- Non il y a pas personne puisqu'on vous admire, on le
sait bien que vous êtes le plus grand, le seul. Marcel
Aymé, Roger (Nimier), ils ne s'y trompent pas. Alors il
doit y en avoir d'autres.
- Il y en aura jamais. Tu vis dans la lune.
- Je vis dans la réalité. C'est tout de même insensé
qu'on déconne à perte de vue à propos de sottises, qu'on
fasse des tartines sur qui vous savez.
Céline se marrant :
- Ah, le nouveau roman : l'Arpenteur.
- Nathalie Radaute.
- Ah, non, il y a rien à faire. Je me demande pourquoi
je continue.
- Pourquoi, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher
de créer.
- Mais pas du tout. Comme du Flaubert : " La littérature
est un godemiché qui m'encule et qui ne me fait même pas
jouir. " Mais c'est pour le fric. D'ailleurs il y a que
ça le travail. Les autres y travaillent pas. Mon père et
ma mère, ils avaient pas d'auto, ils achetaient pas des
antibiotiques, ils partaient pas en week-end, ils
avaient pas le temps ; ils travaillaient. Il faut
choisir : vivre ou travailler. Ils veulent vivre les
cons. Moi je travaille.
- Et bien sûr qu'ils en foutent pas une datte, et qu'ils
préfèrent l'alcool.
- La bite aussi, M... m... le con. Oublie pas.
- L'argent aussi, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire
d'autre ? Eux ils n'ont rien à dire.
- Ben oui, c'est du vent.
- Et puis s'ils avaient quelque chose à dire, ils savent
pas comment.
- Dame faudrait travailler, ça s'apprend.
- Pourquoi qu'y vous lisent pas ? Y réfléchiraient, y
sauraient peut-être comment c'est fait. Moi j'ai jamais
rien lu sur vous, je veux dire sur votre petite musique
comme vous dites. Sinon ça et là, un article de Claude
Jamet... vous vous rappelez ?
- Non, y a rien.
- Si, y a ce que vous avez écrit, heureusement. Et pas
seulement dans les Entretiens avec le professeur Y.
- Mais ça n'intéresse pas. Gaston est près de la ruine.
Tu peux pas savoir ce que je lui coûte. Je le dépouille,
et pas seulement avec mes Entretiens.
- Ça
s'est tout de même bien vendu Nord ? C'est
magnifique, vous avez retrouvé le ton, la grande forme.
C'était déjà pas mal D'un château l'autre.
- Qui c'est qui t'a dit qu'on avait vendu Nord ?
En tout cas c'est pas les picaillons que j'ai touchés.
- En tout cas, c'est épatant. Alors comment vous
travaillez ? Vous écrivez quelque chose ?
- Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi je vois
personne. Personne veut me voir d'ailleurs. Et puis
j'aime pas les
 emmerdeurs.
Ouais, j'écrit, je bosse. emmerdeurs.
Ouais, j'écrit, je bosse.
- C'est la suite de Nord ?
- C'est ça et c'est pas ça. J'y travaillais ce matin je
vais m'y remettre quand tu vas partir.
- Et ça avance ?
- Comme ça. C'est pas facile. C'est un métier.
- En tout cas on n'a pas souvent vu un écrivain qui a
passé par où vous avez passé et qui, à soixante-sept
ans, et bien avant, écrit des bouquins pareils.
- Ils peuvent s'aligner, les autres. C'est chez eux qui
y a la panne de courant, même et surtout chez les
jeunes. Qu'est-ce que tu veux, nous on est d'avant la
fusée, eux y sont d'après.
- Vous croyez qu'il y aura plus de bonhommes qui
aimeront la littérature en France ?
- La littérature peut-être, la musique c'est autre
chose. Y z'ont que leur cul à penser. Tu comprends ils
ont pas de métier, ils sont pas médecins. Ça
va dans les Salons, à des cocktails, ça déconne, ça
déconne... Y z'ont rien à dire, y savent pas. Nous on
est sur terre.
- Et puis s'ils avaient quelque chose à dire, encore une
fois il faudrait aussi qu'ils sachent comment l'écrire.
- Oh ! mais t'es un exigeant. Toi t'es foutu, t'es pire
que d'avant la fusée. Tu crois au travail honnête, à
l'époque du formica ?
- Bien sûr, j'y crois. J'ai qu'à vous regarder.
- Mais je compte pas, je suis jamais cité. T'as lu les
encyclopédies, les grands traités. Tous les noms de la
littérature de tous les siècles et de tous les temps, il
manque pas un moldovalaque, Aragon y renvoie des
tartines sur des grands poètes mongols, des Mongoliens
qui font dans le réalisme socialiste, mais Céline, pas
question. De la merde.
- Et c'est pour quand votre œuvre
à la Pléiade ?
- Ça
sera posthume. (Hélas, c'est vrai).
- J'avais demandé un jour à Gaston, chez Nimier, il y a
de ça 7 ans, quand on se déciderait, après tout y a bien
Malraux et Saint-Exupéry.
- Tiens donc, c'est ça les grands hommes, tu savais pas
?
- J'y ai jamais cru.
Après ça on parle politique.
- Alors c'est pour quand la révolution ?
- T'inquiète pas. Y aura rien avant octobre. Y z'ont
loué dans les petits hôtels.
- Et de Gaulle ?
- De Gaulle : il est sauvé grâce à Bobonne. On a fait la
révolution à cause du Parc aux Cerfs. Lui, y plaît, y
plaît beaucoup. Y baise pas. En fait de gaule... C'est
toujours bobonne par-ci, bobonne par-là. Y l'a trompe
pas il est sauvé. C'est mieux que pour Coty. Il est
fidèle et il la touche pas ; c'est bon, c'est très bon.
Il fait pas de jaloux. T'es jaloux toi ?
- Non, pas de la Présidente.
- Tu préfèrerais Marilyn ?
(Mercure de France, 1985, BC n° 186, avril 1998).
Jean CALLANDREAU , " Rencontres avec... L.F. Céline ",
Artaban n°11, 21 juin 1957.
Le doigt sur la sonnette, pas d'hésitation : les chiens
sont parqués dans un enclos. Une longue silhouette à une
fenêtre du pavillon, de grands gestes du bras, et nous
grimpons péniblement le jardin en pente.
- Monsieur, j'aimerais vous parler de votre nouveau
livre, et je me suis permis...
- Vous êtes journaliste ?
- Etudiant... Mais comme vous avez accordé un entretien
à L'Express, j'ai pensé que peut-être...
 -
Ah ! Ah ! L'Express... Ce sont des gens sérieux : ils
sont venus avec une secrétaire-dactylographe et sa
machine, un photographe... Terrible, la secrétaire...
n'a pas laissé échapper un mot de ce que j'ai dit...
Tout seul, la tête embrouillée, j'ai bafouillé, je me
suis mal défendu contre leur machine enregistreuse.
Tenez, ils l'avaient posée là, sur cette table... Mais
vous venez les mains vides dans les poches...
connaissez-vous seulement la sténographie ? -
Ah ! Ah ! L'Express... Ce sont des gens sérieux : ils
sont venus avec une secrétaire-dactylographe et sa
machine, un photographe... Terrible, la secrétaire...
n'a pas laissé échapper un mot de ce que j'ai dit...
Tout seul, la tête embrouillée, j'ai bafouillé, je me
suis mal défendu contre leur machine enregistreuse.
Tenez, ils l'avaient posée là, sur cette table... Mais
vous venez les mains vides dans les poches...
connaissez-vous seulement la sténographie ?
Au fond, ce serait beaucoup mieux : vous pourrez raconter n'importe quoi
sur mon compte. C'est ce que je dis toujours : qu'on
raconte n'importe quoi sur moi... ça confirme ma légende
de traître halluciné délirant... Et puisque vous êtes
étudiant et pas sérieux, je vais vous faire cadeau du
bouquin... Voilà, tenez, et asseyez-vous dans ce
fauteuil... là, bien à l'ombre du parasol...
Approchez-vous un peu, moi je reste à l'intérieur, je ne
suis pas jeune comme vous pour supporter la chaleur.
Il s'installe derrière un battant de la porte vitrée,
goguenard, détendu. Jusqu'ici, je n'ai pas vu
grand-chose qui ressemble à la haine. Il est avec des
amis, nous le dérangeons, il nous accueille avec le
sourire et nous offre son livre !
- Allez-y en confiance... De quoi voulez-vous parler
? Mes amis peuvent tout entendre. Vous pouvez dire ainsi
que vous m'avez trouvé en compagnie d'un capitaliste qui
possède une 2 CV et d'une femme qui montre ses jambes
nues au soleil... Preuve de mon immoralité.
Les amis sont indulgents, eux aussi. j'accapare la conversation, et
ils ne s'en offusquent pas.
- Vous voulez parler de mon livre ? Non, non, rien à
faire, je n'ai rien à dire. Lisez-le, ça suffit, et si
vous voulez publier quelque chose, ne vous gênez pas,
piquez dedans, n'importe où, publiez-le intégralement,
ça fera râler Gallimard... Prêtez-moi tous les propos
que vous voulez, inventez ! Montrez bien le personnage
que je suis... pornographe obsédé, répugnant... toute la
gamme... les aveux... que c'est bien moi qui ai tout
vendu, la ligne Maginot, tout... pas Diên Biên Phu, tout
de même !... Vous savez l'histoire de Rochefort à Nouméa
: le gendarme devait faire tous les jours un rapport sur
sa conduite et, comme il ne savait pas écrire, le
gendarme, c'était Rochefort qui rédigeait le rapport et
se peignait lui-même sous les traits les plus noirs...
Pareil, je vous dis : je reconnais, j'avoue mes crimes,
tout...
(Cahiers Céline 2, Gallimard, 1982).
Jacques
CHANCEL, " L.F. Céline : "
La télévision achèvera l'esprit de l'homme, comme la
fusée lui simplifiera l'existence ", Télémagazine,
n°117, 19-25 janvier 1958.
- Vous me demandez de vous dire ce que je
pense de la télévision. Eh bien ! Savez-vous que vous
avez beaucoup de courage ? Vous êtes venu jusqu'à moi.
Vous vous compromettez. Je suis une ordure pour le monde
entier, je suis le réprouvé, le lépreux de l'endroit. On
m'accuse d'avoir tout vendu à l'ennemi... même les plans
de la ligne Maginot.
Je suis passé moi aussi sur le petit écran. Pierre Dumayet a présenté mon
livre D'un château l'autre. J'étais très content,
car je savais que mon bouquin se vendrait mieux après.
C'est le plus important. Il faut vivre et je n'ai que
des dettes.
Dumayet est un type bien. C'est le seul, d'ailleurs. Il n'a pas craint de
m'interviewer devant les caméras et je suis navré de lui
avoir causé des ennuis. Mon apparition a été diversement
commentée. Il y a eu interpellation à la Chambre : "
Il est étonnant qu'on laisse passer ce traître ",
disait l'un des idiots.
(...) Revenons à la télévision. Elle est utile pour les gens qui ne
sortent pas, pour ma femme par exemple. J'ai un poste,
au premier étage, mais je ne monte jamais. C'est un
prodigieux moyen de propagande. C'est aussi, hélas ! un
élément d'abêtissement en ce sens que les gens se fient
à ce qu'on leur montre. Ils n'imaginent plus. Ils
voient. Ils perdent la notion de jugement et ils se
prêtent gentiment à la fainéantise.
La TV est dangereuse pour les hommes. L'alcoolisme, le bavardage et la
politique en font déjà des abrutis. Etait-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose ?
nécessaire d'ajouter encore quelque chose ?
Le téléphone sonne.
- Allô !... C'est Toto, répond une voix criarde.
Toto, le perroquet, regarde son maître.
- Vous reconnaissez la puissance de la télévision.
Vous ne l'aimez pas. C'est votre droit, mais pourquoi ne
regardez-vous jamais ses programmes ?
- Le petit écran fait triste. Ce noir et blanc, c'est un
faire-part. Les images peuvent m'intéresser, mais les
commentaires ne peuvent être qu'agaçants.
(...) Avant le parlant, Charlie Chaplin était admirable. Aujourd'hui, il
est minable. Il s'obstine maintenant à vouloir faire de
la philosophie. Il a un message. C'est drôle, n'est-ce
pas ?
Tout comme la littérature, la télévision a besoin d'un style. L'éloquence
naturelle n'a sa véritable raison que dans le discours
politique, c'est-à-dire chez les ridicules. Croyez-moi,
c'est dur de faire marrer une feuille de papier. C'est
une pierre tombale avec une épitaphe : ci-gît l'auteur.
Les poètes - y en a-t-il encore ? - doivent lire souvent
sur la surface lisse de leur récepteur : ci-gît le
réalisateur. Alors seulement, ils ont compris.
Je suis un malheureux. Je ferais n'importe quoi pour rembourser mes
dettes, même une émission de télé. Quel bruit cela
ferait : " En direct de chez Céline ! " Si les
autorités supérieures sont d'accord, j'ouvre toutes
grandes mes portes aux caméras.
On m'a tout volé : mon appartement, 4 rue Girardon, mes meubles, sept
manuscrits, mon honneur. Je suis perpétuellement menacé.
" On vous tuera ", me dit-on.
Tous ceux qui m'ont volé sont, au moins, commandeurs de la Légion
d'honneur. Autrefois on pendait les voleurs aux croix.
Aujourd'hui, on pend des croix aux voleurs.
Et chacun est content. Merveilleux pays que ce pays de France. Je ne suis
qu'un bouffon. Paul Léautaud est mort. Il fallait un
pauvre qui pue. Me voilà.
- Que demandez-vous à la télévision ?
- Rien. Elle ne peut rien m'apporter. Si elle faisait
mieux vendre mes livres, elle serait merveilleuse, mais,
hélas ! je suis un maudit et Françoise Sagan est jeune.
Ah... celle-là ! Elle raconte des choses banales et elle
tire à un million d'exemplaires. Son roman ? Ni fait ni
à faire, immensément abject.
Donnez-moi de la publicité. Je vous démontre immédiatement que
l'abbé Pierre et le docteur Schweitzer ne sont que des
petits garçons. Maurice Barrès disait : " Il n'y a
pas de martyrs, il n'y a que des martyrs reconnus. "
Moi, Céline, je n'ai jamais été reconnu.
La télévision est un de ces moyens de publicité. Elle peut faire le
meilleur et le pire. Ah... que le monde est ridicule !
Dès qu'ils vieillissent, les hommes veulent s'admirer au
cinéma. Ils intriguent pour passer rue Cognacq-Jay.
Plus, ils ont une envie folle du bicorne. Et ainsi de
temps en temps, on " fabrique " un Académicien.
Mercredi dix février 1960, Jacques d’ARRIBEHAUDE
en visite à Meudon.
Coup de
fil consterné de Guenot. Le gros magnétophone du centre,
qu’il a eu tant de peine à obtenir et à coltiner, a
foiré. Toute la conversation si libre et réussie chez
Céline, qui nous recevait aimablement chez lui le samedi
6 à Meudon, à peu près complètement inaudible ; et quand
par hasard on entend, les cris perçants de la perruche
couvrent tout la plupart du temps. La poisse.
Heureusement, il nous a à la bonne. Nous allons remettre
ça le 20 de ce mois. Avec un bon appareil cette fois. Et
des bandes magnétiques neuves qu’on essaiera d’abord.
Cet essai raté vaut au fond une répétition et nous
permet d’affiner les questions et d’aller plus
directement à l’essentiel. L’idéal serait de pouvoir
tirer de ses réponses de quoi accompagner et commenter
une sorte d’autoportrait filmé, à l’aide des paysages et
des rues qu’il a décrits ou ce qu’il en reste.
Guenot lui ayant dit que je sortais de l’hôpital, il
s’est inquiété de ma santé avec une attention
confondante, et a voulu à toute force m’installer dans
un « crapaud » louis-philippard bordé de coussins dans
la grande pièce encombrée où il travaille, au premier
étage, d’où l’on distingue tout Paris des deux fenêtres.
Céline a désigné une maigre chaise à Guenot qui s’y est
planté, son lourd magnétophone sur les genoux, tandis
que lui-même prenait place sur ce qui est apparemment
son fauteuil habituel, un Louis XIII « os de mouton » à
tapisserie, visiblement authentique. J’ai remarqué tout
de suite la rangée complète de l’Encyclopédie Larousse
1900 en trente et un volumes, où je me plongeais souvent
dans mes voyages imaginaires à la bibliothèque de
Bayonne, et dont il nous a fait grand éloge.
« On y trouve à peu près tout, et dans les plus
petits détails, historiques, géographiques et
scientifiques, pour l’époque bien entendu, et c’est ça
qui est intéressant, mais j’ai cherché en vain un des
plus grands botanistes et animaliers du siècle dernier,
un écrivain de tout premier ordre d’ailleurs, il n’y est
pas : Toussenel ! Vous connaissez ? »
Devant mon air ahuri et le silence de Guenot, il
embraye aussitôt : « Outre ses histoires d’animaux,
toutes admirables, Toussenel a écrit aussi, en 1847,
notez ça : Une nouvelle féodalité : les Juifs, rois
de l’époque ! Un grand socialiste et un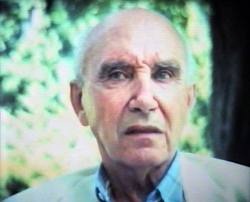 grand
méconnu. Il paraît qu’on le trouve encore sur les quais,
chez des bouquinistes. Mais j’ai cherché tout aussi
vainement, figurez-vous, la petite duchesse de Berry, la
fille du Régent. Dans ces trente et un gros volumes, pas
une ligne ! Il y a comme ça des lacunes bizarres, on se
demande pourquoi… je voulais savoir ce qu’on disait de
ses relations avec son papa le Régent. Saint-Simon ne
voulait pas y croire, mais les chansons du temps
n’étaient pas tendres… » grand
méconnu. Il paraît qu’on le trouve encore sur les quais,
chez des bouquinistes. Mais j’ai cherché tout aussi
vainement, figurez-vous, la petite duchesse de Berry, la
fille du Régent. Dans ces trente et un gros volumes, pas
une ligne ! Il y a comme ça des lacunes bizarres, on se
demande pourquoi… je voulais savoir ce qu’on disait de
ses relations avec son papa le Régent. Saint-Simon ne
voulait pas y croire, mais les chansons du temps
n’étaient pas tendres… »
Tout était sur ce ton-là : la plus grande liberté
dans la plus grande confiance. Il a vu nos intentions,
aux antipodes de la haine imbécile dont on le poursuit.
A peine une question jaillissait-elle qu’il partait
comme une fusée, plein de verve amusée, souvent
intarissable. Mais le rire s’arrête dès qu’il est
question de l’épreuve de la guerre, des malentendus, des
terribles inimitiés qui ont suivi. Il continue de
ressentir cela, de le remâcher péniblement, mais il
exagère quand il affirme que l’opprobre a été total, que
tout le monde lui a tourné le dos sans exception, ce
n’est pas vrai de Marcel Aymé et de beaucoup d’autres
parmi lesquels de grands artistes, or, à cette remarque,
il hoche la tête et ne répond pas, enfermé dans cette
désolation muette qui m’a tant frappé à la première
vision que j’ai eue de lui. Il faut alors le relancer
sur autre chose, et il s’y prête d’ailleurs de la
meilleure grâce du monde, retrouvant aussitôt son
ironie, ses imitations de snobs et de toqués, sa
gouaille et une sorte d’enjouement irrésistible.
Les « n’est-ce-pas », ou « spâ », qui
jalonnent sa conversation, correspondent j’imagine à ses
fameux points de suspension, mais risquent d’encombrer
l’enregistrement. Peu importe. Il prétend trimer à
l’écriture uniquement pour payer sa dette (six millions)
à Gallimard, et que ça ne l’intéresse pas. Autrefois
aussi, il disait n’avoir écrit le Voyage qu’aiguillonné par le succès de Dabit, et dans l’idée
que ça lui paierait un logement. En réalité, il lui
reste à terminer son œuvre et il emploie tout ce qui lui
reste de force et de vitalité.
Qu’en est-il de cette balle qui se trimbalerait dans
sa tête depuis 14 ? De la blague évidemment. Un moyen de
se défaire des emmerdeurs et d’écarter les fâcheux. Mais
qu’il souffre de maux de tête et d’insomnie, son visage,
ses traits en portent la marque. Pensionné de guerre !
Médaille militaire ! Impossible de lui dire que
moi-même… Encore plus impossible de lui raconter que je
suis, minus inexistant, affligé de cette manie
écrivassière et ridicule, auteur de livres inconnus qui,
malgré tout, pourraient peut-être l’amuser. Tout de
même, j’ai senti une onde favorable, une sorte de
connivence amicale, dès qu’il a su que j’étais à la
veille de regagner l’Afrique, et appris mon long séjour
au Tchad de 51 à 54, et mes voyages en Indochine. Le
côté Robinson. En partant, et alors que Guenot, ployant
sous le monstrueux appareil chargé en bandoulière, avait
déjà franchi le seuil, il m’a retenu par la manche et
ses yeux attentifs se sont plantés dans les miens,
tandis qu’il prononçait mon nom en détachant les
syllabes : « Un vieux nom du Sud-Ouest, n’est-ce
pas ? Dites-moi si je me trompe.
- C’est juste, docteur, Aquitaine, Sud-Gascogne et
Navarre. »
Dieu sait pourquoi la consonance de mon patronyme
et son origine paraissait l’enchanter. Comme s’il se
réjouissait de voir en moi un plouc de terroir vrai de
vrai, à tout jamais indécrottable. Une sorte de
parenté ? Il souriait jusqu’aux oreilles d’un air si
curieusement entendu que j’ai éclaté de rire. En me
serrant la main assez longuement, il s’est penché vers
moi pour murmurer : « Revenez quand vous voulez, et
surtout n’allez pas en Afrique que si vous êtes bien
retapé. »
- C’est entendu, docteur. »
On aurait pu encore continuer longtemps comme ça,
mais Guenot m’attendait devant le portail.
(Complainte
mandingue, éd. L’Age d’Homme, Coll. Au cœur du monde.)
Jacques d'ARRIBEHAUDE
:
relate dans son Journal sa première visite à Céline, à
Meudon. C'était le mercredi 30 janvier 1960. Rencontre
qui sera suivie par d'autres, suscitées notamment par un
projet d'adaptation cinématographique de " Voyage au
bout de la nuit " que devait financer Napoléon
Murat.
" Cet après-midi, vers cinq heures, nous étions
donc à Meudon, route des Gardes, chez Louis-Ferdinand
Céline. Ce projet s'est noué en fait pendant le tournage
de Country Life in England, il y a eu un an cet
automne, dans la Savernake Forest. Lefranc, patron du
Centre audiovisuel de Saint-Cloud, m'avait désigné après
un stage comme assistant auprès de Guenot, agrégé
d'anglais et responsable de l'Education nationale, René
Porcel réalisateur au cachet, et Kid, sa femme,
script-girl en terminale alors de l'IDHEC. A peine
avaient-ils connaissance de Céline, rejeté des
programmes dans l'enflure de malédiction que me serinait
déjà ce pauvre Adolphe à bord de notre rafiot, et
considéré partout comme la pire ordure imaginable.
Cela n'a pas été une mince affaire de renverser ce
cliché, mais l'intérêt de Guenot, que je savais ouvert,
n'a jamais faibli, et il a fini par marcher à fond. A
l'entrée, une plaque de cuivre : DOCTEUR L.-F.
DESTOUCHES. La maison, ouverte sur Paris que l'on domine
superbement. Nous poussons le portail et cherchons
vainement l'entrée de cette grande bâtisse qui pourrait
être fort belle mais qui, avec ses volets clos, ces murs
grisâtres, dégage tout de suite une impression de
tristesse et d'abandon. J'imagine que, derrière, il y a
peut-être un jardin plus accueillant et la véritable
entrée. Nous poussons donc un nouveau portail,
distinguons un amas confus de caisses, un bariolage sur
le mur. Là derrière, une porte vitrée, et derrière cette
porte, une grande forme assise, immobile : Céline, que
nous reconnaissons aussitôt. Nous nous approchons. Il
porte une lourde robe de chambre d'un rouge pisseux qui
me rappelle celle de mon père, et ce qui frappe avant
tout, ce sont peut
 être ses pieds, d'énormes pieds, vraiment monumentaux,
comme gonflés dans leurs pantoufles, comme s'il avait,
sous ses pantoufles, deux ou trois
paires de godillots. Des pieds de clochard, de vrais
panards de catastrophe au bout de toutes les nuits
imaginables. Il semble qu'il soit ainsi, inerte, vissé
au sol par ces pieds de plomb, dans une songerie
désespérée, depuis des siècles. Et nous voilà
impressionnés devant cette image qu'il ne se soucie
visiblement pas de livrer. Nous nous faisons l'effet de
voyeurs ignobles, car c'est infiniment plus saisissant
que la découverte inattendue d'ébats intimes. Il nous
voit avec un peu de surprise, fait un geste d'appel vers
l'intérieur et, sans bouger de son fauteuil, ouvre à
demi la porte. être ses pieds, d'énormes pieds, vraiment monumentaux,
comme gonflés dans leurs pantoufles, comme s'il avait,
sous ses pantoufles, deux ou trois
paires de godillots. Des pieds de clochard, de vrais
panards de catastrophe au bout de toutes les nuits
imaginables. Il semble qu'il soit ainsi, inerte, vissé
au sol par ces pieds de plomb, dans une songerie
désespérée, depuis des siècles. Et nous voilà
impressionnés devant cette image qu'il ne se soucie
visiblement pas de livrer. Nous nous faisons l'effet de
voyeurs ignobles, car c'est infiniment plus saisissant
que la découverte inattendue d'ébats intimes. Il nous
voit avec un peu de surprise, fait un geste d'appel vers
l'intérieur et, sans bouger de son fauteuil, ouvre à
demi la porte.
-
" Qu'est-ce que c'est ? - Nous venons de la part de Mme
Laurier, dis-je. - Ah ! Mme Laurier. " Il tourne la tête
vers l'intérieur, fait un nouveau geste. - " Je vais
appeler ma femme. - C'est vous que nous venions voir,
dis-je encore. Nous voulions vous demander de nous
accorder un entretien. " Il lève vers nous un regard où,
dans la fatigue et la détresse, brille un éclair de
ruse. - " Je n'entretiens pas. " Guenot intervient : "
Nous avons le projet de faire un film sur Paris à
travers certains extraits de vos livres. - " Oh ! les
images, ça n'intéresse personne, et il faut de l'argent.
- Nous avons l'argent d'un producteur " dis-je sans
vergogne.
Sa femme est arrivée, en collants noirs, interrompant
sans doute une leçon de danse. Elle a bien quinze ou
vingt ans de moins que lui. Elle nous dit : - " Il est
très fatigué en ce moment, il a une balle dans la tête
depuis la guerre de 14, excusez-le, il vaut mieux lui
écrire, il vous répondra. - C'est ça, dit Céline,
écrivez-moi votre projet. " Il fait un geste de la main,
comme pour écrire ou aussi bien nous balayer.
Ses cheveux encore abondants, même pas grisonnants, lui
tombent dans le cou, mais son visage, ces formes
gisantes sur le fauteuil, sont d'un vieil homme très
accablé. Il semble ne s'être pas rasé depuis deux ou
trois jours et l'on ne saurait dire si ce qui luit sur
son visage est une sueur maladive ou la crasse, ou les
deux à la fois. C'est vraiment devenu un personnage de Beckett, un Molloy ou un Godot, un peu angoissant, avec
un mélange inoubliable de détresse et de malice au-delà
de tout désespoir. Je pense aussi à un vieux roi déchu
ayant touché le fond de la misère humaine, c'est King
Lear, route des Gardes, jailli sous mes yeux du souffle
de Shakespeare, et tel qu'il m'apparaissait voilà neuf
ans en pays sara, territoire du Tchad, quand je lisais
la pièce à ma petite garce noire, Madeleine N' Doumba,
qui m'écoutait en ouvrant de grands yeux, poussant des
exclamations et m'interrogeant sans cesse sur ce drame
dont elle me décrivait de sensibles équivalents en des
tribus voisines, tout en m'assurant que seuls les Blancs
pouvaient se montrer aussi horriblement méchants que les
filles de ce grand et malheureux chef.
Beckett, un Molloy ou un Godot, un peu angoissant, avec
un mélange inoubliable de détresse et de malice au-delà
de tout désespoir. Je pense aussi à un vieux roi déchu
ayant touché le fond de la misère humaine, c'est King
Lear, route des Gardes, jailli sous mes yeux du souffle
de Shakespeare, et tel qu'il m'apparaissait voilà neuf
ans en pays sara, territoire du Tchad, quand je lisais
la pièce à ma petite garce noire, Madeleine N' Doumba,
qui m'écoutait en ouvrant de grands yeux, poussant des
exclamations et m'interrogeant sans cesse sur ce drame
dont elle me décrivait de sensibles équivalents en des
tribus voisines, tout en m'assurant que seuls les Blancs
pouvaient se montrer aussi horriblement méchants que les
filles de ce grand et malheureux chef.
A peine dehors, nous sommes allés chez Guenot torcher
ensemble une lettre chiadée au grand homme, qu'il a
aussitôt tapée sur sa machine. Quoi qu'il advienne, la
vision que nous avons eue est ineffaçable. Je ne cesse
de penser à l'illumination de mes dix-huit ans, à la
lecture de cette œuvre prodigieuse et au rêve obsédant
qui m'agitait, en pleine guerre, entre Cagliari et
Naples : rencontrer un jour, coûte que coûte, cet
extraordinaire génie du langage ! Quel souverain regard,
aussi, dans son irrésistible drôlerie, quelles vues
prophétiques, quel extraordinaire souffle créateur ! Par
dessus tout, le bonheur, au fil de ces pages, de ne plus
se sentir si affreusement seul à lutter contre
l'abrutissement de ce pauvre monde, à résister de toutes
ses forces à tant de connerie mortelle !
Sa voix, son accent, ont une sorte de distinction, un naturel fort
éloigné du vulgaire. Il n'y a pas que l'âge, ou la robe
de chambre, qui me rappellent mon père. Cette façon de
se murer dans un paysage intérieur très ancien, en
tournant le dos au monde. Le Paris des ouvriers et des
calicots d'avant 14, celui que, bien avant, Renoir a
transfiguré dans des couleurs heureuses, mais qui était
bien le Paris des bourgeois féroces de Zola, des
révoltes anarchistes, terriblement dur aux pauvres, si
j'ai bien écouté mon père, et avec pourtant ces coins de
fraîcheur, ces moments de joie que nous avons du mal à
imaginer tellement cette forme de vie nous paraît
effroyable.
Il y a des trous mystérieux dans son œuvre, et qui
pourtant sont révélateurs. L'enfance et la jeunesse. La
façon dont, blessé et pensionné de guerre, il put
étudier la médecine et s'orienter dans cette voie. C'est
cela, entre bien d'autres choses, que nous aimerions
éclairer. "
(Extrait de Complainte mandingue,
Journal 1960-1962, L'Age d'Homme 1999).
J.P. d'ASSAS.
Céline en pantoufles.
En pantoufles...
Non, ce n'est pas tout à fait exact.
Il avait des souliers, de bons souliers de terrien, sur lesquels
il appuie sa lourde stature, bien campée.
Il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, vous vous dites :
- Tiens, celui-là c'est un type.
Ce que vous mettez dans ce mot est vague, indéterminé, contradictoire
peut-être, mais vous avez la sensation d'être devant une
force de la nature.
Céline est un gars solide. C'est la première impression qu'on ressent.
Lorsque je l'ai vu dans la pénombre d'un jour finissant de novembre, c'est
ce qui m'a frappé le plus, et puis après, plus tard,
sous la lampe : le regard.
Un regard calme, profond qui pénètre et vous échappe tout à la fois. Un
regard de clinicien qui vous juge, fait votre diagnostic
et, par habitude professionnelle, vous ment, vous ment
par devoir, par pudeur aussi.
Céline
m'emmène sur son balcon. C'est la première chose qu'il
fait voir. Pas qu'il soit fier de la vue immense que, du
haut de ses trois cents mètres d'altitude, au sommet de
la butte Montmartre, il découvre sur Paris, au delà de
Paris, non, mais comme préface à toute discussion avec
nous.
- Emplissez vos yeux de l'horizon, semble-t-il dire, et Paris c'est cela,
et la France, là-bas, au delà.
L'habitude des horizons, peut-être, il est Breton, donc un peu marin.
Pour atteindre à ce balcon, il faut traverser un petit salon. Sur le
parquet : la provision de pommes de terre et des
oignons.
- Ça ne fait rien, marchez dessus.
On hésite tout de même, on s'empêtre. Céline rit.
Mais sur le balcon, il y a des pots de fleurs, j'en effleure un au
passage, alors Céline se fâche presque.
- Ah ! non, pas les fleurs.
 C'est
parti comme cela, nature. Allons, nous étions plusieurs
à nous en douter, Céline est un poète. Pour tout le
reste, il s'en moque, mais les fleurs, ça non. C'est
parti comme cela, nature. Allons, nous étions plusieurs
à nous en douter, Céline est un poète. Pour tout le
reste, il s'en moque, mais les fleurs, ça non.
Sous la
lampe, dans la petite chambre de Céline ; le lit à
droite, une armoire à gauche, deux ou trois petites
tables curieusement surchargées de feuillets couverts de
son écriture abrégée, illisible, comme une vraie
écriture de médecin. Feuillets attachés ensemble par des
pinces à linge, chargés de la dynamite des pamphlets qui
iront demain faire sauter une nouvelle imposture, un
faux bonhomme, un conformisme désuet...
La question qu'on vous pose toujours lorsque vous dites : " J'ai vu
Céline " c'est : " Est-ce qu'il parle comme il écrit ? "
Mon Dieu ! non. Non, mais il parle comme tout le monde, c'est un Monsieur
bien poli, bien élevé qui n'a pas l'intention de vous en
mettre plein la vue ; mais sitôt qu'il s'attaque à une
de ses têtes de jeu de massacre, alors là, il lâche le
paquet, il parle comme il écrit, oui, et ça fait du
bruit, le regard suit le mouvement, le corps se balance
comme pour ramasser la force. Ça
va mal, très mal.
Céline,
dit-on encore, qu'est-ce que c'est que ce nom-là ?
Un jour même, croyant le vexer, on lui a dit :
- C'est un nom de femme.
Le gaffeur ! C'était un nom de femme, en effet. Le nom de sa mère.
- Moi, c'est Louis, mon père c'était Ferdinand, ma mère Céline,
explique-t-il, alors j'ai dit : comme ça il y aura toute
une famille.
Il y a quelque chose que je voudrais dire encore, je ne sais pas s'il
aimera ça, mais je le dis tout de même :
Le pamphlétaire aux milliers d'éditions, savez-vous ce qu'il fait ?
Il vit dans un cinquième à Montmartre, avec un radiateur à gaz. Tous les
jours, vous m'entendez, tous les jours, il fait trois
heures de voyage aller-retour pour aller dans un
lointain dispensaire de banlieue soigner ses malades.
C'est là sa force. La nature humaine, il ne la voit pas
à travers les livres, les journaux ou les reportages
rapides, il palpe l'humanité souffrante tous les matins.
Ça c'est une école.
Comme
j'allais partir, il a eu ce mot qui résume toute une vie
bâtie sur un courage tranquille et plein d'humour :
- Ça ne fait rien, on sera peut-être tous
pendus, mais on aura bien rigolé !
Bien rigolé de tous les tordus, les crapules, les pas propres.
Au revoir, Céline.
(BC n° 8, avril 1983, p. 4).
Georges de CAUNES.
Le lendemain
de ma visite au ministre des Affaires étrangères, par
l'entremise de Marie Laurencin et du peintre Gen Paul,
je rends visite à maître Mikkelsen, avocat de Céline
pour qui je dépose une lettre, le priant de me recevoir
le lendemain. Céline, qui a rejoint Sigmaringen à la
suite de Pétain après août 1944, se trouve sous le coup
de l'article 75 du Code pénal, condamnant l'intelligence
avec l'ennemi. Comme beaucoup d'autres collaborateurs,
c'est au Danemark, pays neutre sans traité d'extradition
avec la France, qu'il a trouvé refuge. La réponse se
fait attendre, et ce n'est que la veille de mon départ
que, prenant le train pour Korsor où il réside, à deux
heures de Copenhague, je rencontre l'écrivain exilé.
En fait
d'interview, j'en suis réduit à écouter un long et
véhément monologue où l'écrivain, à ma première allusion
au Voyage au bout de la nuit, se répand en
invectives sur le compte de Gallimard : " Le Voyage au
bout de la nuit est tombé dans le bidet de mon
éditeur ! Aragon et Elsa ont traduit le Voyage en
1936 sur demande des Soviets, et cela leur a bien
profité. On me faisait alors de grosses avances, on
voulait que je remplace Barbusse ! Maintenant on
trafique le Voyage en douce. Pendant la guerre,
quand je gagnais un million avec mes livres, je versais
six cent mille francs d'impôts à M. Pétain, mais depuis
cinq ans je n'ai plus gagné un sou ! C'est une
monstruosité de m'empêcher de gagner ma vie ! De toute
façon, je ne veux rien publier avant que mes livres
ressortent. Gallimard m'a dépêché un Mascarille pour me
soutirer des manuscrits, mais je ne lâcherai rien ! Mon
éditeur est une putain qui trait mes livres comme des
vaches ! "
 Puis Céline se désigne lui-même et se lamente : "
Mes ennuis m'ennuient ! J'ai cinquante-cinq ans et 75 %
d'invalidité de guerre, celle de 1914. J'ai même eu la
Croix ! Seulement j'ai un article 75 au cul et on en
profite pour me dépouiller ! "
Puis Céline se désigne lui-même et se lamente : "
Mes ennuis m'ennuient ! J'ai cinquante-cinq ans et 75 %
d'invalidité de guerre, celle de 1914. J'ai même eu la
Croix ! Seulement j'ai un article 75 au cul et on en
profite pour me dépouiller ! "
Il me montre un carnet d'autobus, dérisoire : " Pour moi, d'ici à
Paris, il y a trois heures d'avion et quinze ans à
Fresnes ! Et pourtant il n'y a rien dans l'acte
d'accusation ! J'ai juste demandé que les youpins ne
nous égratignent pas ! "
Je l'interroge sur ses espoirs en une amnistie : " Je ne crois pas
à l'amnistie. La France, nation légère et dure, n'est
pas le pays de l'amnistie, disait Voltaire. Et puis de
quoi ça aurait l'air, un grand-père en prison ? Est-ce
un exemple pour les petits-enfants ? Je suis hors la loi
et pourtant je révère foutre Dieu énormément la IVe
République que je ne connais pas ! Moi, je suis pour la
légalité ! Vive les gendarmes ! l'ordre ! la méthode !
Vive celui qui me rendra mes droits d'auteur et une
place au Père-Lachaise où est ma pauvre mère ! "
Céline
attendait la visite imminente d'un professeur américain
de littérature comparée, universitaire d'origine juive.
" Il me compare à Dreyfus ! me lançait Céline,
brandissant l'une de ses lettres. Voici ce qu'il
m'écrit : " Je ne vois pas pourquoi, moi, je ne
défendrais pas un Aryen ! "
Deux jours après ma visite, le professeur Milton Hindus, de
l'université de Brandeis, venait passer trois semaines
auprès de l'écrivain, porté par l'admiration et la
curiosité. L'homme qui rêvait d'une grande rencontre
intellectuelle devait repartir de Copenhague déboussolé
et meurtri. " C'est une vipère, conclut-il dans son
journal personnel. Il est plus que maboul comme le
conjecturait Gide. Une seule chose l'intéresse :
l'argent ! "
Nous avions rencontré le même homme, instable, éructant, grand écrivain
sans aucun doute, mais avec qui il semblait
provisoirement impossible de trouver un langage commun.
Le lendemain, 16 juillet 1948, après avoir acheté un manteau de phoque
pour Benoîte, je prends le train pour Paris, de retour
enfin du plus lointain des pays lointains.
(Georges de Caunes, Imarra, aventures groenlandaises, Ed. Hoëbeke,
1998, in D'un Céline l'autre, D. Alliot, 2011, p.887).
Visite de
Pierre DESCARGUES (La Tribune de Lausanne)
« Ainsi parle L.F. Céline qui fait cette semaine sa
rentrée littéraire » 2 juin 1957.
« Vous
m’excuserez, dit le docteur, il faudra tout à l’heure
que je vous laisse un instant : j’ai des artichauts sur
le feu. »
On sonne à la porte. Le docteur se penche à la fenêtre
pour voir s’avancer dans le jardin une petite fille et
sa mère. « Vous voyez, reprend-il, je sers aussi de
portier. Je surveille qui vient et qui va. Il y a un
cours de danse à l’étage, le cours Almanzor. C’est ma
femme qui le tient. Cela fait pas mal d’allées et
venues. »
Il est assis à une table, haute comme une table à
dessin, couverte de papiers retenus par des pinces à
linge. Il y en a partout de ces pinces à linge qui
mettent de l’ordre dans les manuscrits du docteur.

« Je me demande bien pourquoi vous êtes venu. Je
garde la porte, je reçois et visite quelques malades,
très rares. Je vais faire le marché. Je fais cuire des
artichauts et des nouilles. Je vis péniblement. Oui,
oui, oui. » Sa voix traîne, égale. Il répète
tranquillement en regardant par la fenêtre : « Je me
demande vraiment pourquoi vous êtes venu. » Et,
soudain, il me lance : « Je suis un styliste,
monsieur. Est-ce qu’on s’intéresse à un styliste ? C’est
fini, ça. Les gens aiment lire les journaux. Etre
styliste, ce n’est pas un métier. »
Je lui rappelle que va paraître dans quelques
jours chez Gallimard un roman de Céline intitulé D’un
château l’autre, qui marque sa rentrée littéraire
[…]
- Rentrée littéraire ? Vous voulez rire,
reprend-il. Je me fiche pas mal de ma rentrée
littéraire. Ça m’est bien égal qu’on me lise ou qu’on ne
me lise pas. Je suis là, à ma table, à travailler comme
une brute, à reprendre, reprendre sans cesse ce style
que vous trouvez si « spontané ». Quatre-vingt
mille pages, j’ai écrit pour en arriver aux 800
feuillets qui vont donner 300 pages dans le livre. Mais
à quoi bon s’acharner ? Si j’avais des rentes, monsieur,
je serais bien heureux d’être le petit vieux qui va
faire ses petites promenades et auquel personne
n’accorde attention.
- Pourquoi écrivez-vous dans ce cas ? Pour votre
plaisir ?
- Mon plaisir ? bien oui ! Mais ça ne m’a jamais
amusé d’écrire. J’ai toujours écrit pour me faire un peu
d’argent. Le Voyage, c’était pour me payer un
appartement.
- Pourquoi alors écrire difficilement des livres
difficiles ?
- Parce que je ne sais pas écrire autrement. Si
j’avais, comme Mme Desmarets ou Mlle Sagan, le truc pour
composer des livres qui se vendent bien et qu’on écrit
vite, je l’emploierais, croyez-moi. Mais je ne peux
faire que pignocher des textes. Et ces textes
n’intéressent personne. La France a changé de mythe.
Moi, j’étais du mythe aujourd’hui disparu.
Je croyais à l’empire vertueux. Mais, l’empire
vertueux, ça gêne tout le monde et ça fait vite long
feu. On en est à la décadence, au pourrissement. Et les
décadences, ça dure longtemps : voyez Rome. Je n’ai plus
aucune chance. Mes anciens camarades sont devenus des
crogneugneus, oui, oui, oui, qui n’ont même pas un
journal subversif à lire… »
Visite de Max DESCAVES, journaliste de Paris-Midi au
dispensaire. Décembre 1932.
Ayant eu la bonne
fortune d’approcher récemment cet auteur inconnu, je ne
veux pas garder pour moi seul la forte impression qu’il
m’a produite ; il ne nous est pas donné de rencontrer
tous les jours une nature de cette trempe.
Bien qu’il n’ait rien négligé pour conserver à sa
personnalité l’anonymat, Ferdinand Céline n’a pu cacher
longtemps que ce pseudonyme littéraire dissimulait
l’identité d’un médecin consultant qui exerce sa
profession dans un dispensaire municipal de la banlieue
ouest, ouvert à la misère et aux souffrances humaines.
C’est dans ce havre de douleurs que je suis allé lui
rendre visite. Je l’ai surpris dans le cadre et
l’ambiance, pleins d’enseignements, où il pratique
depuis plusieurs années.
- Je vous vois venir, vous !... Ça n’est pas pour me
consulter que vous avez traversé Paris, fringué comme
vous l’êtes !... Vous venez m’interviewer… Eh bien ! mon
petit vieux, tout mais pas ça !... Inutile ! C’est pas
mon affaire.
- Ce n’est pas le médecin que je viens voir, c’est
l’homme de lettres que je viens interroger.
- Vous avez bien dit ça !
- L’homme, si vous préférez.
- A tout prendre, oui, j’aime mieux ça… Mais, qu’est-ce
que vous voulez qu’il dise l’homme ?... Hein ?... Vous
l’avez devant vous. Voyez, jugez, appréciez, pensez !...
Vous gênez pas. Tout cela n’a aucune importance. Vous
n’en verrez jamais autant que moi, des hommes dans une
journée… Et quels hommes !... Et puis des femmes aussi,
des mômes, enfin, tout ! Ah ! quel métier ! C’est ici, dans
ce dispensaire, qu’on pratique la vraie médecine, avec
les pauvres, les travailleurs !
- J’entends bien… Mais parlez-moi de votre livre.
- Eh bien, je l’ai écrit, voilà tout. Ça représente six
années de boulot, à raison de quatre heures par jour.
Cinquante mille pages manuscrites, dix mille francs de
dactylographie… Le reste, mon brave monsieur, boniment !
Le docteur (mettons Céline, bien que celui-ci tienne
essentiellement à la séparation des pouvoirs), m’a prié
de m’asseoir.
- Mettez-vous là… Vous allez assister à la
consultation, dans la mesure, bien entendu où le secret
professionnel m’y autorise.
Le cabinet de consultation a trois mètres sur
quatre, environ. Un bureau, un « billard », un mesureur,
un appareil de haute
 fréquence, et je ne sais quoi
encore, composent l’installation d’une clinique ne
laissant rien à désirer ni au médecin, ni aux malades. fréquence, et je ne sais quoi
encore, composent l’installation d’une clinique ne
laissant rien à désirer ni au médecin, ni aux malades.
- Je constate avec plaisir, dis-je, que la municipalité
a bien fait les choses. C’est un dispensaire modèle.
- Impeccable ! Impeccable !
Le docteur Céline passe prestement une veste blanche.
Trois petites portes attirent mes regards. Elles sont
uniformément tapissées d’une moleskine verte, fixée par
des clous dorés, ainsi qu’on en voit ordinairement dans
l’étude des tabellions. Les trois portes sont surmontées
d’ampoules électriques de couleurs différentes, qui,
tout à l’heure, vont s’allumer alternativement.
- Ça vous intrigue ?... Le client est derrière, dans
une cabine où il tombe la veste ou le corsage, suivant
le sexe. Tenez, je vais appuyer sur l’un des trois
boutons pour avertir l’un d’entre eux que son tour est
arrivé.
Une des trois portes s’ouvre, livrant passage à une
jeune fille.
- Approche, mon petit bonhomme, Monsieur est un
confrère. Comment ça va mon petit bonhomme ?
- Je tousse… pas d’appétit.
- Ah ! pauvre petiot ! Tu as perdu l’appétit… Voyons
ça, mon petit bonhomme… Respire, respire bien.
La petite, consciencieusement, pousse de profonds
soupirs.
- C’est rien va ! Un peu de bronchite, quelques jours
de repos, au chaud… Tiens, mon petiot, tu prendras de
ces pilules trois fois par jour, et dans huit jours tu
reviendras me voir… Guérie, hein ?... Au suivant !
La séance continue. Le docteur appuie sur un bouton.
Et je vois se succéder : une femme d’une quarantaine
d’années percluse de rhumatismes ; un chauffeur de taxi
qui « se sent du vinaigre dans le gosier » ; un « vieux
stock », dit le docteur, c’est-à-dire un pauvre
sexagénaire hirsute, velu comme un mouflon, qui s’avance
en boitillant, et tourne entre ses doigts déformés par
la goutte, la casquette dont il ne s’est pas séparé en
entrant.
- Alors, patron, qu’est-ce qui ne va pas ?
- Rien ne va plus.
Le malade explique ; le docteur prescrit. La
consultation se poursuit. Les malades sortent des trois
cabines, comme le taureau du toril, mais dans l’arène,
cette fois, quelqu’un les attend, non pour les abattre,
mais au contraire pour les remettre sur pied.
J’ai l’impression que le docteur Céline est fort aimé
de sa clientèle de passage, non seulement pour la sûreté
de son diagnostic, mais pour l’ « amitié » avec laquelle
il prodigue ses soins. Mais ce n’est pas une raison pour
que je m’en aille comme cela, sans avoir atteint l’objet
de ma visite. Je reviens à la charge et demande
timidement :
- Pensez-vous que votre livre Voyage au bout de la
nuit, dont on parle beaucoup dans tous les milieux,
a quelques chances d’obtenir le prix Goncourt ?
- Je n’en ai pas la moindre idée.
- Aucun écho de l’opinion des « Dix » n’est venu à vos
oreilles ?
- Je n’ai rencontré, par hasard, que deux de ces
messieurs. Ils ont été bien gentils.
- Sans plus ?
- Ils m’ont dit que mon livre ne leur déplaisait pas et
voilà tout.
- Tous vos souvenirs de Voyage au bout de la nuit
sont-ils vécus ?
- Si on vous le demande vous direz que vous n’en savez
rien.
- Vous réclamez-vous de la nouvelle école, le
populisme ?
- Ah ! non, je vous en prie, pas de bobards ! J’ai les
écoles en horreur et je veux n’être ni chef ni soldat de
quoi que ce soit. J’ai écrit un livre ; il est bon ou il
est mauvais. Question d’appréciation… C’est comme les
crudités que, peut-être, a-t-on déjà dit, les fines
gueules ne digèreront pas… Eh bien, elles en seront
quittes pour demander une infusion.
Sur ces mots, je laisse le docteur Céline à ses
malades. J’aurais peut-être dû commencer par dire que
c’est un homme de trente-cinq ans environ, robuste, de
bonne humeur, et qui ne s’embarrasse pas plus de la
civilité puérile et honnête que d’un chapeau lorsqu’il
sort.
Signe particulier : ne porte pas le ruban de la
Médaille militaire, que lui ont valu, et sa conduite
pendant la guerre, et la blessure dont il ne parle pas.
Encore sans doute, une question d’appréciation.
(Cahiers
Céline I, Gallimard, 1976).
René-Héron de VILLEFOSSE. Prophéties et litanies de
Céline.
Un soir
de 1936, nous sommes rentrés, Madeleine et moi, assez
bouleversés. Je ne cessais de penser à la prophétie de
Cazotte que Nerval prête aux souvenirs de la Harpe et où
le touchant auteur du Diable Amoureux monologue
d'étrange façon, en prédisant la suite des évènements et
jusqu'à la fin tragique de la plupart des présents. Je
me suis assis à ma table devant un papier blanc et, sans
hésiter, j'ai tracé le titre : " la Prophétie de Céline
", puis le récit de notre après-midi.
Henri Mahé nous avait invités à prendre un porto à bord de son petit
bateau, l'Enez Glaz, amarré quai Conti, en face
de l'Institut. Il y avait à bord sa femme, Maguy, un bon
gros chien noir et frisé, nommé Major, et un grand
diable silencieux au visage étrange qu'on ne présenta
pas, car cela lui était fort indifférent. Dans le carré
du bord, les quarts d'aluminium se vidèrent sans qu'il
ait ouvert la bouche. Je pense qu'il observait, qu'il
cherchait à flairer l'odeur de ce couple nouveau dont
Mahé avait dû lui toucher deux mots.
Je ne me
souviens plus de ce qui motiva son déclenchement. Sa
voix un peu saccadée, un peu de la même famille que
celle de Jouvet, commença sur un ton grave et sourd.
Après deux ou trois minutes, il était lancé, il n'y
avait plus d'obstacle sur la route, il parlait avec un
rythme de barde, avec la sécurité d'un prêcheur, d'un
inspiré. Joad en prose moderne, il voyait les nuages
éclater en trombes sur nos têtes. Il disait - je
l'entends - " Et les cosaques viendront à
Brive-la-Gaillarde... "
Il me semble que c'est alors que Mahé m'a dit à l'oreille : " Ferdinand "
et nous avons été émus et rendus plus attentifs. Il
continuait : " Un seul pays au monde résistera encore un
siècle, celui où les curés sont rois, le Canada, le plus
emmerdant de tous les pays... mais j'irai, je servirai
la messe. J'enseignerai le catéchisme. Il n'y aura pas
le choix si l'on veut sauver ses ... et moi, j'y
tiens... " En rafales verbales, un peu comme dans Mea
culpa, il évoqua les bouleversements proches,
l'Europe en feu, les dernières chances qu'on avait de se
mettre à l'abri en la quittant illico, sans
attendre, sans réfléchir, avec un baluchon.
Nous nous
sommes revus à déjeuner, plusieurs fois, dans une
crêperie bretonne de la rue Vandamme en particulier. Il
était sobre avec des yeux de chien de chasse, fatigué
d'avoir couru. Il me disait souvent qu'il avait le "
bourdon ", une musique qui lui faisait mal dans la tête,
depuis une certaine blessure plus grave que celle de Bardamu, au lever de rideau de la guerre de 14.
Il m'écoutait comme un enfant sage. Je lui parlais de trucs qu'il
ignorait ou qu'il avait oubliés, du traité de Verdun, en
832, de cette épineuse terre de Lotharingie, de Julien
l'Apostat, au surnom immérité. Il restait bouche bée.
Trois jours après, je recevais un billet lyrique,
enthousiaste. Ce que je lui avais dit l'avait travaillé,
enchanté : " Ah ! écris-moi cette date, raconte moi
l'histoire si fumante, si savoureuse, si pleine de
magie... " J'ai l'impression qu'il avait trop confiance.
Je ne devais pas être le seul à lui en raconter...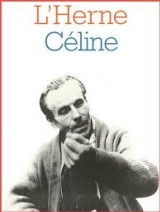
Durant
l'occupation, je l'ai peu vu, deux trois fois en tout
peut-être, mais il était sage et il se tourmentait... "
Et pourtant, disait-il, Hitler, je l'emmerde... ". Et
c'était vrai, bien sûr. Après j'ai dîné avec son ami, le
docteur Camus, et l'avocat danois qui l'avait pris en
charge à Copenhague, maître Mikkelsen. Ce dernier m'a
incité à l'aller voir. Nous ne connaissions pas
Copenhague, Madeleine ni moi. Nous avions même cru être
invités là-bas par le défenseur.
En 47, il fallait trente heures de train mais le passage à travers les
villes allemandes effondrées nouait les entrailles... et
les enfants déguenillés aux stations qui quêtaient les
morceaux de sucre du wagon-restaurant et couraient après
le train ! Hambourg surtout... une ville en poussière et
de quelle dimension ! Une demi-heure, plus peut-être,
pour la traverser au ralenti. Je ne soupçonnais pas que
nous la retrouverions, en 54, fleurie et lumineuse avec
des milliers d'autos et des devantures étincelantes !
On est arrivé
à huit heures du soir à Copenhague. Ferdinand attendait
à la sortie avec Lucette et le chat Bébert en
bandoulière dans une musette. Il m'a dit : " On vous
mène à l'hôtel d'Angleterre. Il a pris une chambre pour
vous, mais à vos frais bien entendu. Vous le connaissez
pas. " Ils habitaient une mansarde assez négligée mais
c'était son climat à lui, chaussettes sur la table et
chemises au dos des meubles. Leur pièce, assez vaste
également, donnait sur le parc de Rosenborg où il y a le
charmant château qui contient les collections de la
couronne... mais il ne les avait pas vus. Il promenait
Bébert en laisse tout autour, pas question d'entrer là,
pour quoi faire. Il s'en foutait absolument. Le vieux
chat tigré, lui, était à l'honneur : " Tu sais, il a
dix-neuf ans, Bébert. Il en a vu : " on a traversé
Hanovre en flammes avec lui. Il pourrait en raconter...
"
Je sautai sur
l'occasion pour lui dire : " Mais c'est toi, Ferdinand,
qui devrais reprendre la plume du Voyage pour
nous faire assister à l'effondrement de l'Allemagne ! Il
n'y a que toi de valable qui aies vu cela de l'autre
côté... Quel bouquin extraordinaire, la débâcle du
nazisme. Et tu en es sorti... " Je parlais dans le vide.
Par moments il me donnait l'impression de divaguer ; il
s'excitait sur des ballets, sur des livres d'opéra. Il
ne m'écoutait plus.
Un jour Mikkelsen nous a amenés tous les quatre, à Elseneur. Un matin
gris de novembre où la forêt danoise gardait encore ses
feuilles d'or, son extraordinaire parure d'automne,
somptueuse et mystérieuse, le décor qui inspira
certainement Andersen. Ferdinand est resté dans la
voiture quand nous avons visité des musées d'histoire,
dans des châteaux sur la route.
A Elseneur, il est descendu et nous a accompagnés sur la terrasse où
dorment les vieux canons. Avec la brume un peu jaune sur
les côtes de Suède proches et lointaines, en face, les
mouettes qui tournaient en criant, le choc est
angoissant. On regarde, on veut voir plus loin, on veut
entendre en soi le mot-clé. Céline, après un long
regard, nous a dit de sa voix sourde : " C'est une mer à
pêcher des âmes !... "
Je l'ai revu
à Meudon avec ses chiens et son amertume. Il m'a écrit
bien des fois pour que je lui éclaircisse des points
d'histoire mais il partait toujours de la légende, du
rêve où il vivait. Il était naïf et bon, faisant
semblant d'être bourru et de ressembler à son personnage
comme tant d'autres... Il s'inquiétait de Dagobert...
Je relis ses lettres, comble de gentillesses excessives. Il a
toujours été en ébullition. C'est pour cela qu'il est
parti trop vite. Dans la dernière, ce sont des litanies
: " J'espère que tu vas bien, gouverneur du passé ! Tous
ces soleils éteints à ta baguette... ! " Comme il était
fidèle et comme c'est rare !
(L'Herne, décembre 2007, p.184).
Lucette Destouches : comment fut écrit " RIGODON ".
Entretien avec Philippe DJIAN.
MEUDON. Un pavillon tout brûlé et un jardin assez
triste. Des chiens aboient, je pense, derrière la maison
; on ne les voit pas... On me fait entrer dans un petit
garage emménagé à la hâte. Ça
sent la résine et le bois neuf et aussi je ne sais quoi
d'assez délicat.
C'est ici qu'habite Lucette Destouches, " professeur de danse classique
et de caractère ". La veuve de Céline. J'étais venu
chercher quelques renseignements sur Rigodon, le
dernier livre à paraître de Céline, celui que ses
lecteurs attendent bientôt depuis sept ans...
Qu'est-ce
que Rigodon ?
Lucette Destouches : Rigodon, c'est la suite de Nord,
puisque en somme cela s'est terminé avec la guerre.
C'est vingt et un jours de sauvette à travers
l'Allemagne en flammes. Nous nous sauvions comme des
rats...
"
Nous ", c'est-à-dire vous, Céline et Le Vigan ?
Non, dans Rigodon, Le Vigan apparaît très peu ; il nous a quittés
au bout de dix jours en nous laissant Bébert (le chat).
Nous l'avions retrouvé à Baden-Baden, à moitié nu... il
ne savait pas où aller, nous l'avons pris avec nous.
Nous sommes allés à Berlin afin d'obtenir une permission
de sortie. Elle nous fut refusée. Puis on nous a envoyés
à Zornhof dans un camp d'objecteurs de conscience. Il
nous était interdit d'en bouger, mais lorsque tout fut
bombardé, nous sommes partis retrouver le gouvernement
français à Sigmaringen pour soigner blessés et malades
(voir Nord et D'un château l'autre).
Enfin, au bout d'un an, " tout a éclaté ", alors nous
avons essayé de venir nous réfugier au Danemark. Il nous
a fallu retraverser l'Allemagne jusqu'à la frontière...
C'est ça Rigodon.
 Puisque
Céline est mort quelques heures après avoir terminé ce
roman, quelle est la dernière image qu'il nous lègue ? Puisque
Céline est mort quelques heures après avoir terminé ce
roman, quelle est la dernière image qu'il nous lègue ?
Rigodon se termine sur une sorte de
délire visionnaire ; la France est envahie par les
Chinois...
Comment
se fait-il que Rigodon ait attendu sept ans avant
de paraître aux éditions Gallimard ?
Céline n'avait pas eu le temps de recopier son manuscrit ; des mots
plusieurs fois raturés et une écriture devenue souvent
difficile du fait de son bras malade nous ont heurtés au
délicat problème de la retranscription. Cette tâche
s'est déroulée en deux temps ; j'ai tout d'abord remis
le manuscrit à un avocat, Me Damien, qui s'est livré à
un pénible travail de déchiffrement auquel il consacrait
ses moindres loisirs ; mais un énorme et délicat travail
restait à accomplir.
C'est avec Me Gibault que commença la seconde phase de cette besogne ; en
effet, il y avait encore le problème de la ponctuation
et de certains mots qui demeuraient incompréhensibles.
Ce fut surtout une question de patience et de probité ;
nous n'avons rien omis, ajouté ou changé. Mais Céline
m'avait lu une grande partie de son livre ; ainsi, nous
avons retrouvé certains mots, par le rythme... nous
entendions si cela tombait juste...
Lorsque vous avez sauvé Rigodon du pillage auquel
fut livré votre appartement, les pages du manuscrit
étaient-elles classées ?
Oui, d'ailleurs Céline les avait numérotées. Pourtant nous avons trouvé
des pages en double, mais nous n'avons pas rencontré de
sérieuses difficultés de ce côté-là : le choix était
déjà fait.
Céline avait-il une méthode de composition ?
Non, il écrivait avec son cœur,
ses impulsions, et sa formidable envie de dire quelque
chose ; il était musicien dans sa chair et composait
comme tel ; il plaquait ses phrases sur une gamme pour
chercher sa " petite musique ".
Souvent, il restait des journées, des mois sur quelques lignes.
D'ailleurs, avant cette version définitive de Rigodon,
Céline en avait fait peut-être dix ou vingt qu'il avait
jetées.
Et ces vols de manuscrits dont Céline a tant parlé ?
Peut-on s'attendre à voir réapparaître des romans
entiers ?
Oui. On lui a volé au moins quatre ou cinq manuscrits ébauchés, enfin des
œuvres
qui en étaient peut-être au quatrième ou au cinquième
remaniement... la fin de Casse-pipe, certainement
; ce roman devait être entièrement terminé, je pense.
Mais un grand nombre de ces documents réapparaîtront à
ma mort.
Personnellement, il me reste une assez grande quantité de lettres de
Céline ; peut-être les ferai-je publier, mais pas dans
l'immédiat. D'ailleurs, la vie pour moi, maintenant, n'a
plus beaucoup d'intérêt... Ce que je voulais, c'était
finir Rigodon ; c'est dans cette volonté que j'ai
puisé les forces nécessaires à l'aboutissement de ce
travail.
Revenons
un peu en arrière. Rigodon raconte votre fuite à
travers l'Allemagne jusqu'à la frontière du Danemark.
Quelle en fut la suite ?
Céline fut incarcéré à Copenhague, il est resté deux ans dans le quartier
des condamnés à mort ; le ministre de la Justice le
relâcha après avoir lu Les Beaux draps, n'y
trouvant pas les raisons nécessaires pour retenir un
homme en prison. Ensuite, nous avons passé cinq ans,
sous caution de notre avocat, en pleine forêt, à
Klarskovgaard, près de Korsör, dans la neige... une
misère totale... sans eau, sans électricité, sur un sol
de terre battue... un paysage triste et sauvage, seuls
tous les deux.
Là, il a terminé Féerie qu'il avait commencé en prison. Durant ces
cinq années, il se comportait comme un animal, se
refermait sur lui-même ; et puis, il écrivait, quand il
en avait la force. Il était très malade ; il a eu la
pellagre, perdu près de trente kilos... mais c'est
surtout moralement qu'il fut le plus atteint... Vous
savez, Céline agrandissait tout, mais bien des fois, la
réalité fut pire qu'il ne l'a dit... il avait deux
paires de gants, des houppelandes à l'infini... et ça a
duré cinq ans.
Sartre
fait un hommage à Céline dans la dédicace de La
Nausée. Que savez-vous de ce qui a ensuite séparé
les deux hommes ?
Oui, dans la dédicace Sartre cite une phrase de Céline qui figure dans
L'Eglise : " C'était un garçon sans importance
collective, tout juste un individu. "
D'ailleurs au début, Sartre admirait beaucoup Céline ; je n'ai jamais
rien compris à un revirement si complet de sa part.
Céline en fut très touché...
Et
Marcel Aymé ?
Ah, Marcel a été admirable ; il a été d'une patience et d'un dévouement
extraordinaires... D'ailleurs, dans une petite étude
qu'il a faite sur Céline, Marcel dit toute la vérité. Il
a parlé du vrai Céline et tout a été dit.
Mais
Céline, cet homme qui s'est donné tant de visages, qui
se plaisait même à entretenir autour de sa personne une
fausse légende, qui était-il vraiment ?
Un homme d'une immense bonté. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le
bien ; il aimait la France, son pays, il aimait les gens
en général... il était beaucoup plus tendre qu'on ne
l'imagine, mais il ne le montrait pas et c'est cela la
vraie tendresse... il en est mort, d'ailleurs... Et si
par moments il était un peu dur avec les gens, c'était
pour qu'ils se réforment, pas pour autre chose.
Il n'aimait pas détruire, non plus, et s'il brisait quelque chose,
c'était que cette chose lui semblait inutile. Il voulait
créer... un artisan, sans aucune vanité. Il était prêt à
admirer un autre si celui-ci avait travaillé autant que
lui. Ce qu'il voulait, c'était du travail ; il pensait
que l'on ne " creusait " jamais assez profond pour
trouver ce que l'on cherche.
" Ils restent à la surface ", disait-il en parlant des autres. Une seule
pensée... le travail... ce côté Moyen-Âge...
c'était un voyeur... pas un exhibitionniste... il aimait
regarder, examiner...
Comme un médecin, sans doute ?
Oui, d'ailleurs, l'écrivain vient du médecin... cette façon de voir les
choses... Il aurait donné sa vie pour un malade, sa vie
ne comptait pas... la vie... ne pas supprimer la vie.
Amoureux de la vie. Sa passion : la jeunesse ; il
adorait les enfants, les animaux, tout ce qui est jeune
et neuf... C'est pour la jeunesse qu'il écrivait, parce
qu'il savait bien qu'il n'avait plus rien à attendre des
hommes... qui ne l'avaient pas compris. Plus tard,
peut-être...
(Magazine Littéraire, Nouveaux regards, Entretien avec Philippe Djian,
octobre 2012).
VISITE AU LION DEVENU
VIEUX. (D. FABRE).
" Dieu est en réparation !
" écrivait Céline en exergue de L'Ecole des
cadavres... Mais chacun son tour ; aujourd'hui,
c'est le sien : le vieux lion des lettres est malade. Et
plutôt que de s'en remettre à Dieu, le mécréant a confié
le soin de sa santé au Dr Destouches, pensant qu'on
n'est jamais si bien servi que par soi-même.
On m'avait bien dit chez son éditeur que j'avais peu de chances de forcer
sa porte et qu'il n'avait même pas voulu signer le
service de presse de son dernier livre... Pourtant je
désirais tenter de le revoir ; prendre le chemin de la
banlieue où, après les années que l'on sait, il revenait
s'installer en 1951 ; tenter de raviver et de corriger
un souvenir déjà vieux de cinq ans.
Une rencontre - la première et la seule - qui eut lieu dans un de ces
studios d'enregistrement où, à trop se préoccuper des
questions qu'on va leur poser, on voit mal les gens.
Ce jour-là, je l'attendais donc en me remémorant le Voyage au bout de
la nuit et, d'avance, je me faisais un portrait de
celui qui, avec Cendrars, a pris en nourrice tous les
malappris de la jeune littérature, les forts en gueule
occupés à nous balancer à la figure l'insulte et
l'ordure à pleine page ! Pour tout dire, je n'étais pas
tranquille et à trop vouloir l'imaginer je n'aurais plus
eu un poil de sec si Céline, justement, n'était arrivé à
la minute où sa silhouette prenait dans mon esprit une
tournure dangereuse.
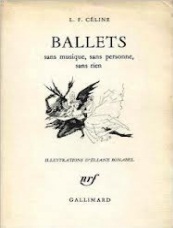 Mon premier étonnement fut de constater qu'il était
ponctuel. Et cette remarque en entraîna une autre :
celui dont j'attendais qu'il me rabroue au premier mot
prononcé de travers, n'avait pas ce caractère terrible
qui m'inquiétait. Pas rasé de deux jours, les cheveux
longs, enveloppé dans une vaste cape dont le noir usé
virait au vert, Céline, chaussé de poussière, me fit
l'effet d'un de ces pauvres comme il en va sur les
routes de campagne, à pied, de village en village,
mangeant, mouillé de pluie, le pain qu'on leur donne
dans les fermes... Et - qu'il me pardonne - était-ce le
trop large vêtement noir ou les cheveux longs, je lui
trouvai quelque chose du juif errant tel que l'aurait
peint Chagall vers 1912, un juif dont Soutine aurait
brossé le visage. Une grande lassitude dans les traits,
de la gaucherie... Mais, m'approchant de lui, je vis au
fond de ses prunelles une braise qui ne trompe pas,
celle de feu qui couve pour mieux reprendre.
Mon premier étonnement fut de constater qu'il était
ponctuel. Et cette remarque en entraîna une autre :
celui dont j'attendais qu'il me rabroue au premier mot
prononcé de travers, n'avait pas ce caractère terrible
qui m'inquiétait. Pas rasé de deux jours, les cheveux
longs, enveloppé dans une vaste cape dont le noir usé
virait au vert, Céline, chaussé de poussière, me fit
l'effet d'un de ces pauvres comme il en va sur les
routes de campagne, à pied, de village en village,
mangeant, mouillé de pluie, le pain qu'on leur donne
dans les fermes... Et - qu'il me pardonne - était-ce le
trop large vêtement noir ou les cheveux longs, je lui
trouvai quelque chose du juif errant tel que l'aurait
peint Chagall vers 1912, un juif dont Soutine aurait
brossé le visage. Une grande lassitude dans les traits,
de la gaucherie... Mais, m'approchant de lui, je vis au
fond de ses prunelles une braise qui ne trompe pas,
celle de feu qui couve pour mieux reprendre.
C'était il y a cinq ans...
Aujourd'hui, Céline publie un livre dont le titre au
premier instant déroute, Ballets, mais ce qu'il y
a d'aimable, de trop joli, s'équilibre d'un sous-titre -
" sans musique, sans personne, sans rien " - dont
le dénuement est un puissant correctif. Cinq contes aux
décors imprévus - le Palais de Neptune, une folie Louis
XV... où le lecteur familier de Céline s'égarerait si
l'auteur n'avait mis dans la bouche des dieux et des
lutins (ses personnages) cette langue verte que Céline
nous a prodiguée.
Si j'avais entrepris ce petit
voyage, c'était surtout pour lui demander pourquoi ces
ballets plutôt qu'un roman. Pour savoir aussi jusqu'à
quel point l'écrivain malade avait fini par ressembler à
l'un de ses héros, Van Bagaden, qui " ne peut plus
bouger de son fauteuil, ce réduit... c'est là qu'il vit,
sacre, jure, peste, dort, menace, mange, crache jaune et
garde tout son or... "
... Mais non, sa porte de malade
était condamnée. Et au lieu de la voix attendue, venant
de la maison, c'est le son du piano que j'ai surpris,
celui de sa compagne qui enseigne la danse aux fillettes
de Meudon... Peut-être était-ce à leur intention que
Céline avait écrit ces arguments dont les folles
n'auront pas voulu, leur préférant des rondes plus
inoffensives et les condamnant ainsi à rester ce qu'ils
sont : des ballets, sans musique, sans personne, sans
rien.
Dominique FABRE (Le
Journal de Genève, 28 juin 1959, dans BC n° 70).
Luc
FOURNOL.
Quand
je me suis lancé dans une carrière de photographe
professionnel, c'est mon amie Arletty qui m'a aidé à mes
débuts. Un jour elle me propose - avec son inimitable
accent des faubourgs - de l'accompagner chez Céline : "
Viens avec moi, on va voir Ferdine à Meudon, tu pourras
l'photographier. " J'étais pour le moins dubitatif, et
pas vraiment enthousiasmé à cette idée. En 1958 Céline
sentait encore le soufre... Comme tout le monde (ou
presque) j'avais lu Voyage au bout de la nuit que
je trouvais formidable, mais à l'époque, et pour
l'opinion publique, il restait l'auteur de Bagatelles
pour un massacre... Pour un photographe de stars,
franchement, il y avait beaucoup mieux que Céline !
Finalement je me laisse convaincre.
Le
rendez-vous est fixé au 14 avril 1958, à Meudon. Le jour
dit, je suis arrivé un peu en avance. Au début j'ai eu
du mal à croire qu'un écrivain habitait là... Le jardin
était dans un état indescriptible, ça puait le rat
crevé, et il y avait des animaux qui sortaient de
partout. C'est Céline qui m'a ouvert. Je lui ai dit que
j'étais l'ami photographe d'Arletty, il a juste haussé
les épaules, émis un grognement, puis il m'a laissé
entrer. L'intérieur de la maison était tout aussi
sordide que le jardin... un vrai bazar. Il y faisait
très sombre, et même avec un beau rayon de soleil,
c'était pas possible d'égayer un bâtiment pareil. Dans
le séjour, c'était un désordre indescriptible, rien
n'était réellement agencé, tout était dépareillé, il y
avait des papiers partout... L'aspect physique de Céline
était au diapason... moi qui avait auparavant rencontré
Léautaud, je peux vous dire qu'à côté de Céline,
Léautaud faisait " classe ". C'était un genre qu'ils
cultivaient, chacun à leur façon.
Arletty
n'était pas encore arrivée, Céline me désigne une chaise
et me dit : " Asseyez-vous là, on va l'attendre. " C'est
la seule phrase qu'il me décrochera de la visite. On
reste là, tous les deux, pendant de longues minutes,
Céline commence à lire son journal, et je crois que sa
femme donnait des cours de danse à l'étage. Finalement
Arletty arrive, elle frappe au carreau, ce sera ma
première photographie. Ce qui était le plus surprenant,
c'était la transformation de Céline à la vue de sa
vieille copine. Pendant les deux heures qu'a duré notre
visite, il avait quitté son aspect de vieillard
acariâtre pour devenir quelqu'un de vif, drôle et
charmant. A croire qu'il rajeunissait rien qu'à la voir
!

Ils étaient très complices tous les deux, ils n'arrêtaient pas de faire
des conciliabules, de plaisanter. Céline n'arrêtait pas
de la taquiner, et Arletty riait à gorge déployée. Le
problème, c'est qu'ils se parlaient à mi-voix, et je
n'entendais pas ce qu'ils se disaient. A un moment, je
me suis rapproché pour essayer de comprendre ce qui se
tramait. Malheureusement, je suis arrivé à la fin de
leur discussion, et je n'ai pu photographier que l'éclat
de rire d'Arletty, et le sourire amusé de Céline. La
seule chose que j'ai pu saisir de cet aparté, c'est
qu'ils évoquaient ensemble des souvenirs de
l'Occupation... Et au vu de la photographie, cela avait
l'air de beaucoup les amuser.
Pendant leurs
conciliabules, on entendait les rythmes diffus des
danseuses de Mme Almanzor. Je demande la permission à
Céline d'aller photographier à l'étage, et il me répond
par un grognement en m'indiquant l'escalier de la main.
Je monte à l'étage et je surprends Mme Destouches en
train de faire faire des exercices à ses élèves. Très
contrariée d'être dérangée, elle refuse que je prenne
des photographies de son cours de danse et me demande de
partir. Je me retire en silence, mais depuis l'escalier
j'arrive à prendre une photographie de la leçon de danse
via un grand miroir qui me permettait de voir sans être
vu.
A la fin de la visite, le passage obligé, c'était le perroquet, Arletty
m'avait prévenu. Et effectivement, Céline s'amusait
comme un petit fou avec Toto, il lui faisait des
mimiques, et le perroquet faisait de même, c'était
stupéfiant de voir et de photographier cette complicité
entre le vieil homme et l'animal. Au final, de cette
journée à Meudon, j'ai fait une trentaine de
photographies, mais je n'expose et n'autorise la
publication que des trois dont nous venons de parler.
Les autres n'ont pas, à mes yeux, les qualités
artistiques requises, elles sont trop floues, soit mal
cadrées, voire inintéressante. Elles resteront dans mes
cartons.
J'ai continué
ma carrière en photographiant les grands de ce monde, de
Gaulle, Pompidou, Chet Baker, Malraux, Brigitte Bardot,
etc. Dans les années 1980, une amie de Danièle
Mitterrand a organisé une grande rétrospective de mon
travail dans une galerie parisienne. Au moment d'exposer
les photographies, elle me précise : " Luc, tu
comprends, évite les clichés à problèmes, je ne veux pas
de scandale au vernissage. " Un peu gêné, je lui dis : "
Bon d'accord, je vais enlever les photographies de
Céline. " Surprise, elle me répond : " Céline ? oh non,
tu peux le laisser. "
(Propos recueillis par David Alliot le 13 janvier 2006, D'un Céline
l'autre, 2011, p. 970).
Visite d’Hélène GALLET sur
La Malamoa.
Ce
témoignage écrit en 1962 à la demande de Dominique de
Roux sur Céline n’a jamais été publié. Eric Mazet, à qui
elle le confia en 1981, nous en fait part.
[…] A bord de La
Malamoa, amarrée près du pont de la Concorde,
plusieurs fois par semaine, je descendais voir les
récents tableaux de mon ami Henri Mahé, écouter sa femme
Maguy jouer du piano, m’intégrer à cette vie ardente
d’alors. Louis-Ferdinand Céline était très souvent là.
C’est ainsi que, l’écoutant plus fréquemment que je ne
discutais avec lui, je me suis fait une opinion sur ce
qu’il était ; un blessé du cœur, de corps, de l’esprit.
Un être tout d’amour brûlant pour ses semblables, mais
incapable de leur pardonner de n’être qu’eux-mêmes, de
n’être ni assez beaux, ni assez bons, pour sa grande âme
souffrante. Vouloir la perfection, cela ferait crier.
Les cris de Céline m’ont toujours exaspérée. Je
comprends qu’il ait crié. Il y a de quoi. Mais je ne
puis lui pardonner de ne pas avoir eu un talent
constructeur en plus de son génie destructeur.
J’essayais, malgré ma jeunesse, ou plutôt à cause de
ma jeunesse, de faire admettre à cet amateur de picpoul,
car il parlait volontiers, combien l’ordre était
supérieur au désordre, nécessaire au pays. J’essayais de
le convertir aux idées royalistes.
 Est-ce que Léon
Daudet, dans son éditorial de L’Action française,
avec son objectivité coutumière, n’avait pas été le
premier à signaler le Voyage au bout de la nuit
comme un chef-d’œuvre, mais aussi réclamé « Ariel après Caliban » ? Est-ce que Léon
Daudet, dans son éditorial de L’Action française,
avec son objectivité coutumière, n’avait pas été le
premier à signaler le Voyage au bout de la nuit
comme un chef-d’œuvre, mais aussi réclamé « Ariel après Caliban » ?
« Non mais, Henri, elle est marrante ! C’est une
vraie poison ! Et elle est convaincue, c’est le plus
drôle ! »
Céline professait le communisme. Henri aurait bien
rejoint mes idées. Mais Céline le mettait à même de voir
toutes sortes de documents sur l’imbécilité, la
traîtrise et la concussion des royalistes. Henri
devenait anarchiste. J’en étais triste. Elizabeth Craig,
la maîtresse de Céline, assistait aux débats, belle de
cette beauté qui coupe le souffle. Elle portait alors de
longs cheveux rouges tombant sur les épaules. Que
faisait-elle avec cet homme mal habillé qui n’en
semblait pas même jaloux ? L’homme s’était déguisé une
fois pour toutes, enfermé dans une armure qui,
peut-être, l’empêchait de recevoir les coups que sa
sensibilité aurait rendus mortels, mais qui,
sans aucun doute, le blessait aux entournures.
« Pas de sentiments ! Pas de jalousie ! C’est
vulgaire et c’est cul ! »
Si j’en veux à Céline, c’est aussi parce que l’accueil
d’Henri Mahé a toujours été parfait pour lui, et donnant
l’impression de l’apprécier. Céline le lui a mal rendu.
Il débordait de mots grossiers, de descriptions
horribles de plaies, de pus, de sanies, de banlieues, de
misères, de cas pathologiques, de forfaits, d’impostures
et il avait l’air de se plaire beaucoup sur la péniche.
Je le vois, ramassé sur lui-même, affalé dans un
fauteuil en tubes chromés et toiles rouges, se détachant
sur le décor bleu d’Outremer clouté d’étoiles d’or du
salon de La Malamoa, avec sa figure ravagée de
moine espagnol, parlant, toujours, parlant des pauvres
gens pour qui tout est peine et misère, et, juste au
moment où il allait s’attendrir, ricanant, abandonnant
son registre sourd, sa voix introvertie, pour un vocero
scandé de gros mots et de sentences amères. Ces réunions
valaient celles que décrit Balzac chez Tullia. Henri
Mahé polarisait, par sa générosité, son verbe imagé, sa
drôlerie, les personnalités les plus pittoresques, des
parasites aussi, et les vedettes les plus talentueuses.
On rencontrait Germaine Tailleferre, Beby le clown,
le Prince d’Urach, le baron Surcouf, des gars du Milieu,
des Maîtres du Barreau, pas toujours exemplaires, des
actrices, Nane Germon et Polaire, des industriels
importants, des littérateurs et de très jolies femmes. Céline s’y plaisait. Il apporta un jour le manuscrit
de son roman pour connaître l’avis de son ami. Henri
Mahé lui présenta les plus grands artistes et composa un
merveilleux portrait d’Elizabeth Craig. Lisez le
chapitre consacré au peintre sur sa péniche, « aux
environs de Toulouse » dans le Voyage au bout de la
nuit. Vous comprendrez pourquoi j’en veux encore à
Céline, quoique dans Bagatelles pour un massacre,
il ait tout de même proclamé : « Il y a deux peintres
à Paris : Gen Paul et Mahé ! » Hommage aux fresques du cinéma Rex et du Balajo, mais aussi hommage à son
ami breton, à ses rêves et à son verbe, sa générosité de
grand seigneur. Hommage du sombre Caliban au doux
Ariel. »
(Hélène Gallet, Paris, 1962, dans Spécial
Céline n°6, 2012).
Henri
GODARD.
Avec
son roman, Céline revient au premier plan de la scène
littéraire. C'était l'objectif principal. Pour les plus
jeunes, qui n'avaient pas connu le Céline de Voyage
au bout de la nuit et de Mort à crédit, la
publication de D'un château l'autre est une
révélation. Henri Godard - à l'époque jeune normalien -
reçoit un exemplaire du livre en cadeau, et raconte le "
coup de foudre " qui s'ensuit. Coup de foudre d'autant
plus remarquable qu'il achevait " avec bonheur la longue
traversée " de la Recherche du temps perdu.
Comme de nombreux journalistes, photographes ou simples admirateurs,
Henri Godard prendra à son tour le chemin de Meudon afin
de rencontrer l'écrivain pour lui demander un texte sur
Rabelais, alors au programme de l'agrégation :
" Je décidais
un camarade à m'accompagner une après-midi de juin dans
cette aventure. Tout se passa bien comme prévu. En
montant à Meudon, route des Gardes, à mi-côte sur la
gauche s'ouvrait un chemin en épingle à cheveux formant
une impasse. Il desservait trois villas, chacune
précédée d'un jardin. La situation correspondait
parfaitement. Et en effet, là où la végétation était la
plus touffue, apparaissait sur la grille une plaque
annonçant le nom de la femme de Céline, Lucette Almanzor,
identification tout de suite confirmée par les chiens
qui déboulent en aboyant. Alerté, voici Céline lui-même
qui sort de la villa et descend l'allée jusqu'à la
grille. Il porte la tenue qu'on lui a vue si souvent
dans des reportages photographiques : malgré la chaleur,
la superposition de plusieurs couches de lainages, et un
foulard. Mais sans doute n'avions-nous pas la mine de
ceux qu'il veut éloigner.
Nous sommes,
mon camarade et moi, trop jeunes pour être des
journalistes. Il fait taire les chiens et nous demande
ce que nous voulons, sans agressivité. Je le lui dis. Il
est de bonne humeur ce jour-là. " C'est gentil de venir
m'interroger, mais, vous savez, je n'ai rien de plus à
dire sur ce sujet que ce que j'ai dit. Vos maîtres en
savent bien plus que moi, oh ! là ! là ! Vous avez tout
ce qu'il vous faut. Travaillez bien et bonne chance. "
Devant cet accueil, nous réalisons ce que notre démarche avait d'incongru.
Nous nous doutions bien qu'il avait autre chose à faire
que de trouver pour des étudiants des vues originales à
exposer sur Rabelais.
Qu'il ne nous ait pas rabroués était déjà beaucoup, il n'était pas
question d'insister. Lui était en train de remonter
cette allée qu'un jour, dix ans après sa mort, je
monterais à mon tour, en quête de manuscrits dont
j'avais besoin en vue d'une édition critique de ses
romans. "
Etrange et furtive rencontre
(David Alliot, Madame Céline, Tallandier, janvier 2018, p.198).
André
HALPHEN.
La
pluie avait commencé à tomber, fine sur les hauteurs de
Meudon lorsque les croque-morts sortirent de la villa
Maïtou, route des Gardes, la bière en chêne verni. Il
était 8 h 45, le mardi 4 juillet 1961. Nous étions une
petite vingtaine, y compris une dizaine de jeunes
danseuses du cours de Lucette Almanzor. Quelques
couronnes de fleurs rouge-rose, glaïeuls,
œillets - et sur le cercueil
une plaque presque anonyme pour le commun des mortels :
" Louis-Ferdinand Destouches (1894-1961) ".
" Docteur Destouches " : c'est ainsi que ses voisins le connaissaient à
Meudon. Mais l'homme qu'on enterrait ce matin-là entrait
de plain-pied dans l'immortalité. Louis-Ferdinand
Destouches était l'un des écrivains les plus décriés,
mais aussi les plus illustres, du siècle. On le lit dans
le monde entier sous le pseudonyme de Céline.
Le vendredi
précédent, comme tous les jours, il s'était assis à sa
table de travail et avait écrit, de son écriture très
large, aérée. Il avait beaucoup de mal à écrire car son
bras droit, blessé à la guerre, le faisait souffrir
énormément à la fin de sa vie ; mais malgré les crises
violentes qui l'affectaient (des sortes de congestions
cérébrales), il ne laissait pas de jour sans ajouter
quelques pages à son dernier manuscrit, le futur
Rigodon.
C'était le samedi que, pour la première fois, il ne s'installa pas pour
écrire. " Je ne me sens pas très bien ", avait-il dit à
son épouse, Lucette Almanzor, professeur de " danses
classiques et de caractère " comme l'indiquait la plaque
apposée sur la villa. Il traîna toute la journée, vêtu
d'un pantalon de velours et d'un pull-over, entre ses
quatre chiens, son perroquet et ses rêves. Le plus long
jour de sa vie, sans doute.
Un peu avant
18 heures, il répéta à sa femme : " Cela ne va pas. Je
me couche. " Il est mort presque aussitôt, dans son lit,
au rez-de-chaussée gauche de cette villa qu'il habitait
à Meudon depuis dix ans, depuis son retour du Danemark.
Aussitôt, une conspiration du silence commença. Céline avait
toujours dit qu'il souhaitait être enterré dans
l'intimité la plus grande, sans journalistes, sans
photographes. Alors Lucette Almanzor ne prévint que les
plus proches : Colette, la fille que Céline avait eue
d'un premier mariage, Marie Canavaggia, sa secrétaire,
et Roger Nimier, l'écrivain qui fut avec Marcel Aymé
l'ami le plus fidèle de la fin de sa vie.
une conspiration du silence commença. Céline avait
toujours dit qu'il souhaitait être enterré dans
l'intimité la plus grande, sans journalistes, sans
photographes. Alors Lucette Almanzor ne prévint que les
plus proches : Colette, la fille que Céline avait eue
d'un premier mariage, Marie Canavaggia, sa secrétaire,
et Roger Nimier, l'écrivain qui fut avec Marcel Aymé
l'ami le plus fidèle de la fin de sa vie.
On cacha sa mort, mais il y eut " fuite " pourtant. Nimier se chargea de
prévenir un petit groupe de fidèles " triés sur le volet
" : Marcel Aymé, l'éditeur Claude Gallimard, le
journaliste (" interdit " à l'époque pour cause de
collaboration) Lucien Rebatet, le metteur en scène Max
Revoll, les comédiens Jean-Roger Caussimon et Renée
Cosima.
Tout ce petit monde s'était rassemblé pour un dernier adieu. Ils se
recueillirent quelques instants devant la bière de
l'écrivain défunt, dans la pièce où il est mort. Un
immense rideau blanc recouvrait la grande fenêtre
donnant sur le jardin. Il y avait aussi deux
journalistes, car Nimier, exécuteur testamentaire de
Céline, avait tenu à ce qu'il y eût des " témoins " :
Roger Grenier pour France-Soir, et moi-même pour
Paris-Presse. Je n'ai jamais très bien su
pourquoi j'avais été désigné pour accompagner Céline à
sa dernière demeure. Peut-être Nimier m'avait-il demandé
expressément ; peut-être Max Corre, le directeur de
Paris-Presse, un peu " gêné aux entournures ",
m'avait-il choisi pour couper court à toute attaque
possible.
Toujours est-il qu'on en est arrivé à ce paradoxe invraisemblable : parmi
la dizaine de derniers fidèles, sélectionnés avec un tel
soin, il y avait un Juif. Céline, l'antisémite notoire,
aurait-il pu imaginer ce curieux renversement de la
petite histoire ? (1)
La cérémonie fut brève. Lorsque le corbillard quitta la
villa Maïtou pour le petit cimetière de Meudon-Bellevue,
il fut suivi par une dizaine de voitures. En cinq
minutes, le " voyage au bout de la mort " fut bouclé.
Nous nous dirigeâmes à pied vers le caveau provisoire, dans le coin du
vieux cimetière. Je marchais pas dans pas avec Rebatet.
Je vous laisse imaginer quelle " tempête sous un crâne "
je vivais. Choisi bien que juif - parce que juif ? -
pour cet ultime hommage à un homme que je haïssais de
toutes mes forces, mais dont je savais aussi qu'il était
incontestablement l'un des plus grands écrivains de
notre temps.
Près de
quarante ans après, je n'ai pas oublié une seconde de
cette courte marche impressionnante. Marcel Aymé est
mort ; Roger Nimier est mort ; nous ne sommes plus
beaucoup à pouvoir dire : " J'y étais. "
Louis-Ferdinand Destouches repose auprès de Maurice Progin, qui fut,
avant-guerre, président de l'harmonie municipale de
Meudon.
(André Halphen, Voyage au bout de la mort, Le Nouvel Observatoire, mars
1983).
Marc HANREZ
- Retour à MEUDON.
Pas que Céline. J'ai eu
l'occasion de rencontrer aussi quelques autres écrivains
: sur qui j'étais en train de travailler ou sur qui je
comptais travailler bientôt. Pour la connaissance et
l'interprétation de leur
œuvre, à vrai dire, cela ne
m'a jamais servi à grand'chose. (Le contraire
signifierait qu'on devrait renoncer à étudier les
classiques).
Je ne suis pas du tout un inconditionnel, un enragé du " seul importe le
texte ", mais j'ai toujours constaté que le rapport de
l'existence à l'écriture, ou inversement, demeure un
problème sinon un mystère que la rencontre avec l'auteur
ne résout point. Du reste, problème ou mystère d'abord
pour l'auteur lui-même. Ce qui justifie pourtant la
démarche, c'est une curiosité, toute légitime, qui tient
de la sympathie, au sens grec du mot, vis-à-vis du
responsable de l'œuvre à
laquelle, par ailleurs, on s'intéresse. Et puis, cette
démarche est parfois récompensée par une nouvelle amitié
(pour moi, notamment, celle d'Abellio : Nimier ayant
disparu, hélas trop tôt pour que ce fût le cas).
(...) Il m'est impossible
aujourd'hui, à plus de vingt ans de distance, de
reconstituer mes cinq visites en détail et dans l'ordre.
Je pourrais peut-être y arriver, mais avec des documents
qui me manquent ici. N'empêche que j'en ai gardé une
série de souvenirs durables. Ma vision de Céline, qui
doit correspondre à ma deuxième visite, est la suivante.
Habillé de son gilet de cuit de l'armée anglaise, avec
une espèce de foulard et un vieux pantalon trop large,
il est debout près de la cheminée du salon qui lui
servait de cabinet de travail. Mon texte en main, il me
complimentait sur la " gnose " dont je l'avais " honoré
"...
Ce qui m'a toujours le plus frappé dans son personnage, c'était le
contraste entre cette allure de clochard ou de bûcheron
et un discours extrêmement châtié malgré l'usage
éventuel de l'argot.
Céline avait un sens inouï, magnifique de la langue, et son parler oral
en était la preuve autant que son style écrit.
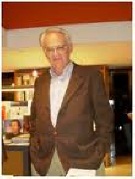 En
réponse à ma première lettre, il m'avait demandé de
l'avertir de ma visite, certains jours étant réservés à
la femme de ménage... (C'était là, bien entendu, de
l'ironie pure, dans le genre de Céline, qui abattait
lui-même, en majeure partie, les travaux ménagers : dont
la cuisine, ainsi que j'ai pu l'observer la dernière
fois.) On avait l'impression qu'il voulait se protéger
des importuns, alors qu'il recevait tout le monde avec
une plaisante, mais réelle bonhomie. En
réponse à ma première lettre, il m'avait demandé de
l'avertir de ma visite, certains jours étant réservés à
la femme de ménage... (C'était là, bien entendu, de
l'ironie pure, dans le genre de Céline, qui abattait
lui-même, en majeure partie, les travaux ménagers : dont
la cuisine, ainsi que j'ai pu l'observer la dernière
fois.) On avait l'impression qu'il voulait se protéger
des importuns, alors qu'il recevait tout le monde avec
une plaisante, mais réelle bonhomie.
Dans mon cas, il était surtout heureux que je m'occupe essentiellement de
son œuvre ; il avait compris
que son meilleur public serait dorénavant parmi la
jeunesse et non dans sa propre génération. Est-ce une
des raisons pour lesquelles, en mars 1959, à mon retour
d'Espagne, il s'est laissé patiemment " ficelé " avec
les fils de mon magnétophone ?
Je ne comptais pas l'interviewer
en bonne et due forme (à la manière d'un journaliste),
mais simplement recueillir un témoignage de sa parole et
de sa voix. Le texte imprimé par la suite n'est que la
sténographie presque fidèle de notre conversation : sans
l'autre dimension sonore, un vrai " bruitage " étonnant,
avec le perroquet qui ne cesse de siffler, la sonnerie
du téléphone auquel je dois répondre pour Céline, la
cloche que je cherche et finis par agiter pour appeler
sa femme qui donne cours en haut... Inévitablement, dès
que le magnétophone s'est mis à tourner, j'ai tout de
même dirigé nos propos vers des questions plus
sérieuses, et c'est pourquoi le résultat peut paraître
une interview sur Céline écrivain.
Mais toujours curieux des choses et des gens, il m'avait d'abord
interrogé lui-même sur l'Espagne et, quand je lui avais
dit que les Espagnols étaient minces : " Parce qu'ils
n'ont rien à bouffer, c'est ça qui les tient en forme.
Aussitôt qu'ils s'enrichiront, ils deviendront laids
comme tout le monde. "
Une autre fois, devant ma femme et peut-être à cause de sa présence,
Céline avait commenté les fortes poitrines des actrices,
qui les obtenaient et les maintenaient de la sorte "
à coups d'avortement. "
Ma toute dernière visite, en 1961,
l'année de sa mort, eut lieu dans la cuisine au
sous-sol, car Louis devait surveiller la cuisson du
dîner - un morceau de poisson qu'il arrosait
régulièrement - pendant que Lucette, encore une fois,
donnait à l'étage une leçon de danse. A côté du
fourneau, sur un lit métallique, un berger allemand
sommeillait. Céline écoutait d'une oreille
Radio-Luxembourg pour connaître le sort de plusieurs
généraux soviétiques dont l'avion venait de s'écraser en
Sibérie au cours d'une mission : " Ils ont trouvé un
nouveau moyen de les liquider... " Bref, toujours le
mot pour rire, et volontiers prophétique, avec le besoin
de choquer l'auditoire en passant. C'était d'ailleurs
parfois tout à fait inutile ce dimanche matin où j'avais
accompagné Nimier à Meudon, après avoir poussé sa 4 CV
noire à chaque feu rouge (il serait sans doute encore
vivant s'il n'avait pas repris son Aston-Martin)...
Les deux amis, les deux complices dans le monde littéraire, faute d'avoir
pu l'être dans la vie, se relançaient la balle sans
merci, en rigolant chaque fois de plus belle, aux dépens
surtout de leur éditeur commun. Mais Céline avait
toujours quelques points d'avance par ses allusions à la
carrière amoureuse du célèbre hussard !
Si mes rencontres avec Céline,
comme je le note au début, se sont passées en marge de
mes travaux sur son œuvre,
il est certain que leur souvenir se mêle malgré tout à
chacune de mes lectures.
Derrière ses mots, ses phrases, je ne peux pas ne pas entendre sa voix.
J'ai aussi à l'esprit la présence du sien que même une
assez longue interruption dans le cours d'un monologue
ne parvenait jamais à dérouter. C'est pourquoi ce qu'on
nomme - et moi-même à l'occasion - le " délire célinien
" doit être pris métaphoriquement : il lui donnait
exactement la tournure et le sens voulus.
On peut donc le considérer comme éminemment responsable de tous ses
textes, y compris les pamphlets qui sont cependant loin
d'avoir été convenablement jugés. Mais cela ne signifie
pas, comme Abellio l'a montré pour l'individu dans le
procès de l'histoire, que Céline, au fond, soit coupable
: coupable d'avoir écrit ce que beaucoup lui reprochent.
Il n'y a de véritable culpabilité que collective. Ou
bien, pour ceux qui le croient, divine.
Lorsque je pense à lui tel que je l'ai connu, j'ai le sentiment que
Céline était un homme qui n'aurait pas fait de mal à une
mouche.
(BC n° 197, avril 1999).
Milton HINDUS.
26
juillet 1948. - [...] Céline déclame contre le peuple
allemand, nouveau bouc émissaire. Il m'assure qu'il
préfère toujours un Juif à un Allemand et qu'il sera
heureux de le déclarer n'importe où. Je lui reproche de
juger les Allemands en bloc, comme les Juifs, et cela le
met en rage. " Vous n'avez pas assez vécu, vous étiez
mal placé pour connaître la vérité, me crie-t-il
avec une explosion de salive. L'Amérique ! Qu'est-ce
qu'on connaît là-bas ? Attendez encore vingt ans, alors
vous pourrez parler. " Je lui dis que, néanmoins, il
doit y avoir individuellement de bons Allemands. "
Bons ? Pff !... Qui parle bonté ? Il doit y avoir aussi
des streptocoques qui sont bons, individuellement. "
Je réplique que la moitié de ses malheurs proviennent de
ce qu'il établit de fausses analogies entre le monde de
la médecine et celui des hommes.
Céline se dit
" pacifiste et patriote "... Je me demande comment il
accorde les deux choses lorsqu'elles se trouvent en contradiction, comme cela se produit parfois. A propos
des insultes dont il accablait les Juifs, il y a dix
ans, il répète cent fois : " J'étais stupide,
stupide, et j'avais tort. " Il me dit que
l'expérience l'a détrompé. Quelle expérience ? Je n'ose
pas insister... Je devine seulement avec horreur.
contradiction, comme cela se produit parfois. A propos
des insultes dont il accablait les Juifs, il y a dix
ans, il répète cent fois : " J'étais stupide,
stupide, et j'avais tort. " Il me dit que
l'expérience l'a détrompé. Quelle expérience ? Je n'ose
pas insister... Je devine seulement avec horreur.
[...] Je l'interroge sur la genèse de son antisémitisme : il me dit que
dans la clinique où il avait travaillé autrefois, les
communistes avaient d'abord essayé de le convertir du
fait qu'il leur fallait quelqu'un pour écrire leurs
slogans (Barbusse était trop vieux à l'époque) et parce
qu'ils pensaient, après le succès fabuleux du Voyage
(salué à la fois par Léon Daudet et la Pravda de
Moscou) qu'il ferait un bon propagandiste. Mais après le
récit désabusé de son voyage en Russie, Mea culpa,
les communistes l'avaient pris positivement en haine et
avaient tenté de le déloger de la clinique. A cette fin,
ils avaient installé à tous les postes disponibles de
cet établissement des docteurs communistes qui tous
étaient des Juifs, semblait-il ; non seulement des Juifs
français, mais russes et polonais. " Alors je me suis
dit : je vais donner une raclée aux Juifs. Mais j'étais
stupide. Ce n'était pas raisonnable du tout. "
[...] Les
Allemands, me dit Céline, ont entendu par antisémitisme
le massacre des Juifs. Mais ce n'était pas du tout ainsi
qu'il le comprenait, lui. Il avait voulu essayer
d'élever les Aryens au niveau des Juifs, de les rendre "
aussi fins " que les Juifs, et de leur permettre ainsi
de mieux rivaliser avec eux. Il n'avait pas voulu qu'on
tue les Juifs... et le massacre des Juifs n'était qu'un
nouvel exemple de la traîtrise, de la stupidité et de la
brutalité allemandes.
A la guerre le meurtre est de règle. Céline a connu lui-même le
bombardement de Dresde où 75 000 personnes furent tués.
Il s'était assis sur des cadavres dans les gares
allemandes où il faisait tellement noir qu'on pouvait à
peine distinguer les morts des vivants. Si les Juifs
sont innocents, des centres urbains comme Dresde et
Berlin le sont également.
[...] Jamais je n'avais senti à ce point que Céline était un poète lyrique
qui n'avait jamais été capable, en fin de compte, que de
peindre un seul caractère : le sien. Cependant, il avait
voulu faire plus, varier son répertoire que le recours
aux procédés limitait fatalement. Dans le Voyage
il ne se peint ni meilleur ni pire qu'il n'est vraiment
et c'est pourquoi le livre en question, que le public a
si bien accueilli, nous offre en exemple de la plus
grande fidélité au réel dont Céline soit capable.
Mort à crédit est déjà un peu fabriqué ; il s'y
peint un peu plus mauvais et un peu plus bête qu'il
n'est réellement. Il y a des passages dans ce livre qui
sonnent faux. Les suivants, Mea culpa, Bagatelles
pour un massacre, L'Ecole des cadavres, Les Beaux draps
et jusque certains passages de Guignol's band qui
rappellent le Voyage, ont tous été encore plus
délibérément truqués et présentent un caractère
artificiel, bestial et nazi de Ferdinand.
Céline souffre maintenant de cette image fabriquée de toutes pièces. Dans
le Voyage, après tout, le lecteur délicat devine,
sous les apparences, la sensibilité et la moralité de
Ferdinand. Mais Céline, doutant de l'effet de son
portrait véritable et s'imaginant que les gens
n'aimaient en lui que la sexualité, les fanfaronnades,
la lâcheté et la laideur " en a remis " pour les
contenter.
Il a
dissimulé assidûment, et avec succès, le meilleur de
lui-même ; il a exploité, exhibé, affiché le pire. Cela
ne correspondait pas à son caractère - sinon il aurait
péri à la fin de la guerre, de ses propres mains ou de
celles d'autrui. Il est vivant, il veut recouvrer la
santé; mais sans savoir comment, et je ne suis pas assez
fort pour le lui dire.
Je demande à Céline s'il blâme les Juifs d'avoir entraîné la France dans
la guerre. Il répond par la négative, puis rectifie :
les Juifs ont eu leur part de responsabilités, mais elle
n'est pas plus grande que celle d'Hitler. Céline a
évolué depuis 1938. Il déclarait alors qu'Hitler était
l'ami des ouvriers, qu'il aidait à sauver la paix de
l'Europe, etc., etc.
30 juillet. -
Céline est aussi bourré de mensonges qu'un furoncle de
pus. L'inciser brusquement risquerait de le tuer du même
coup... ou lui donnerait la possibilité de guérir. Mais
il faudrait au chirurgien qui entreprendrait cette
dangereuse et délicate opération des nerfs plus solides
que les miens. Quel fol donquichottisme m'a fait venir
au Danemark !
Céline est affligé d'autant de prévention, d'ignorance et de vanité que
cette parente à moi qui s'inquiète dès qu'elle apprend
que quelqu'un est tombé d'un toit ou s'est fait écrasé
par un camion : " C'était un Juif ? " Il est tout à fait
primitif et ne sait (ou ne veut, ce qui revient au même)
lutter contre mes arguments. Dans la discussion, il fait
de n'importe quel mot une arme, qu'il manie avec une
violence mortelle. Hier, il m'a dit grossièrement : "
Vous ne savez rien. Ecoutez et apprenez. Est-ce vous qui
avez écrit des livres, ou moi ? Moi, j'ai une grosse
tête, vous une petite. Vous pourrez me comprendre dans
trois ou quatre ans, mais en attendant, bouclez-la !
"
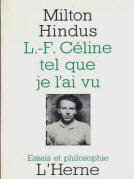 Il
méprise absolument les gens qui l'aident et qui
l'admirent, P..., M..., G... mais surtout M..., parce
qu'il est le plus proche et qu'il l'a le plus aidé. Me
retrouvant après un déjeuner offert par M... : "
Quatre années à Washington, me dit Céline, ne seraient rien, comparées à
toute la diplomatie que j'ai dû déployer durant ces
quatre dernières années
". Puis il se tourne vers
Lucette et ajoute : " Autrefois M... me disait trois
fois par jour combien il aimait les Juifs ; mais je l'ai
guéri de cette habitude. " Il
méprise absolument les gens qui l'aident et qui
l'admirent, P..., M..., G... mais surtout M..., parce
qu'il est le plus proche et qu'il l'a le plus aidé. Me
retrouvant après un déjeuner offert par M... : "
Quatre années à Washington, me dit Céline, ne seraient rien, comparées à
toute la diplomatie que j'ai dû déployer durant ces
quatre dernières années
". Puis il se tourne vers
Lucette et ajoute : " Autrefois M... me disait trois
fois par jour combien il aimait les Juifs ; mais je l'ai
guéri de cette habitude. "
Lucette s'emporte à deux reprises contre lui, ce que je
ne lui avais jamais vu faire encore. La première fois,
comme il jette par mégarde du café en faisant la
vaisselle avec ses gants de caoutchouc noir, elle entre
en fureur et le traite de fou. Ensuite, parce qu'il
l'empêche de prendre une de mes cigarettes en lui disant
qu'elle a trop fumé et que cela la fait tousser toute la
nuit, elle s'énerve et gémit comme une enfant privé de
dessert, mais elle obéit.
Céline est une vipère et il est destiné à connaître finalement le sort de
la vipère, tel que le raconte Esope. Einstein disait de
Marie Curie qu'elle était, à sa connaissance, la seule
personne que la célébrité n'eût pas corrompue. Ce n'est
pas Céline qui le ferait changer d'opinion.
J'avais été déjà indisposé contre Céline
peu avant de quitter Paris, en lisant dans une lettre
qu'il avait envoyée à son ami, le peintre M..., qu'il se
réjouissait d'apprendre que son groupe d'amis de Paris
m'avait " adopté ". J'avais regimbé contre ce mot : je
n'étais pas un chien égaré. Et puis, il y a cet ancien
livre de lui contre les Juifs. L'Ecole des cadavres,
que j'ai trouvé sur les quais à Paris et que je relis à
temps perdu.
Il me raconte son expérience de docteur à bord du paquebot Chella
qui transportait des troupes pendant la dernière guerre.
Le bateau avait été coulé par des torpilles et Céline
cité pour acte de bravoure. A un moment donné, au cours
d'une discussion sur l'antisémitisme, je me suis laissé
gagner par l'émotion - comme lui, d'ailleurs, depuis le
début. Il m'a arrêté net : " Allons ne parlez pas si
haineusement. " Ce mot inattendu m'a aussitôt calmé.
Il me dit
qu'il a plus en commun avec un Juif ayant véritablement
souffert à Buchenwald qu'avec tous ceux qui parlent
en son nom sans avoir souffert eux-mêmes. Les hommes
qui ont connu la souffrance n'ont pas besoin de se
présenter. Ils se reconnaissent au premier coup d'œil.
Au cours de la conversation il a dit, d'abord en
français, puis en anglais : " L'Histoire ne repasse
jamais le plat. " Je lui ai demandé de qui était le
mot. De lui, m'a-t-il répondu.
(Milton Hindus, L.-F. Céline tel que je l'ai vu, L'Herne, 1969).
Mikaël
HIRSCH. Dans son livre Le réprouvé, ce petit-fils
d'un fondateur de la NRF est Gérard Cohen, le garçon de
courses chez Gallimard...
A
l'étage, on entendait par intermittence comme une
cavalcade, des sauts, des piétinements étranges. Bien
que Céline eût tout à fait pu entretenir un bouc dans
les combles, il s'agissait en réalité de sa femme
Lucette qui donnait des cours de danse aux fillettes des
environs.
" Entrez donc là un moment
et n'ayez crainte. Je ne bouffe que du sacerdoce, de la
vocation monastique, j'en bouffe à toutes les sauces.
Vous n'êtes pas un défroqué au moins ? Y a rien de pire
que les anciens curés. Comment vous vous appelez ?
- Gérard.
- Gérard tout court. C'est bien. Je vous appellerai mon p'tit Gérard.
Qu'est-ce vous m'apportez ?
- C'est le courrier de chez Gallimard, Monsieur Destouches.
- Quoi ? Des nouvelles du Bon Dieu, encore lui ! On sera donc jamais
tranquilles. "
On entendit une série de chocs plus ou moins sourds en provenance du
plafond. Je levai alors les yeux vers le lustre qui se
balançait doucement.
" Faites pas attention mon p'tit Gérard. Ce sont les rats. J'en suis
infesté. Vous n'avez pas peur des bêtes au moins ?
- Non... pas du tout Monsieur Destouches.
- A la bonne heure. Au prochain déluge, qui ne saurait tarder, j'aurai
pour mission de repeupler la baraque. Quand la Seine
commencera à grossir, les chiens me préviendront. Alors,
on foutra tout ce petit peuple dans le grenier et vogue
la galère. Après tout, ce sera un monde de chiens, de
rats et de perroquets. Le paradis !
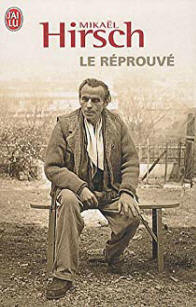 Voyons
voir ce courrier. Voyons
voir ce courrier.
J'ouvris
ma sacoche et lui tendis une liasse de plis.
" Si je comprends bien, on est donc appelés à se revoir mon p'tit Gérard ?
- Je ne sais pas, Monsieur.
- C'est moi qui vous le dis. "
La toute première fois, je fus terrorisé à l'idée qu'il pût me percer à
jour. Les antisémites n'avaient-ils pas des trucs
infaillibles pour reconnaître les Juifs, grandeur
millimétrique du nez, taille des oreilles, épaisseur des
lèvres, bref tout l'arsenal phrénologique propre aux
expositions de Vichy ? L'étais-je d'ailleurs
suffisamment pour que ces critères anthropométriques
soient efficaces ? Je dois dire que mon appréhension
allait de pair avec une certaine curiosité. Si Céline,
dans son délire, s'était souvent entouré de Juifs, je
reconnais qu'il était sans doute mon premier antisémite
véritable.
De cahutes en bordels, de
réseaux de maquisards en sympathisants de la Résistance,
j'avais passé la guerre, pour ainsi dire, coupé de la
réalité extérieure. Mon père m'infligeait-il cette
épreuve à des fins éducatives ? J'avais souvent surpris
des réflexions stupides et ordinaires qui trahissaient
la peur et l'incompréhension, mais jamais je n'avais
connu de théoricien de la haine. Ces penseurs à la rage
viscérale, dont on me rabattait si souvent les oreilles,
étaient restés jusque-là relativement abstraits, telle
la voix de Henriot éructant sur les ondes de Radio
Paris. L'expérience consistait sans doute à
provoquer l'effroi sans risque, foutre la trouille à peu
de frais, comme chez ces enfants qui lancent des
cacahouètes aux ours du zoo de Vincennes. Ou bien, mon
père connaissant tout de mes ambitions littéraires,
s'agissait-il alors d'un pèlerinage à la source, d'une
forme d'apprentissage ?
J'étais tout
ce qu'il haïssait profondément, même pas un véritable
descendant d'Isaac, ce qui m'aurait tout de même conféré
une certaine légitimité dans l'ignominie, mais bien le
fruit d'une union contre nature, la corruption incarnée
de la race blanche par les métèques. Il ne s'aperçut
pourtant de rien. Qui plus est, il eut même l'air de me
trouver sympathique. Eût-il su qui j'étais, son attitude
aurait certainement changé du tout au tout, mais
ignorant de mes origines, il se livrait par moments,
dans son génie et sa hargne concomitantes. J'étais un
interlocuteur neutre, presque un meuble, encore une
fois, un miroir tendu. Pour lui, j'incarnais la
jeunesse, le renouveau des peuples, et l'ironie de cette
situation finit par me distraire à mesure que la crainte
refluait. Au début, je l'observais, ayant en main des
cartes dont il ne soupçonnait pas la nature. Je
profitais de la situation, le regardant presque de haut,
sans s'imaginer une seconde qu'un lien allait naître
entre nous.
Je ne me souviens même pas d'un avant, comme si ce sentiment étrange avait
toujours été présent. La proximité le rendait attachant.
Les évènements m'avaient habitué à l'usage du
pseudonyme. J'appris vite où gratter pour trouver la
matière de Destouches sous le vernis de Céline. Il n'en
restait pas moins rongé par la détestation de soi et du
monde, mais j'ai connu cela, moi aussi. Aux heures
sombres de la guerre, après l'arrestation de Clémence,
je m'enfermais alors dans ma chambre pour y invoquer les
puissances des ténèbres. Je ne voulais plus être sauvé,
car l'espoir entretenait ma peur. Je voulais disparaître
et que tout disparaisse avec moi.
(Mikaël Hirsch, Le réprouvé, roman, J'ai lu, N° 9749, juillet 2011, p.
88).
Lazare
IGLESIS. Ce producteur et réalisateur a rencontré Céline
avec le documentaire En français dans le texte,
où il est interviewé par Louis Pauwels.
Nous
voici à Meudon devant un petit pavillon entouré par un
jardin où courent et aboient rageusement des chiens
bâtards. Au rez-de-chaussée, dans une cage sautille un
perroquet aux sifflets moqueurs. C'est ici que
travaille, vit et rêve Louis-Ferdinand Céline. On entend
à travers le plafond les pas légers des danseuses qui
suivent les cours de Lucie Almanzor, la compagne de
l'écrivain. Et lui, Céline, le visage maigre éclairé par
deux yeux clairs, vêtu d'un gilet de laine informe qui
pend sur un pantalon trop large, ressemble à un
clochard.
Les avatars qu'il a subis après la guerre l'ont blessé mais, le plus
souvent, il pose sur vous de grands yeux tristes et
bons. Il redevient alors le médecin des pauvres de
banlieue. Je l'ai accompagné passage Choiseul devant le
magasin où jadis sa mère vendait de la dentelle, puis à
Courbevoie pour filmer sa maison natale. En le voyant
marcher devant moi, voûté, le pas traînant, je pense à
Bardamu, son héros du Voyage qui nous disait : "
On devient rapidement vieux et de façon irrémédiable, on
s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son
malheur malgré soi. "
A deux
reprises, au cours de notre entretien, Céline s'allège
le cœur d'un poids trop
lourd de hargne envers ceux qui l'ont condamné après
l'Occupation. Je sais que je couperai au montage ces
moments de colère qui feraient scandale, inutilement.
Dans ce reportage, nous n'avons pas à juger l'homme mais
l'écrivain, en sachant cependant qu'on ne peut oublier
l'antisémitisme manifeste de Bagatelles pour un
massacre qui lui vaut l'opprobre légitime de ses
contemporains. Voici un aperçu de ses propos énoncés
dans un débit saccadé, parfois bégayant, et d'une voix
nasillarde à l'accent parigot.
- Devenir
écrivain ? Ah non ! Je n'y pensais pas du tout ! Je
trouvais ridicule de passer son temps à baver des trucs.
Et pourquoi celui-là plutôt que les autres ?
Ça me paraissait d'une
extraordinaire prétention. Non ! Moi j'avais la vocation
de la médecine. Ça m'a fait
longtemps plaisir de guérir un rhume de cerveau, de
soigner une varicelle, de m'amuser avec une rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais " soigneur "
de tempérament. La souffrance de l'homme me touchait. Je
me disais : " S'il souffre, il va être encore plus
méchant que d'habitude et il va se venger. Alors, vaut
mieux qu'il se sente bien... "
rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais " soigneur "
de tempérament. La souffrance de l'homme me touchait. Je
me disais : " S'il souffre, il va être encore plus
méchant que d'habitude et il va se venger. Alors, vaut
mieux qu'il se sente bien... "
Moi, l'homme que j'aime, c'est le constructeur, et celui que je hais, le
destructeur. De même, parmi les écrivains, seuls
m'intéressent ceux qui ont un style, parce que les
histoires, ce n'est pas ça qui manque ! Il y en a plein
la rue, j'en vois partout des histoires, dans les
commissariats, les correctionnelles, tout le monde a une
histoire, mille histoires. Mais un
style, c'est rare ! Il y en a un, deux ou trois par
génération alors qu'il y a des milliers d'écrivains ! Ce
sont de pauvres cafouilleux qui rampent dans des
phrases. Ils répètent ce que l'autre a dit. Ce n'est pas
intéressant... Mon cas est particulier : j'ai cessé
d'être " écrivain " pour devenir chroniqueur, alors j'ai
mis ma peau sur la table, parce que, n'oubliez pas une
chose, la vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne
mettez pas votre peau sur la table, vous n'êtes rien.
Ce qui est
gratuit sent le gratuit, pue le gratuit. Descartes
disait : " Je n'ai pas plus de génie qu'un autre
mais j'ai plus de méthode. " Ma méthode,
c'est de prendre un objet et de le fignoler. Le malheur,
c'est que les gens d'aujourd'hui veulent faire tout très
vite. Alors, c'est un peu comme la chansonnette " Encore une autre ! Donne-nous encore une ! "
Ça c'est de la connerie. Une
affaire qui compte par minutes ne tiendra pas, alors
qu'en vérité une nouveauté c'est l'affaire de cinq cents
années ! Malheureusement, le monde moderne crève d'une
gangrène : la publicité. Elle incite les gens à se
satisfaire de choses immédiates. Moi, je vous avouerai
que je n'ai pas eu beaucoup de joies dans ce monde ! Je
ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un
passager... J'avoue que je serai content quand je
mourrai. Mais de la mort la moins douloureuse, je ne
suis pas assoiffé de souffrance... Si je devais mourir à
l'instant ? Oh putain ! maintenant ce serait un
soulagement ! Je pourrais même me tuer là, devant tout
le monde, ça ferait bien devant la caméra...
Autrefois, j'avais encore des illusions, des raisons de vivre,
tandis qu'aujourd'hui !... Vous savez, pour ce qui
concerne la tristesse ou les chagrins, alors là, minute,
j'ai été servi ! J'en ai eu des quantités ! Pour ça, on
m'a fait tout ce qu'il faut... je n'insiste pas, mais
vraiment, j'ai tout eu !... Alors comment, après ça,
peut-on croire en Dieu ? Moi, je ne crois pas. Non, je
ne crois pas du tout. Je ne demanderais pas mieux mais
non, non. Oh certainement, je suis mystique, mais Dieu
?... Il n'a pas l'air de s'intéresser aux choses qui
m'intéressent... Non, ça non, vraiment non... Mystique,
je le suis certainement. Alors je ne m'intéresse pas aux
gens, je m'intéresse aux choses, et quand les gens
disent du mal de moi, alors, là, je m'en fous énormément
! C'est comme quand on me demande ce que je pense de
l'amour. Et bien, si on considère la vie comme une chose
très amusante, ben, dame, évidemment ! En avant pour l'
" amour " avec toute sa vulgarité ! Moi, je n'aime pas
ce qui est commun, ce qui est vulgaire. Je veux dire
qu'une prison est une chose distinguée parce que l'homme
y souffre, tandis que la fête à Neu-Neu est une chose
vulgaire parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi de
la condition humaine...
Quoi ? Au
moment de mourir, quel sera mon dernier mot ?... Eh bien
! Au revoir et merci ! Je ne vous veux aucun mal mais,
mon Dieu, vous vous occupez bien de vous-même, alors, ça
va. Moi, je m'en suis trop occupé... Au fond, j'ai
manqué d'égoïsme... C'est assez rare. Le monde en est
plein, n'est-ce pas ?
Et tandis que Louis-Ferdinand Céline reprend sa rêverie
crépusculaire, au-dessus de son bureau, où il n'est
jamais monté, les élèves de Lucette Almanzor dansent,
dansent, dansent...
(Lazare Iglésis, La Télévision miroir d'une époque, Témoignage d'un
pionnier, Ed. du Club Zéro, 2002, in D'un Céline
l'autre, D. Alliot, 2011, p.1038).
Jacques
IZOARD.
- Peux-tu nous
raconter dans quelles circonstances tu as été amené à
rencontrer Céline ?
- C'est bizarre... Je suis sûr d'être allé le voir
deux fois, mais les visites se confondent dans ma
mémoire. C'était en 1959. J'avais vingt-trois ans. Je
commençais ma carrière de professeur de français dans
l'enseignement officiel, et je collaborais à deux revues
de critique littéraire. La première était Lettres
fondée par Jean Collette et imprimée à Herve (un village
de la région liégeoise). La seconde était L'Essai,
dirigée par Roger Gadeyne et à laquelle j'ai fait
succéder, au début des années 1970, ma propre revue de
poésie, Odradek.
- Tu as effectué deux interviews différentes de Céline
pour ces publications ?
- Oui, en juin 1959 dans Lettres et, en novembre
1959, dans L'Essai. L'idée de rencontrer Céline
m'avait été au départ soufflée par Jean Collette. En
fait, comme il savait que je me rendais volontiers à
Paris, il m'avait adressé une liste d'écrivains que je
pourrais voir sur place... C'est ainsi que j'ai pu
m'entretenir avec Mauriac, Supervielle, Mac Orlan, Jules
Romains, Gabriel Marcel, etc.
- Que du beau linge, en général ! Que connaissais-tu de
Céline quand tu es allé le voir ?
- Eh bien, pas grand-chose, je dois bien l'avouer.
J'avais lu le Voyage et Mort à crédit,
sans plus, même si j'avais été frappé par le style,
comme beaucoup d'autres lecteurs. Tu sais, j'étais très
jeune, je nouais mes premiers contacts dans le monde
littéraire et, parfois, je me rendais au rendez-vous
fixé sans même jamais avoir vu une photo de l'auteur que
j'allais questionner !
- Ce qui a d'ailleurs donné lieu à une première scène
cocasse avec Céline...
- Mais oui ! j'avais téléphoné, pour savoir s'il
accepterait de me recevoir, et rendez-vous avait été
convenu. Je me suis rendu à Meudon. Une grande plaque
annonçait le " Docteur Destouches, médecine générale "
et les cours de danse de Lucette. J'ai avisé, dans le
parterre en face de la maison, un vieux monsieur qui
arrachait des mauvaises herbes. Je lui ai demandé à
parler à Louis-Ferdinand Céline, et il m'a répondu "
C'est moi ! " de sa voix caverneuse. J'étais saisi car
je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce
personnage, pauvrement vêtu, avec une vieille écharpe !
Puis il m'a dit : " Attendez, je fais rentrer mes dogues
! ", et il a chassé les grands chiens qui
l'accompagnaient.
Il m'a ouvert, je l'ai suivi jusqu'au perron, et là, avant d'entrer, il
m'a tendu un feuillet : " Lisez ça d'abord ! " Il
s'agissait d'un texte de Baudelaire qui se terminait par
ces mots : " Je me suis arrêté devant l'épouvantable
inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce
soit. " La douche froide pour le jeunot que j'étais !
Nous sommes entrés, il a dit à Lucette de nous laisser
seuls, et la discussion a commencé.
- Le texte qui subsiste de votre dialogue traduit
vraiment l'allure du phrasé célinien, sa spontanéité.
Comment as-tu travaillé ?
 - Je n'avais pas d'enregistreur, pas même un
appareil photo ! J'étais impressionné, un peu perdu,
mais en même temps fasciné par le personnage. Alors,
j'ai gratté, gratté chaque mot sur mon carnet, pour ne
rien rater ! J'ai amorcé très traditionnellement par le
questionnaire de Proust, dans la première interview.
Dans la seconde, je l'ai plutôt interrogé sur la
littérature, les écrivains contemporains... - Je n'avais pas d'enregistreur, pas même un
appareil photo ! J'étais impressionné, un peu perdu,
mais en même temps fasciné par le personnage. Alors,
j'ai gratté, gratté chaque mot sur mon carnet, pour ne
rien rater ! J'ai amorcé très traditionnellement par le
questionnaire de Proust, dans la première interview.
Dans la seconde, je l'ai plutôt interrogé sur la
littérature, les écrivains contemporains...
Les réponses fusaient, éruptives, comme à ce moment, désopilant, où je
lui ai demandé son avis sur Sagan. Il l'a expédiée en
deux coups de cuiller à pot : " Elle n'a pas de cuisses.
Regardez donc son anatomie ! Médicalement parlant, ça
fait du cinq sur vingt ! "
- Il y a en effet des jugements très radicaux, voire "
nihilistes " de Céline, sur l'homme et sur l'époque en
général, dans les propos que tu as consignés. Comment
l'as-tu trouvé, lui, humainement s'entend ?
- Très sympathique, en fait, et aimable. Mais on sentait
qu'une amertume de fond le travaillait. Il n'était pas
du tout inscrit dans un " rôle ", comme on a tendance à
le croire. Il m'est apparu comme très naturel, tel qu'en
lui-même, et je crois d'ailleurs qu'il n'avait aucun
intérêt à prendre la pose face à un journaliste débutant
tel que moi...
- A-t-il refusé à un moment de répondre à certaines
questions ?
- Non, mais il y a quelques bribes que je n'ai pas
reproduites. Par exemple, il insistait très fort sur
l'importance du style. D'un geste, il désignait de gros
volumes empilés contre le mur, pour dire d'un ton
désabusé " Les idées ? Elles sont dans les dicos, les
idées ! "
A un autre moment, je lui ai très naïvement proposé de venir faire une
conférence à Liège. Là, il a eu l'air ahuri et m'a
rétorqué : Vous voulez qu'on m'assassine, ou quoi ? " Il
a aussi refusé de me dédicacer un de ses ouvrages, ce
qui, d'après ce que j'ai appris par la suite, n'était
pourtant pas dans ses habitudes. Mais il m'a donné un
petit bout de papier, sur lequel il a apposé sa
signature, d'un air bougon.
- Tu as rencontré nombre d'auteurs importants à
l'époque et par la suite. Y a-t-il quelque chose de
spécifique au contact de Céline, que tu n'as pas été
amené à trouver chez les autres écrivains ?
- Je crois que ce que j'ai le plus apprécié, c'est que
ce n'était pas tiède avec lui, comme cela peut l'être
souvent avec certains auteurs beaucoup plus imbus de
leur personnalité. J'ai le souvenir de Mauriac, qui m'a
reçu nonchalamment, à moitié allongé sur un sofa, et qui
balayait l'air de sa main en disant : " Dans ma vie,
j'ai tout eu... "
Avec Céline c'était très intense. Ce qui m'a frappé, c'est que les
entretiens ont duré environ une heure chacun, et qu'il
était toujours animé du même mordant ! En plus,
physiquement, il m'a semblé en forme, ses propos n'en
apparaissaient que plus énergiques. Il y avait une force
de conviction peu commune en lui, et beaucoup de
contrastes au niveau des sentiments qu'il faisait
passer. C'est un personnage qui m'a marqué, au point que
je dois bien reconnaître que ma deuxième visite était
plus motivée par un intérêt personnel envers lui que par
la simple perspective de lui soutirer des réponses.
- As-tu continué
à t'intéresser à son œuvre ?
Qu'en retires-tu ?
- Oui, je l'ai plus lu par la suite, et je m'intéresse à
tout ce qui le concerne dans la presse, lorsqu'il y a
une publication à son sujet. Finalement, je pense que
c'est plus une haine générale de l'humanité qu'il
éprouvait. On le voit jusque dans la lecture de ses
pamphlets : il était antisémite, mais il n'aimait pas
non plus les nazis pour la cause !
C'était, à mon sens, un immense misanthrope, mais assez touchant à sa
manière.
(Propos recueillis par F. Saenen, 13 juin 2008, L'homme qui a vu
l'homme, BC n°300, sept. 2008).
Visite « pèlerinage » de Marc LAUDELOUT à
Meudon, août 1978.
Débarquant du train Bruxelles-Paris, je me rendis à
Montparnasse afin d’y prendre le train de banlieue pour
Meudon. En mémoire le mot de Céline à Lucien
Combelle : « Dix minutes de dur… On descend à
Bellevue… » C’est là qu’au milieu de la matinée je
descendis à mon tour, me rendant ensuite à pied route
des Gardes. Quelque peu embarrassé par les aboiements
des nombreux chiens que ma présence immobile suscitait
devant la grille, je me plaisais à rêver d’une entrevue
avec la gardienne des lieux. Sans doute m’y étais-je mal
pris et aurais-je dû prier François Gibault de
m’accompagner chez Lucette.
Je m’apprêtais à partir
lorsqu’elle arriva, vêtue d’un peignoir, pour relever sa
boîte aux lettres. Impossible de ne pas la reconnaître :
ce grand front, ce turban, cette allure… Je la saluai et
me présentai. « Voulez-vous prendre une tasse de thé ? »
Bingo ! Seule ma jeunesse, n’en doutons pas, fit office
de sésame.
« C’est pour la jeunesse que Céline écrivait parce
qu’il savait bien n’avoir plus rien à attendre de ses
contemporains qui ne l’avaient pas compris », me
dira-t-elle ce jour-là.
On imagine l’émotion qui était la mienne. Lucette
n’était pas alors la dame très âgée qu’elle est devenue.
Elle avait soixante-sept ans, l’âge de Céline lorsque la
canicule le terrassa. Une vingtaine d’années auparavant,
le personnage qui venait d’achever Mort à crédit
n’avait rien de commun, on l’oublie parfois, avec le
misanthrope dépenaillé de Meudon : « Un Gatsby
nonchalant, habillé avec soin, décontracté, d’une beauté
incroyable. »
Alors même que j’avais en quelque sorte forcé sa
porte, je fus touché par l’accueil de Lucette. C’est
avec la plus grande gentillesse qu’elle reçut ce jour-là
le parfait inconnu que j’étais. Nulle surprise à la
réflexion , je connaissais par cœur le panégyrique
célinien : « Ma femme, la meilleure âme du monde,
Ophélie dans la vie, Jeanne d’Arc dans l’épreuve, tout
en gentillesse, dons, bienveillance, amour. »
 Avisant mon appareil photographique, Lucette me dit : « Dommage
qu’il n’y ait pas grand-chose à voir. »
Comprenait-elle que le seul fait de me retrouver dans
cette maison, en sa compagnie, était déjà pour moi
extraordinaire ? Après m’avoir montré l’endroit où
Céline travaillait – « Je l’ai vu écrire en transe,
dans un état second. » -, elle évoqua quelques
souvenirs, dont ce journaliste (à qui on doit tout de
même l’un des trois seuls entretiens filmés avec Céline)
qui prenait pour argent comptant les énormités que
Céline lui assénait. Avisant mon appareil photographique, Lucette me dit : « Dommage
qu’il n’y ait pas grand-chose à voir. »
Comprenait-elle que le seul fait de me retrouver dans
cette maison, en sa compagnie, était déjà pour moi
extraordinaire ? Après m’avoir montré l’endroit où
Céline travaillait – « Je l’ai vu écrire en transe,
dans un état second. » -, elle évoqua quelques
souvenirs, dont ce journaliste (à qui on doit tout de
même l’un des trois seuls entretiens filmés avec Céline)
qui prenait pour argent comptant les énormités que
Céline lui assénait.
[…] A un journaliste qui lui demandait si elle s’était
parfois ennuyée avec Céline, elle se récria : « Je
m’ennuie beaucoup maintenant ! » Pourtant ce ne fut
pas toujours un chemin de roses. Il est commun de dire
qu’elle épousa son destin, jusque dans les épreuves de
l’exil. Deux photographies, où elle figure aux côtés de
Céline, témoignent de la période directement
antérieure : l’une prise en mai 1941 (inauguration de
l’institut des Questions juives) et l’autre en février
1942 (meeting de Jacques Doriot au Vel’ d’Hiv). Que
pensait-elle dans ces moments-là ? « Tu envoies un
pavé qui va te retomber sur la tête ! », lui
aurait-elle dit avant la parution de Bagatelles…
Tout ceci appartient au passé, nécessairement
qualifié de « sulfureux » aujourd’hui. Au début des
années 1980, Lucette a demandé, par voie de justice, la
saisie et la destruction des éditions italiennes des
pamphlets, ce qui lui valut d’être appelée « la veuve
Pilon » par Libération. Depuis elle n’a autorisé
que la publication de Mea culpa, des lettres
écrites pendant l’Occupation et de la préface de
L’Ecole des cadavres. Ce choix lui appartient.
Durant toute sa vie, elle s’est intéressée à la danse,
pas à la politique. On lui a parfois conseillé de ne pas
aborder ce sujet à haute tension. Sans doute était-ce
plus opportun. « Pendant la guerre Céline a été
neutre. Il n’avait pas de contact avec l’occupant. Il
n’a rien écrit pendant ces années-là. » Il m’eut été
trop facile de la contredire sur ces trois points
précis. « Il fallait le deviner, les paroles étaient
inutiles et superflues avec lui » ajouta-t-elle.
Plus prosaïquement, je me souviens qu’à un moment elle a
évoqué les difficultés que Céline éprouvait à cause de
son bras droit suite à sa blessure de guerre. Très
pudique, il n’expliquait rien et tendait la main gauche
pour saluer les visiteurs. « Les gens étaient souvent
offusqués, prenant cela pour du mépris. »
Au cours de notre conversation, je relevai aussi
l’hommage appuyé à la dédicataire de Voyage au bout
de la nuit : « Elizabeth a très bien compris qui
était Céline. » Par la suite, elle la jugera plus
sévèrement, j’en ignore la raison. J’avais aussi noté la
manière franche avec laquelle elle décernait les bons ou
mauvais points aux amis de Céline. Jugements acerbes
pour la plupart d’entre eux, hormis à l’égard de Marcel
Aymé, le fidèle des fidèles. Mais Albert Paraz ?
« Vulgaire, homme à femmes obsédé par le sexe. Céline
avait pitié de lui en raison de sa grave maladie. »
Au sujet de Robert Poulet, elle faisait sien le jugement
de Céline, après la publication des Entretiens
familiers : « Il n’a rien compris ! » Propos
louangeurs en revanche sur Nicole Debrie, « mystique
comme l’était Céline », et sur Jean-Marie
Turpin (qui n’avait pas encore écrit Le Chevalier
Céline), « un réel don d’écrivain ». D’Henri
Mahé, elle retenait seulement qu’il avait publié la
correspondance de Céline sans son autorisation. Je
n’osai lui rappeler cette phrase, tirée d’une lettre de
Céline d’ailleurs produite au cours du procès : «
Publie mes lettres si tu veux, mais après ma mort qui ne
saurait tarder. » Mais je n’ignorais pas qu’elle
considérait cette lettre comme un faux. Sur Erika
Ostrovsky, Lucette ne ménagea pas ses mots : « Elle a
surtout rassemblé des ragots. » Et d’évoquer les
nombreux entretiens étalés sur quatre ans auxquels elle
la soumettait : « C’était éreintant. » L’auteur
en aurait voulu à Lucette, la rendant responsable du
refus de Gallimard d’éditer cette première tentative
biographique.
Nous avons ainsi devisé pendant une heure. Le sommet
de l’œuvre célinienne selon elle ? « Nord, sans
hésiter. » Ses lectures ? « Des polars. » Et
d’évoquer dans la foulée tel célinien se piquant de
littérature : « Il doit se chatouiller pour ressentir
quelque chose. » Où l’on voit que les jugements
décapants n’étaient pas l’apanage de son illustre mari.
Vint le moment de prendre congé. « Revenez me
voir », me dit-elle très gentiment. C’est ce que je
fis au printemps suivant, en compagnie de mon vieil ami
Pierre Dubois, heureux détenteur des épreuves de
Scandale aux abysses resté sur le marbre en juin
1944. Je n’ai pas noté ce qu’elle me dit ce jour-là. En
revanche je garde parfaitement en mémoire la joie de ce
célinien de la première heure. Nul doute qu’il s’en
souvient également.
(Madame Céline Routes des Gardes,
avril 2012).
Visite de Pierre-Jean LAUNAY journaliste à Paris-Soir
au dispensaire – Premier journaliste à le surprendre…
(10 novembre 1932).
Lorsqu’un auteur se cache aussi soigneusement que
Louis-Ferdinand Céline, l’interview devient du sport.
Pour arriver d’abord à connaître le vrai nom de cet
écrivain, son adresse (à laquelle il n’est d’ailleurs
jamais) et pour enfin le surprendre en pleine occupation
il m’a fallu employer des ruses de Sioux.
Je craignais d’un tel homme une grande désillusion.
Qu’allait être ce révolté qui, au cours de 600 pages,
nous étale les pires misères de notre société ? Il est
heureusement l’homme de son livre. misères de notre société ? Il est
heureusement l’homme de son livre.
- Puisque vous m’avez déniché, je n’ai pas la cruauté
de vous renvoyer, tant pis. Mais vous êtes le premier
journaliste qui me surprenne et vous serez le dernier,
demain je pars.
Alors j’ai dû engager ma parole de ne rien révéler de
la personnalité de Céline, et je le regrette.
- Qu’importe mon livre ? Ce n’est pas de la
littérature. Alors ? C’est de la vie, la vie telle
qu’elle se présente. La misère humaine me bouleverse,
qu’elle soit physique ou morale. Elle a toujours existé,
d’accord ; mais dans le temps on l’offrait à un Dieu,
n’importe lequel. Aujourd’hui, dans le monde, il y a des
millions de miséreux, et leur détresse ne va plus nulle
part. Notre époque, d’ailleurs, est une époque de misère
sans art, c’est pitoyable. L’homme est nu, dépouillé de
tout, même de sa foi en lui. C’est ça mon livre.
Et Céline me dépeint longtemps certaines des misères
et des lâchetés dont il est le spectateur quotidien,
mais une question m’obsède, car à son nom j’associe ceux
de Vallès et de Léon Bloy.
- Pourquoi avez-vous écrit Voyage au bout de la nuit dans
une langue si volontairement faubourienne ?
- Volontairement ! Vous aussi ? C’est faux, j’ai écrit
comme je parle. Cette langue est mon instrument. Vous
n’empêcherez pas un grand musicien de jouer du cornet à
piston. Eh bien ! je joue du cornet à piston. Et puis je
suis du peuple, du vrai… J’ai fait toutes mes études
secondaires, et les deux premières années de mes études
supérieures en étant livreur chez un épicier.
« Les mots sont morts, dix sur douze sont inertes.
Avec ça, on fait plus mort que la mort. »
« Et puis, la littérature importe peu à côté de la
misère dont on étouffe. Ils se détestent tous… S’ils
savaient s’aimer ! »
Les yeux de Céline expriment une telle tristesse que
je n’ai pas voulu lui en demander plus.
Sur le seuil il me recommande à nouveau :
- Laissez-moi dans l’ombre. Ma mère même ne sait pas
que j’ai écrit ce livre, ça ne se fait pas dans la
famille.
(Cahiers Céline I, Gallimard, 1976).
Hervé LE BOTERF,
" L.F. Céline : Je fais de la Télé
pour vendre mes livres ", Télémagazine n°190, 14-20 juin
1959.
Dans son petit pavillon de
Meudon, le romancier " maudit ", Louis-Ferdinand Céline,
poursuit, avec une sage lenteur, la rédaction de Nord,
cette chronique de l'Allemagne en déroute et de la
Prusse démantelée qui fera suite à son recueil de
souvenirs D'un château l'autre.
Sans illusion sur le succès que connaîtra sa nouvelle
œuvre, l'auteur du Voyage
au bout de la nuit fait, à sa façon, le procès de la
littérature française contemporaine.
- Le roman ne rime plus à rien car il n'apprend plus
rien. Du temps de Flaubert, on pouvait encore apprendre
à être cocu en lisant Madame Bovary !... Aujourd'hui la
radio et la télévision se préoccupent d'instruire le
populo et il ne reste plus qu'un million de têtards qui
exigent que les romans ressemblent à leur journal
habituel. Ce qu'ils veulent, c'est être informés... On
achète Sagan ou le Goncourt chez la mercière... mais ne
leur parlez surtout pas de " style ".
Ça, ils n'en veulent à aucun
prix... Tant pis pour moi qui suis avant tout un "
styliste
".
Cette fameuse Télévision consterne d'ailleurs Céline :
-
Après l'alcool et le
tabac, c'est le coup de buis final ! Maintenant, on fait
des repas à la TV. Parole ! Vos potes vous disent : "
Venez donc casser la croûte à la maison, vous verrez
Aznavour ! " Et tout en buvant et en mangeant on regarde
le spectacle... parce que le poste est obligatoirement
placé devant la table de la salle à manger... Maintenant
le mal est fait. D'ailleurs vous ne pouvez pas lutter
contre Aznavour : il a la midinette pour lui !
(...) Céline
aime profondément son sol. Il n'est que de l'écouter
vanter le seul pays au monde où il fait encore bon vivre
:
- Il y a tout ce qu'il faut en France. C'est un
véritable paradis. Tenez, en Bretagne, par exemple, les
choux-fleurs et les artichauts poussent à volonté, sans
qu'on ait besoin de les arroser. Un climat comme le
nôtre, vous n'en trouvez nulle part ailleurs. Au nord de
nos frontières, il fait froid ; au sud, il fait chaud ;
à l'est, on est obligé de passer des bottes pour lutter
 contre
la pluie. Les Romains, eux, l'avaient si bien compris
qu'ils n'ont pas hésité à envahir la Gaule avec Jules
César pour se sentir enfin au frais. contre
la pluie. Les Romains, eux, l'avaient si bien compris
qu'ils n'ont pas hésité à envahir la Gaule avec Jules
César pour se sentir enfin au frais.
Ce qui l'afflige, en revanche, c'est la désaffection du
Français pour tout ce qui est français.
- Tenez, dit-il, j'ai
connu autrefois un curé à Clichy-la-Garenne qui avait
décidé de dire sa messe en français sous prétexte que
ses paroissiens ne comprenaient pas le latin. On l'a
déplacé, bien sûr, mais son truc n'avait pas pris... On
m'a expliqué que c'était
parce que les gars manquaient de foi. Le Français bouffe
trop... Il va en crever. La décadence s'est installée
dans les mœurs, fort
agréablement...
C'est Bizance-sur-Sèvres. Il n'y a plus qu'à attendre, le temps qu'il
faudra, car tout se passera très gentiment. Je dirais
même " biologiquement ", car le sang jaune et le sang
noir sont actuellement dominants. Le blanc n'est plus
qu'un fond de teint... Il ne faudrait pas oublier qu'il
y a des milliards de Chinois et de Russes qui crèvent de
faim. Un jour ou l'autre, on va leur faire miroiter un
nouveau dessin de Breughel représentant la Terre
promise... Et vous allez les voir arriver en rangs
serrés avec leur parapluie, leur cuiller, leur cure-dent
et leur verre à boire... Un raz de marée sur la Dordogne
! Un petit stage touristique à Bercy et une incursion
dans les Charentes ! Tous, les Tartares, les Kirghiz, en
bikini, déjà gagnés par les charmes de notre existence !
" On vient pas pour vous tuer, diront-ils... mais pour
bouffer... " Au bout d'un mois de ce régime, d'ailleurs,
ils seront bons à ramasser à la petite cuiller !...
La perspective d'une guerre
ne lui semble pas pensable :
- Les tuer ? Mais ils s'en moquent. Il naît un Chinois
par seconde... La bombe atomique ? Un coup de canon de
75, pour eux... Ils sont trop nombreux. Il n'y a même
plus l'espoir de la peste ou d'une épidémie. On leur a
apporté l'hygiène ! Les cavaliers de l'Apocalypse
peuvent rentrer à l'écurie. Reste peut-être le cancer...
mais le fléau semble déjà menacé !
Tout ce que je demande, maintenant, c'est qu'on me laisse faire mon petit
boulot d'écrivain, bien tranquille. Enfin le Voyage
et Mort à crédit vont être publiés dans la collection
de la Pléiade, je mentionnerai sur mes cartes de
visite " édité à la Pléiade ", de la même façon
qu'Alphonse Allais faisait suivre son nom de la mention
" abonné au gaz ".
Le soleil va se coucher. Céline observe, une dernière fois, ses
fleurs avant de regagner son bureau et soupire :
- Oui, la France est un merveilleux pays de vacances.
Robert MASSIN.
Rencontre avec Céline.
La scène se passe à Copenhague, en octobre 1947.
En Suède, on m'avait dit : " Il habite chez un peintre nommé Jensen. "
Jensen, c'est un nom connu à Copenhague : il y a
plusieurs milliers de Jensen dans l'annuaire du
téléphone. J'ai dû m'adresser en " haut lieu ". On m'a
donné une adresse.
La concierge n'est pas chez elle. Elle n'est pas dans la cour, ni dans
l'escalier. Les gosses de la concierge ne savent pas. Je
fais tous les étages. Finalement, au cinquième, sous le
toit, une porte et une plaque : " Maler Henning Jensen
".
" Non, M. Jensen est sorti... Céline ? C'est moi que vous voulez voir ?
Entrez donc. "
Je me trouve
soudain entre les murs mansardés d'une piaule de "
quartier ". Lucarne, divan, lit de camp, table (papiers
et feuilles volantes), poêle de fortune (d'infortune),
tapis poil de chèvre, toiles sans cadre aux murs et dans
les coins entassés. A côté, une pièce minuscule, grise :
assiettes sales, réchaud à l'alcool, papiers gras,
bouteilles vides, tout ça à même le pavé. C'est
classique.
Devant moi un homme sans âge, le type solide, costaud, resté relativement
jeune jusqu'à cinquante et quelques et qui s'est mis
tout d'un coup à vieillir trois fois plus vite. Il agite
des bras longs qu'il replie soudain sur lui avec des
instincts de parapluie. La tête du toubib à qui des
malades ont fait passer plusieurs nuits blanches. Celle
de Bardamu de Voyage, quand il courait après ses
honoraires, dans les rues de La Garenne-Rancy. Cheveux
noirs, mal entretenus, yeux bleus chavirant sur une face
jaunie, essuie une paire de besicles monture aluminium.
J'ai envie de dire : " Alors vous êtes Céline ? " C'est lui qui demande :
" Alors, vous êtes français ? Qu'est-ce que vous faites
à Copenhague ? "
Céline parle
comme un livre de Céline. Sa conversation est un
monologue. Un monologue d'une logorrhée inépuisable. " Figurez-vous qu'on m'a remis en liberté. Autrement dit,
depuis six mois, je suis prisonnier sur parole. Pourquoi
je ne rentre pas en France ? Moi, je veux bien. Mais on
me l'a déconseillé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça ne fait rien : quelle
gloire ! Je suis le seul, parmi tous ceux que vous
appelez les " sales collabos ", qui ait choisi le
Danemark. Vous avez beau chercher dans l'Histoire, dans
l'histoire de France s'entend, puisqu'il n'y a que
celle-là, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui se
soient réfugiés ici. Il y a bien les huguenots. Et puis
plus tard, un certain Richelieu des Entrayes (?), des
petits nobles, quoi - qui serraient les fesses devant
les colères royales ou des ferveurs républicaines... "
Figurez-vous qu'on m'a remis en liberté. Autrement dit,
depuis six mois, je suis prisonnier sur parole. Pourquoi
je ne rentre pas en France ? Moi, je veux bien. Mais on
me l'a déconseillé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça ne fait rien : quelle
gloire ! Je suis le seul, parmi tous ceux que vous
appelez les " sales collabos ", qui ait choisi le
Danemark. Vous avez beau chercher dans l'Histoire, dans
l'histoire de France s'entend, puisqu'il n'y a que
celle-là, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui se
soient réfugiés ici. Il y a bien les huguenots. Et puis
plus tard, un certain Richelieu des Entrayes (?), des
petits nobles, quoi - qui serraient les fesses devant
les colères royales ou des ferveurs républicaines... "
Je ne sais si
Céline a particulièrement étudié la question des
réfugiés politiques au Danemark, ou s'il est tout
simplement calé en histoire (de France). Mais je dois
dire qu'il est à peu près imbattable là-dessus. De son
interminable digression, j'ai été obligé de le ramener
discrètement à Céline, écrivain français, auteur du
Voyage-au-bout-de-la-nuit-pour-beaucoup-de-gens, et
d'autres choses aussi.
" Vous ne la connaissez pas, mon histoire ? Ce qu'on a pu écrire de
conneries sur mon compte ! Tous, à qui mieux mieux. Et
vas-y pour le traître Céline, le néfaste Céline,
l'apologiste de la lâcheté... Haineux, aigres-doux,
vendus et revendus, volés, ramassés... C'était à qui
gueulerait le plus fort. Tous des braves. Ils voulaient
ma peau. Pour quoi en foutre, bon Dieu ?...
" Ceux d'hier partis, pendus, dispersés, encavés, vous en avez d'autres,
les mêmes. A Sigmaringen, fallait voir ça. Quelle pagaïe
! Des rats, des messieurs, des ambassadeurs, des pauvres
types, et moi avec. Il y en a bien qui ont trouvé le
moyen de retourner dans l'autre camp - celui à la
mode... Parfaitement : un ambassadeur. Autrefois, il
était à Vichy. Aujourd'hui - l'année dernière - il m'a
emmerdé à Copenhague. Vive la France : il a fait un
rapport contre moi devant la justice danoise. De quoi se
mêle-t-il ? Et si j'en faisais un contre lui ?
" Vous voyez
: à leur goût, je n'ai pas été assez dégueulasse. Pour
que tout se soit arrangé, il leur eût fallu un beau
criminel de guerre. Parfait, sans retouches. Là, on
m'aurait réexpédié en France, en port dû. Mais non, ça
ne colle pas : je suis seulement un " collaborateur ".
Je suis étiqueté. Mais c'est pas suffisant pour qu'on ne
veuille plus de moi ici.
[...] Et puis, parce que je ne suis pas sémite ou philosémite, je suis un
vendu et un traître. Je l'ai dit à quelqu'un et je vous
le répète : les Juifs devraient m'élever une statue pour
le mal que je ne leur ai pas fait et que j'aurais pu
leur faire. Est-ce que j'ai jamais dénoncé ou tué
personne ? Mais entre nous, vous ne trouvez pas que plus
d'un de nos écrivains actuels doit une fière chandelle à
M. Hitler ?... A propos, une agence de presse prétendait
ces jours-ci que Hitler se serait réfugié au Danemark.
De là à conclure que c'est un petit copain à moi...
Ça vous fait rire ? On se
dit : " Céline, il est capable de tout, ce coco-là !...
"
Heureusement que je suis là, au fond, pour amuser la galerie. Car tout
ça, ça l'amuse. Et puis je fais vivre les échotiers. Ils
trouvent des trucs drôles pour faire rire les gens : "
Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du
Danemark ", etc. Jusqu'au Deuxième Bureau qui m'a fait
demander un jour si je voulais lui communiquer
l'adresse de Déat. Hein ? Et moi qui ai toujours soutenu
que Hitler, pour faire la guerre, était payé par les
Juifs. Pas les petits Juifs, bien sûr, pas par ce grand
ramassis de miteux dans mon genre - non, par les autres,
nos Maîtres, avec une majuscule. Enfin, là-dedans, si je
comprends bien, je suis le seul patriote. C'est tout
démontré : j'en crève aujourd'hui.
" Vous voulez savoir comment je vis ? Mes droits d'auteur ? Comme vous
dites ! Ah oui : je suis mutilé de guerre à
soixante-quinze pour cent. Encore une chance. Je ne
connais personne à Copenhague. Que ce brave type de
peintre. Il y a bien un professeur d'université en
Amérique qui ne m'oublie pas trop souvent. Des éditeurs
américains m'ont fait des propositions. Ils m'emmerdent.
Je veux me faire imprimer en français. Si je travaille ?
Heureusement ! Je n'ai que ça à faire.
 "
Dites-donc, si je comprends bien, il n'y a plus
d'écrivains en France ? Est-ce qu'on les a tous fusillés
? D'accord avec vous : au temps des Allemands, il y
avait des petits arrivistes genre Rebatet. Mais
aujourd'hui vous en avez d'autres qui les valent bien.
Sartre ? vous êtes sûr que ce n'est pas un sémite [sic]
? Un livre sur la question juive ? C'est bien ce que je
vous disais ! J'en vois bien quelques-uns, comme
Prévert, qui ne soient pas torturés à chaque coin de
page par la marotte de la civilisation. Ou par le petit
idéal universel, politique, existentialiste, je ne sais
quoi. Après tout, s'ils puent les hommes, c'est bien
fait pour nous. Fallait s'en occuper davantage. " "
Dites-donc, si je comprends bien, il n'y a plus
d'écrivains en France ? Est-ce qu'on les a tous fusillés
? D'accord avec vous : au temps des Allemands, il y
avait des petits arrivistes genre Rebatet. Mais
aujourd'hui vous en avez d'autres qui les valent bien.
Sartre ? vous êtes sûr que ce n'est pas un sémite [sic]
? Un livre sur la question juive ? C'est bien ce que je
vous disais ! J'en vois bien quelques-uns, comme
Prévert, qui ne soient pas torturés à chaque coin de
page par la marotte de la civilisation. Ou par le petit
idéal universel, politique, existentialiste, je ne sais
quoi. Après tout, s'ils puent les hommes, c'est bien
fait pour nous. Fallait s'en occuper davantage. "
Un chat m'a
frôlé la jambe. Je ne l'avais pas remarqué, ce chat.
" Le chat de Le Vigan. Je l'ai ramené ici dans une couverture ? Il
m'a suivi partout comme un chien. "
Un silence. Céline se prend la tête, regard perdu.
" Je suis un con. "
Puis il recommence : il est question de Claudel et d'Aragon, de Thorez et
de De Gaulle, de Mauriac et d'Abetz.
Tout ce monde patauge bientôt dans une effroyable dysenterie. Céline
crache la vie. Vomit la terre entière. Je suis parti
avant la fin du monologue. Je lui ai tout de même
souhaité bon courage.
Je dis cela à tout le monde, depuis quelque temps.
Post-scriptum
" Louis-Ferdinand Céline est à Copenhague, où d'abord
il fut emprisonné, puis soigné dans un hôpital. Sans
argent, misérable, en proie aux malédictions de ses
contemporains autant qu'aux siennes propres, que lui
suggère un esprit maladivement excessif, l'auteur du
Voyage au bout de la nuit voudrait qu'on lui permît
de revenir en France. Mais on sait quelle terrible
accusation l'y attend.
Il y a quelques semaines, Céline écrivait à Combat une
lettre que ce journal a publiée. On a vu là sa première
manifestation publique depuis sa mise en liberté par les
autorités nordiques. En imprimant aujourd'hui le récit
d'une entrevue qu'il eut avec un reporter français,
La Rue ne prétend point plaider pour un homme dont
le sort dépend de la justice. Simplement elle veut
dépeindre un aspect de l'aventure vécue par un écrivain
dont le talent, les défauts et les erreurs politiques se
disputent encore les sentiments de nombreux lecteurs. "
Ce
commentaire du journal dans lequel parut mon interview,
en novembre 1947 (1),
et qui avait été rédigé, bien à mon insu, par Michel
Hincker, est ce que Céline appela, dans une des lettres
qu'il m'écrivit ensuite, une " petite merde post-scriptale
". J'avais rencontré Céline le 13 octobre, jour de mon
anniversaire, et j'avais passé environ trois heures avec
lui. A la fin, j'avais pris Bébert sur mes genoux. Un
détail qui ne manque pas de rendre jaloux Frédéric
Vitoux, qui lui a consacré un livre.
(Robert Massin, Journal en désordre 1945-1995, Robert Laffont, 1996).
(1) Robert Massin, Rencontre avec Céline, La
Rue, n° 12, novembre 1947.
Visite d'Armin MOHLER.
Ancien secrétaire d'Ernst Jünger et théoricien de la "
Révolution conservatrice ", est décédé ce 4 juillet
2003. En hommage à cette grande figure, nous
reproduisons la relation de sa visite à Céline, en
novembre 1956.
Ce texte a été publié au moment du décès de l'écrivain.
(...) En l'année 1932, l'irruption de Céline dans le
jardin de la littérature, si bien entretenu par
l'Académie française et par la Sorbonne, constitue en
vérité le dernier grand évènement des lettres françaises
(et non pas de la littérature).
Son premier roman venait de paraître à l'époque, Voyage au bout de la
nuit (le titre est repris d'une chanson sur la
bataille de la Bérésina que chantaient les soldats
suisses qui avaient accompagné Napoléon en Russie).
Céline y introduit non seulement l'argot, mais la langue
telle qu'elle est réellement parlée, vécue, haletante,
ce qui a insufflé une vigueur nouvelle aux lettres de
son pays.
(...) Nous sommes à la lisière de Meudon, dans un triste
paysage de banlieue, une banlieue faite de brics et de
brocs : des rues dont la construction a commencé, des
jardins entamés, des maisons plantées là dans un style
inadéquat. La maison qui se trouve à l'arrière du jardin
est construite en style classique, mais la pauvreté et
la solitude semblent s'y être insinuées.
Quelqu'un a fait signe après notre coup de sonnette, nous pénétrons dans
le jardin et nous nous dirigeons vers la maison. Le
chemin, assez long, qui y mène, longe les cages de
dogues danois et de chiens loups dont s'entoure le
misanthrope Céline ; les chiens exhibent leurs mâchoires
derrière un treillis de fer, puis derrière une porte de
verre, située au sous-sol de la maison.
(...) La figure qui nous avait fait signe depuis la fenêtre du
rez-de-chaussée se trouve maintenant près du coin que
forment les murs de la maison. C'est Céline. Je
n'oublierais jamais son regard. Il portait une robe de
chambre usée, des pantalons flottants et des pantoufles.
Il ne portait pas de chemise. Dans l'échancrure de sa
robe de chambre, on apercevait un tricot, une vague
encolure, à moitié cachée par un foulard noué et très
serré. Les cheveux, mal coupés, lui tombaient bas dans
le cou ; la barbe, non rasée depuis longtemps, était
longue de plusieurs centimètres.
Il n'a pas levé les yeux lorsqu'il nous a tendu la main, la tête
détournée. Et il n'a toujours pas levé les yeux lorsque
nous avons pris place dans la pièce des prescriptions au
rez-de-chaussée. Cette pièce, non plus, je ne
l'oublierai jamais. Il y avait une vaste table, des
chaises, où s'empilaient des papiers et des livres, ce
qui ressemblait à la superposition d'autant de couches géologiques. Au milieu de la table, sur les
papiers, un chat dormait, les pattes étendues de tout
leur long. Plus tard, quand le perroquet dans sa cage
collée au mur, se mit à croasser d'une voix rauque, le
chat a dressé brièvement la tête, puis s'est remis à
somnoler sans avoir bougé de place. Derrière l'écrivain
profondément enfoncé dans sa chaise, on voit des cartes
chamarrées épinglées au mur. De loin, elles ressemblent
à des icônes. Puis, en regardant de plus près, je
découvre que ce sont des schémas de la musculature
humaine.
couches géologiques. Au milieu de la table, sur les
papiers, un chat dormait, les pattes étendues de tout
leur long. Plus tard, quand le perroquet dans sa cage
collée au mur, se mit à croasser d'une voix rauque, le
chat a dressé brièvement la tête, puis s'est remis à
somnoler sans avoir bougé de place. Derrière l'écrivain
profondément enfoncé dans sa chaise, on voit des cartes
chamarrées épinglées au mur. De loin, elles ressemblent
à des icônes. Puis, en regardant de plus près, je
découvre que ce sont des schémas de la musculature
humaine.
"
Que voulez-vous de moi ? ", nous dit Céline,
abrupt. " Je n'ai plus rien à dire ". Le voilà
donc, c'est bien lui. Nous sommes heureux qu'il ait
trouvé refuge au Danemark à la fin de la guerre, que les
Français n'ont pas eu l'occasion de le traiter comme les
Norvégiens l'ont fait avec leur grand écrivain Hamsun ou
comme les Américains avec Ezra Pound. La conversation
n'a pas bien commencé. Nous lui avions apporté une
bouteille d'un vieux Pommard, très précieuse, que nous
voulions lui offrir. Il a refusé d'un geste ennuyé : "
Buvez-la à ma santé - je ne me nourris plus que d'eau et
de nouilles. "
Nous avions bien entendu oublié les nombreux passages de ses livres où il
brocarde les Français, en disant qu'ils sont un peuple
abruti par l'alcool. La conversation traîne péniblement
en longueur. Elle devient cependant plus vivante quand
Céline, pendant une longue minute - morceau de cabaret
fascinant - tresse littéralement des phrases les unes
après les autres, sur un ton persiflant, pour donner des
exemples de ce qui, en France, est considéré comme le "
bon style ".
Il ajoute qu'à part lui trois hommes seulement écrivent avec style dans
la littérature française d'aujourd'hui : le jeune
Morand, le Barbusse du Feu et, enfin, Ramuz (ce
dernier nom n'est pas une flatterie qu'il nous adresse,
[à nous Suisses], car il a souvent évoqué Ramuz). Puis
la conversation s'alanguit à nouveau. Céline n'a
toujours pas levé les yeux.
(...) Mais, soudain, une idée diabolique me vient à l'esprit. Je veux
réveiller cet homme, qui semble parti au loin, car je ne
le verrai sans doute plus jamais, je veux qu'il me
présente son visage que j'avais eu si souvent devant
moi, en imagination. J'ai senti instinctivement, avec la
rapidité de l'éclair, comment faire pour qu'il abandonne
son masque.
En 1951, Céline était revenu d'exil. En 1951 aussi, les Strahlungen
d'Ernst Jünger, qui sont ses journaux de la deuxième
guerre mondiale, avaient été publiés en traduction
française. Dans ces carnets, Jünger mentionne une
conversation explosive qu'il a eue pendant l'occupation
allemande de la France avec un Français. Jünger avait
donné à ce Français un pseudonyme, mais le traducteur,
sans avertir Jünger, avait tout simplement remplacé ce
pseudonyme par " Céline ".
A
cause de cette indiscrétion, une succession de
procédures ridicules et désagréables pour les deux
parties s'ensuivit. On eut recours aux tribunaux. Pour
Céline, il avait été très désagréable de voir se raviver
à nouveau tout le débat sur sa pseudo-collaboration avec
les Allemands, débat qui s'était assoupi au moment de
son retour en France. Tout cela me repassait dans la
tête avec la vitesse de l'éclair et j'ai dit à Céline
qu'il nous avait reçu fort aimablement mais que je ne
voulais pas lui dissimuler que j'avais été le secrétaire
de Jünger. L'effet de cette divulgation fut étonnant.
Pour la première fois, Céline lève la tête, pour la
première fois, il me regarde droit dans les yeux. De sa
bouche s'écoule alors un flot de gros mots, prononcés à
froid, un flot de ces gros mots si nombreux dans ses
livres. Il répétait sans cesse deux expressions : "
Ce petit Boche... cette espèce de flic... "
(...)
Céline exprimait dans le jardin, avec une force
intarissable, les contenus habituels de ses livres :
rien en lui ne s'était éteint, ni la haine ni l'amour,
qu'il recouvrait d'un drap de grossièreté. C'est ainsi
que l'on se représente un barde celtique. Mon compagnon
lui demande alors si l'évocation récurrente des Celtes
dans son œuvre
relève du hasard. " Nullement ", répondit Céline,
" ma première femme était Bretonne. Ensuite, que
dit-on des Celtes ? Qu'ils étaient poètes - je le suis ;
qu'ils étaient sales - je le suis aussi ; qu'ils étaient
des ivrognes - non, ça, je ne le suis pas, je ne me
soûle pas ".
(...)
Puis progressivement, le feu, à nouveau, s'éteint,
Céline sombre une fois de plus en lui-même. Nous prenons
congé. Courbé, l'écrivain retourne dans la maison, dans
sa chambre des prescriptions, où plus personne ne lui
rend visite, parce qu'il n'y a pas là de ces appareils
pimpants.
En ravalant notre salive et en nous raclant la gorge face aux horribles
chiens qui nous fixent, nous quittons le jardin négligé,
et les propos de Céline nous repassent dans le crâne,
notamment quand j'avais utilisé l'expression " Les
Français ". " Les Français ? ", avait-il dit en
riant de sa voix cassée, mais ils n'existent plus !
Je suis le dernier Français. "
(BC n°245,
sept. 2003).
Pierre MONNIER.
[1949]. - Devant la gare de Korsor, ne me souvenant plus
de quelle façon indiquer au chauffeur l'adresse où je
dois me rendre, j'écris sur un papier " Klarskovsgaard
". Un jeune homme passe, regarde et je comprends qu'il
dit au chauffeur : " C'est pour le Français qui écrit...
" En arrivant auprès de leur maison, je les vois tous
deux devant la porte. Lucette saute à la corde comme un
boxeur à l'entraînement, et Ferdinand fait tourner la
corde dont l'extrémité est fixée au mur. Lucette est en
survêtement, élégante et musclée, Ferdinand enseveli
dans ses laines, sous sa houppelande.
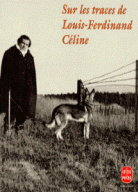
Pendant quatre
jours, nous allons bavarder et nous promener autour de
la maison, tandis que Lucette multipliera les exercices
et courra se plonger dans la Baltique sans se soucier du
froid. Dans son immense cape, Ferdinand a la silhouette
d'un berger de montagne, dessiné sur le ciel : " Vous
voyez où ça mène de faire l'artiste... " Lucette revient
auprès de nous en courant, Ferdinand la regarde... Ce
capital de courage et de santé l'aide à survivre...
[...] Céline est blessé. La persécution l'atteint au point le plus
sensible, son enracinement à la terre de son pays,
l'attachement à la langue française... " Tout ce qu'ils
me font... Leur haine... Leur méchanceté... L'exil, rien
en fin de compte, ne peut avoir de prise sur moi parce
que je suis lié, enchaîné à la langue française... Je
supporterai tout pour elle... Elle est mon souffle... ma
respiration... "
Quand, dans quelques instants, nous irons ensemble chercher le lait, il
me dira, après avoir échangé quelques mots en anglais
avec la fermière : " La langue anglaise que je parle
couramment et que je déteste... je suis obligé de
l'utiliser, mais je la déteste... "
[...]
Il parle aussi de ses amis, des écrivains qu'il aime,
des pays où il a vécu. Saint-Malo où il avait une petite
maison qu'il craint de ne jamais revoir. Saint-Malo
l'émeut et le fascine, il en décrit les recoins. Il
parle de Rennes... Quintin, où il s'est marié et fut
médecin. Il aime aussi parler des dentelles dont sa mère
faisait le commerce et qu'il allait livrer lorsqu'il
était enfant... La patience de la dentellière, sa
modestie et sa ténacité, lui inspirent l'admiration et
le respect... " Ces travaux ne sont plus possibles...
Tant de finesse, de patience, d'amour... On ne peut plus
trouver ça que dans les couvents ! "
A midi, nous déjeunons avec du poisson fumé. J'avais
apporté une bouteille de bordeaux rouge. Céline n'en a
bu qu'une goutte par courtoisie. Il proscrit le vin : "
Je suis hygiéniste, le vin, l'alcool, le tabac sont à
rejeter. Comment voulez-vous qu'un homme qui fume toute
la journée n'ait pas l'esprit enfumé ? "
Cet après-midi, nous nous sommes promenés dans la forêt où les faisans
dorés se laissent approcher. Nous avons ensuite été
jusqu'au bord de la Baltique. Ferdinand marche avec
peine, se plaint de bourdonnements d'oreille et de sa
blessure au bras droit qui le relance...
Il aime répéter que seule la médecine l'intéresse... " J'ai décidé
d'écrire pour deux raisons... Médecin à Clichy, je
gagnais peu d'argent, et je ne dormais pas la nuit.
C'est l'insomnie due au vertige de Ménières qui m'a
permis de bâtir Voyage au bout de la nuit. Ça m'a
valu bien des emmerdements ! " Beaumarchais avait raison
quand il disait : " Les Français, peuple frivole et
dur... "
Nous avons parlé aussi de Léon Bloy et de Gauguin qui
ont vécu au Danemark et qui n'y furent pas heureux. Bloy
vivait à Kolding, près de Frédéricia, ville royale...
Ferdinand me demande de lui envoyer les tomes du
Journal dans lesquels Léon Bloy parle de son séjour
au Danemark. Il a beaucoup aimé le livre d'Henri Calet,
Le Tout sur le tout... Parmi les écrivains qu'il
aime... Ramuz, George Lenotre, Mac Orlan, Simenon,
Marcel Aymé, Victor Cherbuliez... " Qui lit encore Le
Comte Kostia ? à part quelques maniaques de mon
genre... " Et Paul Morand : " Ah ! celui-là, un homme
qui a inventé un truc bien à lui... le style jazz... "
Dans le passé, il révère Tallemant des Réaux, Agrippa
d'Aubigné, Rivarol, Chamfort...
Il évoque aussi ceux qui lui écrivent ou viennent le voir... Le docteur
Camus, Pulicani, Arletty, Marie Canavaggia, Perrot et
Paraz, et Daragnès, et Marcel Aymé... Et le pasteur
Löchen, son ami danois. Et des copains de la butte, Le
Vigan, Bonvillers, Max Revol... Il est aussi très ému
par le courage de Paul Lévy, qui depuis notre entrevue
ne cesse de proclamer sa sympathie pour Céline, sans
tenir compte des cris et des menaces...
[...] Dans la soirée il lui arrive de rester un long
moment silencieux ou bien il médite à voix haute... il
évoque l'exode à travers l'Allemagne avec Lucette et Le
Vigan et Bébert enfermé dans une musette, Bébert le
tigre européen immortel : " Ici j'ai le temps de
réfléchir... "
Quelques instants plus tard, les animaux vont entrer en scène pour le
repas du soir... La chienne Bessie, que les Allemands
ont abandonnée en quittant le Danemark, une bête fière
et sauvage, d'une approche difficile, à qui Ferdinand
parle avec tendresse et qui s'enfuit dans la forêt
pendant plusieurs heures pour quelque chasse
mystérieuse... les deux danois... Et Bébert le patron à
qui un grognement suffit pour que la piétaille des
chatons cesse de crier et de faire des galipettes. Ferdinand observe ce petit monde en souriant.
Ferdinand observe ce petit monde en souriant.
Devant la porte de la maison, il y a des perchoirs pour
recevoir les oiseaux. Et lorsque la nuit tombe, deux
hérissons viennent boire le lait dans la soucoupe placée
pour eux au bas de la haie.
" J'ai le cirque... La danseuse... et les animaux savants... "
La veille de mon départ, j'ai passé quelques heures à Copenhague... Au
rayon français d'une librairie, j'ai trouvé un
exemplaire de Semmelweis que Céline a signé. Pour
ce dernier soir, il me semble qu'il fait encore plus
froid qu'hier... Dans la petite pièce où je couche... il
ya de l'eau glacée le long des murs... Lucette m'a fait
chauffer deux briques entre lesquelles je me cale. Je
dors avec deux lainages et deux paires de chaussettes...
Sur le quai de la gare, où ils m'ont accompagné...
Ferdinand bavarde et s'amuse comme un enfant de tout ce
qui nous entoure. Le train manœuvre. Aux fenêtres des
wagons-lits sont accoudés les conducteurs, l'un d'eux a
un visage un peu inquiétant... Ferdinand me pousse du
coude et toujours en riant me dit à mi-voix : " Regarde
celui-là... Et bourrique !... Et donneur !... "
Sur le ferry-boat, je relis mes notes, et je pense que maintenant il va
falloir se battre pour le procès... J'écris ce nom,
Céline, que la presse d'aujourd'hui n'écrit presque
jamais, si ce n'est pour l'accabler d'injures... Et je
pense au bonheur de ces jeunes qui un jour, peut-être
pas trop éloigné, vont découvrir Voyage, Mort à
crédit et tous ses livres, tous, sans exception...
Les veinards...
(Pierre Monnier, Ferdinand furieux, Lausanne, Ed. L'Age d'Homme, 1979,
p. 93).
Quand j'ai rencontré Céline
par Jacques OVADIA en 1958.
Quand Louis-Ferdinand Céline m'a reçu chez lui, à
Meudon, route des Gardes, il m'a demandé de lui parler
d'Israël, il a dit, après avoir écouté : " Ben voilà, un
homme nouveau se fabrique là-bas... un bâtisseur... un
cultivateur... un guerrier... " Devant la résistance
victorieuse des forces juives contre les armées arabes
pendant la Guerre d'Indépendance, l'écrivain avait
adressé à l'hebdomadaire " France-Dimanche " un
court article où il s'écriait d'emblée : " Vive les
Juifs, bon Dieu ! "
Et cette exclamation avait fait la manchette de la " Une " de l'hebdo.
Quand je l'ai vu, il était tassé sur son siège ;
visiblement, il souffrait des suites de ses blessures
reçues au champ de bataille en 1914... Un bras
fonctionnait mal, il avait été trépané et souffrait de
terribles migraines. Je voyais maintenant un homme
aigri, fatigué, mais n'ayant rien perdu de sa vivacité.
Parlant littérature, il me disait : " Ecrire, c'est
un travail de bagnard, il faut être très méticuleux, ne
pas jouer avec la grammaire, revoir les phrases...
Tenez, un de mes parents, Auguste il s'appelait, qui
était employé aux écritures dans une sous-préfecture,
était un maniaque de la virgule... elle devait être à sa
place, toujours, la virgule... Et puis, il y a
l'émotion, sans l'émotion, on ne peut pas vraiment
écrire, l'émotion c'est le style... Lisez donc Rabelais
dans le texte... "
Parmi ses contemporains, peu trouvaient grâce. Proust avait tout en
quelque sorte pour lui déplaire ; juif, pédéraste. Mais
c'était surtout le fait qu'il fût décadent qui le
repoussait. Il s'opposait aussi à son style. " Moi,
je suis un homme, j'écris
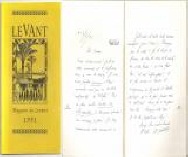 comme
un homme disait-il. L'homme ne s'exprime pas comme Louis
XIV ". Par contre, il lui reconnaissait le talent de
savoir " chier les phrases ". comme
un homme disait-il. L'homme ne s'exprime pas comme Louis
XIV ". Par contre, il lui reconnaissait le talent de
savoir " chier les phrases ".
Avant de le voir, j'avais correspondu avec Louis-Ferdinand Céline.
Parlant d'édition, il m'écrivait : " Pour être édité,
il faut être académicien ou pédéraste fameux. "
Une autre fois, nous avons parlé du communisme. Céline avait dit : "
L'idéal du communisme, c'est de jouir dix fois plus
qu'un bourgeois ". Il me parlait de l'URSS où il
s'était rendu pour toucher ses droits d'auteur. Le "
Voyage au bout de la nuit " avait été traduit en
russe, c'était le livre de chevet de Staline... Il
exprima sa grande déception, mentionna l'état déplorable
des hôpitaux russes, ajoutant : " Le communisme est
dans le fromage, il a la carte du Parti, il a des
privilèges, il est à part, le communiste, ce n'est pas
le peuple... " Il a terminé par cette phrase que je
n'oublie pas : " L'homme enlèvera toute sa
signification au communisme, c'est le peuple qui aura
raison, un jour, vous verrez, il jettera le communisme
aux poubelles. "
Louis-Ferdinand Céline voulait faire traduire le "
Voyage " en hébreu, le faire paraître en hébreu je
suis allé voir les éditeurs. Bien entendu, aucun n'a
accepté. L'un deux, dans un modeste bureau de la rue
Yavneh, à Tel-Aviv, a répondu que ce n'était pas le
moment : " Un jour, peut-être. "
Je me rappelle encore, quand je l'ai vu pour la première fois, son
irritation : " Cessez de m'appeler " Maître ", que
les autres le fassent, pas vous... Si vous tenez
tellement à me décorer d'un titre, appelez-moi " docteur
". Il avait la voix éraillée, il était enveloppé dans ce
que j'ai pris pour une grosse couverture verdâtre,
c'était peut-être un macfarlane. A la fin, voyant ma
curiosité, il m'a révélé qu'il se couvrait d'une
houppelande de berger landais. Il est mort quelques
heures après avoir achevé le manuscrit de son dernier
ouvrage : " Rigodon ". Je crois qu'il prévoyait
sa mort.
La seconde fois que je l'ai vu, il se plaignait de violents maux de tête.
Je ne sais pourquoi nous avons parlé de la guerre. "
On a gueulé que j'étais collaborateur... encore une
insulte... je n'ai collaboré avec personne... et puis
pour moi, les Allemands, c'était pas Hitler... Il y a
une fameuse différence... Ah ! On m'en a fait baver à ce
propos... Dites, ça s'est amélioré après la guerre ?...
On m'a tout brûlé, tout saccagé... Les lendemains qui
chantent ? J'en ris, j'en ris jaune... "
Je
n'ai pas voulu lui parler du conflit israélo-arabe. Je
crois qu'il n'avait pas envie d'en parler. Mais il
tenait à me revoir, j'ai perdu les lettres de cette
période. Ce qui l'intéressait, c'était surtout les
nouvelles d'Israël. Il en avait des échos assez justes.
" Israël est dirigé comme une communauté juive
d'Europe Centrale. Vous avez un homme qui est un peu
comme De Gaulle, qui connaît bien son peuple et qui veut
que le peuple se dépasse, c'est Ben Gourion ".
Israël avait pour lui un très long chemin de sueur et de sang à accomplir
avant de se retrouver libre. Il avait toujours en tête
l'idée d'un homme libre, d'un homme très populaire et
l'existence d'un Etat Juif lui avait ouvert les yeux.
(Extrait
de la revue universitaire israélienne Levant, n°4,
octobre 1991).
Visite d’André PARINAUD, II Arts, « Céline : Je suis un pauvre
homme brisé qui n’a qu’une force : sa haine et son
style », 19-25 juin 1957.
Lorsque
j’entre, Louis-Ferdinand Céline se lève, accentuant, par
le balancement de ses longs bras et de son dos voûté,
l’image un peu simiesque qu’il donne en se découpant
dans la lumière blanche d’une fenêtre.
- Vous êtes venu voir la vedette, dit-il en
ricanant. Tous ces cons qui me redécouvrent en
apprenant que je viens de publier D’un château
l’autre. Ils viennent visiter la ruine… pour voir si
ça tient encore ! Si je ne sens pas trop mauvais. Mais,
je leur en donne pour leur argent. Je connais le truc,
je réponds toujours à la demande. Doux comme un mouton
le Céline, bavant ou crachant. Qu’est-ce qu’il vous faut
aujourd’hui ? Il y a L’Express qui est passé par
Meudon. J’avais pavoisé la gare de toute ma
dégueulasserie pour le recevoir. Il a dû être content !
Vont pouvoir édifier leurs lecteurs et avoir bonne
conscience. Je me suis roulé dans ma fange de gros
cochon… puis Match… Je suis devenu le fait divers
à la mode. Ça les excite. Alors vous ?
Il se rassied et passe lentement ses mains sur son
visage.
- Je suis venu voir si vous retrouviez un goût meilleur
à la vie.
- Qu’est-ce que cela change tout ça ? Je continue à
crever dans mon trou à soixante-trois ans. Je cherche
toujours la combine qui me permettrait de gagner les
20 000 ou 30 000 francs qui en plus de ma retraite – car
je suis invalide à 75 p. 100 – me permettraient de
vivre. C’est mon éditeur qui va s’engraisser. Ce
salaud ! Moi…
- Mais il vous a déjà avancé des millions er avec ce
livre il vous fait une rente.
- Qui vous a dit ça ?
- C’est mon métier de savoir.
- Ça ne m’empêche pas de manger des nouilles et de
boire de l’eau.
- Le docteur Destouches sait mieux que personne pourquoi
Céline est au régime.
Il éclate d’un rire qui fait mal.
- J’ai toujours été masochiste, et con oui ! Je
crèverai de ma connerie. Je me suis trompé de file en
1940 ; rien de plus. Mais c’est quand même con. J’ai
voulu faire le malin. J’aurais pu aller à Londres. Je
parle l’anglais comme le français. Aujourd’hui je serais
à côté du pion Mauriac à l’Académie. Si j’avais su. Mais
j’ai perdu alors je paie. Je crèverai dans l’ignominie
et la pauvreté comme tout le monde le souhaite. Vous ne
voudriez pas que je pavoise. J’ai assez souffert
d’abord. J’ai bien le droit d’être malheureux et de le
montrer/ On m’a assez persécuté. Tout le monde devrait
se réjouir de me voir dans la merde ! C’est ce qu’on
voulait, n’est-ce pas ?
Je risque :
- Vous vous croyez persécuté ?
- Je n’ai jamais rien inventé. Même pas mon nom.
Céline, c’est le nom de ma mère. Le scandale qui m’a
lancé, le Voyage au bout de la nuit, c’était mon
expérience de médecin de nuit. Vingt-cinq ans parmi les
noyés, les asphyxiés, les assassinés, les filles, les
rats crevés. Le scandale qui m’a perdu était une autre
réalité. Dans Bagatelles pour un massacre, je
disais que la France était dans la merde et qu’il
fallait faire l’Europe. C’est ça qu’on me reproche
encore. Or, moi je n’ai pas d’idée. Je ne suis pas un
encyclopédiste. J’ai dit merde à tout le monde, même à
Hitler. Seulement j’ai voulu mettre le nez des gens dans
la seule réalité qui pouvait les sauver – hier ça leur
semblait désagréable, aujourd’hui, ça leur paraît
monstrueux – car tout ce que j’avais prévu arrive ; on
me hait donc davantage. Mais j’ai compris. Finis les
risques, les beaux mouvements de menton. Je suis un
vieil homme brisé, bien humble, bien pauvre qui n’a plus
la moindre idée sur rien, qui se cache et veut seulement
mourir en paix et avec un peu de pain…
- Dans votre dernier livre D’un château l’autre,
dont on parle déjà avant de l’avoir lu, vous
cherchez apparemment à vous justifier.
- Pas du tout. Je me considère comme un mémorialiste,
un type comme Joinville ou Froissart. Comme eux j’ai été
mêlé à de drôles de salades. Croyez-moi, ce n’est pas
par vocation que je me suis trouvé à Sigmaringen. Mais
on voulait m’étriper à Paris parce que je représentais
l’antijuif, le fasciste, le salaud, l’ordure, le
prophète du mal. Donc je me suis retrouvé en compagnie
de 1 142 condamnés à mort, Français, dans un petit bled
allemand. Ça valait le coup d’œil, croyez-moi. Une
cellule de 1 142 types qui crèvent de rage, cernés par
la mort ; on ne voit pas ça tous les jours.
(Cahiers
Céline 2, 1976)
LA TENDRESSE SANS PITIE. Visite de Louis Pauwels.
Il nous avait
dit :
- Non, nous ne parlerons pas de l'Apocalypse. Tous
les corgniauds partent en vacances dans leurs petites
voitures. Ils se foutent pas mal de leur fin prochaine.
De quoi j'aurais l'air, moi ? d'un plus corgniaud...
Non, on parlera de choses légères, il faut les faire
rire, tous ces cons...
C'est pourquoi nous étions quelque peu inquiets, en débarquant devant la
villa de Meudon. Louis-Ferdinand Céline dans le rôle
d'un homme léger pouvait-on y croire ? Il y avait du
génie dans cet homme redouté, redoutable et déjà avant
sa mort, aux trois quarts abattu. Du génie sûrement,
mais de la légèreté, sûrement pas.
La villa de Meudon, c'est un petit pavillon de banlieue,
en meulière, un de ces petits pavillons qui sont faits
pour la pluie, les réunions de famille le dimanche et la
vie dégoûtée. Le bout de jardin que les banlieusards
classiques cultivent pour l'hygiène et les fleurs du
salon, est noyé d'herbes folles. La grille rouillée est
plantée sur un mur lépreux, le portail à demi défoncé
grince quand on l'entr'ouvre.
En arrivant devant la porte, on voit d'abord un panneau imposant : "
Lucette Almanzor. Leçons de danse. " Lucette Almanzor
est la femme de Louis-Ferdinand Céline. Elle a traversé
avec lui bien des épreuves. Elle sait qu'il est
difficile de vivre avec un génie et peut-être de le
faire vivre. Plus loin, d'un buisson d'épines émerge à
demi une autre plaque plus modeste : " Docteur
Destouches ". Car, Céline, s'appelle en réalité
Destouches. Il est médecin, médecin des pauvres. Mais il
reçoit plus de curieux que de malades. Ses visiteurs le
trouvent plein de colère, enveloppé de misère, couvrant
le monde de sarcasmes atroces, où parfois un mot échappé
laisse deviner une sorte de tendresse, sans pitié, pour
les hommes. Ses meilleurs compagnons restent ses chiens
bâtards, rageurs et, comme lui, toujours en furie, qu'il
appelle tous indistinctement " mon petit père ". Son ami
le plus intime : un perroquet ironique qui accompagne
ses propos de coups de sifflet.
Après avoir échappé aux ronces, aux chiens et aux
traquenards d'un couloir hérissé d'objets insolites,
nous pénétrons enfin dans le bureau de Céline. C'est
aussi son cabinet de consultation et sa chambre : est-ce
une étable, un poulailler, une étude, l'arrière-boutique
du génie ? Deux larges fenêtres aux vitres sales
laissent dévaler la vue vers Paris, à travers ces
banlieues grouillantes des bords de la Seine que Céline
a tant haïes et tant décrites.
 Dans ce vivoir, comme aurait dit Flaubert, encombré de meubles misérables
et de guéridons bancals, on remarque surtout une
accumulation inexplicable de boîtes de cacao, puis des
journaux entassés un peu partout et des reliefs de repas
déjà anciens qui traînent dans des assiettes douteuses à
l'endroit même où ils ont dû être avalés. On imagine
très bien un cadavre et le commissaire Maigret humant
l'air lourd entre deux bouffées de sa pipe. Mais il n'y
a pas de cadavre. Il y a Louis-Ferdinand Céline, bien
vivant, l'injure au bord des lèvres. Dans ce vivoir, comme aurait dit Flaubert, encombré de meubles misérables
et de guéridons bancals, on remarque surtout une
accumulation inexplicable de boîtes de cacao, puis des
journaux entassés un peu partout et des reliefs de repas
déjà anciens qui traînent dans des assiettes douteuses à
l'endroit même où ils ont dû être avalés. On imagine
très bien un cadavre et le commissaire Maigret humant
l'air lourd entre deux bouffées de sa pipe. Mais il n'y
a pas de cadavre. Il y a Louis-Ferdinand Céline, bien
vivant, l'injure au bord des lèvres.
Tapi dans un fauteuil délabré, derrière une table de
salle à manger Henri II couverte de larges feuilles de
papier, il regarde assez ironiquement les préparatifs
minutieux de l'équipe. Louis Pauwels et André Brissaud
attaquent dès que le signal est donné.
- Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de
personnage. Vous excitez les passions. Par vos œuvres,
par vos idées, par vos habitudes, vous avez multiplié
les occasions de vous faire haïr. On dit souvent qu'on
vous comprend mal.
[...] Pour les besoins de la mise en scène, le réalisateur a extirpé
Céline de derrière sa table et l'a assis face à la
caméra dans un fauteuil Voltaire. Malgré la
superposition de ses gilets en loques (nous en comptons
trois, qui n'en font peut-être pas un entier), malgré
deux foulards douteux noués à la diable autour de son
cou décharné, cet homme semble maintenant dépouillé,
offert aux coups. Il montrera bientôt qu'il n'est pas
pour autant vulnérable.
[...]
On dit qu'un homme, aux approches de la mort, oublie le
passé immédiat mais retrouve intacts, dans toute leur
fraîcheur, les souvenirs de son enfance. Certes, nous ne
savions pas ce jour-là que Céline atteindrait bientôt la
fin de son terrifiant voyage au bout de la nuit. Mais
nous étions surpris par la rapidité de ses réponses, il
ne cherchait pas dans sa mémoire, il ne donnait pas
d'à-peu-près. Exactement et sincèrement, il se livrait
entier. Et ses grimaces, ses intonations, ses
demi-sourires ne réveillaient aucun sous-entendu. Il n'y
avait plus en face de nous ce clochard nauséabond dont
les attitudes passées relevaient peut-être d'un certain
délire, mais un homme qui avec notre complicité
vigilante descendait lentement jusqu'au plus profond
secret de soi-même.
- Si vous deviez mourir à l'instant, ce qu'à Dieu ne
plaise, quelle serait votre dernière pensée ?
- Ah ! bien : au revoir et merci ! Ah ! ça suffit, oui.
Je ne vous veux aucun mal, mais, mon Dieu, vous vous
occupez bien de vous-même, ça va, moi, je m'en suis trop
peu occupé. J'ai manqué d'égoïsme, c'est assez rare. Le
monde en est plein, n'est-ce pas ...
C'est fini. Pendant que les techniciens rangent leurs
boîtes étranges et emportent la caméra comme un enfant
fragile, Céline nous raccompagne jusqu'à la porte,
silencieusement. A la grille, il s'arrête, puis
désignant la Seine, de son doigt aigu :
- L'autre jour, je suis descendu là-bas, pour boire un
verre. Je me suis assis à la terrasse d'un café. Je me
rappelle ça maintenant. Alors, je regardais passer la
foule. C'étaient des bancals, des crochus, des mal
torchés ; et les femelles... Le pire, justement, c'était
les femelles : de la graisse en paquet qui dandinait les
fesses. Et l'air content. Des biens nourris, quoi,
justes bons à recevoir des coups de pieds au cul sans
rien dire. Y en avait un, un seul, dans le tas, il était
beau et costaud, mais l'air bête, rien là-dedans. Alors,
quoi, les Chinois n'ont plus qu'à venir, jusqu'à la
Dordogne qu'ils iront, à pied, sans se presser, depuis
Pékin. Pas les Russes. Non, la Russie, c'est plus que la
tête atomique chercheuse de la Chine. Les Chinois, on
leur dira : miam, miam, là-bas, au pays du soleil et du
rien-foutre. Et ils arriveront, monsieur, ils
arriveront, leur cure-dent en avant, jusqu'à ce que le
vin et le foie gras les fassent crever, à leur tour de
confort, du foie, de la rate ; ils en crèveront mais il
y a longtemps que vous serez tous morts... et moi aussi.
Céline se retourne brusquement et sans un mot s'en va à
travers la jungle de son jardin, encadré de ses chiens
grondants. Quand nous sommes redescendus vers Paris,
nous aussi silencieux, un remorqueur a sifflé et c'était
comme la fin du " Voyage au bout de la nuit ".
" De loin, le remorqueur a sifflé ; son appel a passé le pont, encore une
arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus
loin... Il appelait vers lui toutes les péniches du
fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel et la
campagne, et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi,
tout, qu'on n'en parle plus. "
(Louis Pauwels, Entretiens avec... En français dans le texte, Ed.
France-Empire, 1962).
CELINE
chez Elisabeth PORQUEROL.
Elisabeth
PORQUEROL est décédée à l'âge de 103 ans. Elle avait
donc vingt-sept ans à la parution du Voyage au bout
de la nuit. En février 1933, elle écrit un article
sur le livre.
Céline l'en remercie et lui propose de la rencontrer. C'est le récit de
cette rencontre que la jeune journaliste a publié.
D'abord, sous une forme abrégée, dans un mensuel de
l'époque ; ensuite, en 1961, dans La Nouvelle Revue
Française, à l'occasion de la mort de l'écrivain.
16
février 1933
Hier, pneu de
Céline : " je serai chez vous, demain matin, dix heures.
" Et d'une exactitude ! A dix heures, il sonnait ; dans
l'encadrement de la porte un grand type en ciré noir qui
s'incline un petit peu et dit en même temps :
Destouches, avant que j'ouvre la bouche. Stupéfaction,
il n'est pas laid. Je me demande pourquoi je l'imaginais
gros, sombre, crasseux. Il fait plutôt anglo-saxon lavé
au baquet et il a un très beau profil. Grand front, long
visage, yeux pâles de marin, paupières lourdes, paraît
jeune (trente-neuf ans), sans doute à cause de sa tenue,
familière, tout de suite copain, genre étudiant.
Je note vite tout ça après avoir mangé (je crevais de faim), il est parti
à une heure et demie ! Peut-être aurais-je dû le retenir
à déjeuner, mais alors à quelle heure aurait-il décollé
? Déjà, je n'en pouvais plus : jamais je n'ai rencontré
quelqu'un d'aussi fatigant, se levant, s'asseyant,
marchant, gesticulant, dansant, pendant trois heures et
demie ! son imperméable faisant autour de lui un bruit
mou de toile cirée : pourquoi ne l'a-t-il pas enlevé en
entrant ? J'aurais dû lui dire de se débarrasser, mais
crainte qu'il n'en profite pour s'installer... Je n'ai
pas tiré de cette rencontre tout le plaisir que je m'en
promettais à cause de cette fatigue, très vite, de sa
présence et de cette crainte de le voir s'incruster.
Je le souhaiterais de bien d'autres, mais pas de quelqu'un d'aussi
pesant, vraiment tuant. Pourtant, tout de suite
absolument d'accord, on attaque sur la publicité, les
façons vulgaires des " gens de lettres ", leur
exhibitionnisme commercial. Il se plaint du bruit fait
autour de lui, dit que ça le gêne : " Céline...
Céline, quand je vois ce nom écrit dans les journaux, ce
nom qui me désigne, ça me gêne, je me sens pris d'une
espèce de pudeur... "
Il dit qu'il voudrait se sauver n'importe où. " Dans les patelins, en
Afrique, on colle le sorcier au beau milieu de la place
et puis il y a un grand braillard qui fait approcher
tout le monde avec son tam-tam et qui hurle ! Il vous
construit une cabane en deux heures, il peut faire
l'amour vingt-cinq fois de suite !... la publicité, ici,
c'est le même coup, alors, moi, j'ai l'impression d'être
le sorcier. "
Il est debout
au milieu de la pièce, agitant ses longues mains
nerveuses (fines), soulignant trop les mots violents, et
fait le sorcier...
(...) D'autant plus bête que ses excès sont de la
comédie, le malaise qu'il répand vient de ce jeu
continuel, de cet artifice, plus fort que lui, tout avec
lui bifurque dans la bouffonnerie, la folie-à-grelots.
Je sais bien ce que c'est. La timidité. Quand on donne
trop d'importance aux autres, quand on les adore, on a
tellement peur qu'ils se détournent de vous,
qu'ils s'ennuien t
avec vous, alors qu'on voudrait tant les séduire,
les avoir avec soi, qu'ils vous aiment, qu'on ne
sait quoi faire, on se tortille comme les enfants : quel
mal on se donne ! qui finit naturellement en maladresse,
en grimaces, on se comporte à l'envers... Si je connais
ça ! Mais on n'aime pas beaucoup voir ses propres
faiblesses chez autrui. t
avec vous, alors qu'on voudrait tant les séduire,
les avoir avec soi, qu'ils vous aiment, qu'on ne
sait quoi faire, on se tortille comme les enfants : quel
mal on se donne ! qui finit naturellement en maladresse,
en grimaces, on se comporte à l'envers... Si je connais
ça ! Mais on n'aime pas beaucoup voir ses propres
faiblesses chez autrui.
(...) Comme je l'accrochais un peu sur son appétit d'argent, il affirme
qu'il s'en fiche, à la SDN, à Genève, il avait une
situation formidable, payé à ne rien faire (lutte contre
les épidémies), quel gaspillage là-dedans, du fric, on
en avait tant qu'on voulait, ça coulait à flot, il
prétend que ça le dégoûtait, pourquoi il a lâché.
Les bourgeois, ah, il les connaît : " Je me suis marié là-dedans
(divorcé, une fille)... mon beau-père (professeur
Follet) était directeur de l'Ecole de Médecine de
Rennes, alors vous voyez... "
" De la littérature, j'en ai mâché... Et moi aussi j'en fais, je rédige
des prospectus pour des produits pharmaceutiques dans un
laboratoire. " Il a lu énormément, très cultivé ;
mais horreur d'être brillant ; la peur de se montrer
pédant, plumitif comme les autres, a pu le conduire à
son " style " ; une manière d'aristocratie, de dédain,
dans ce débraillé parfois presque affecté. Même dégoût
que les Britanniques pour " l'esprit ", la conversation,
les Belles-Lettres... (Ce qui me fait tant souffrir à
Paris.)
D'ailleurs le
langage lui paraît un outil insuffisant ; il parle avec
envie des couleurs et surtout des sons, de la musique,
de la danse ; il ne voudrait écrire que des ballets.
Impossible de faire exécuter celui qu'il a écrit. Je lui
avoue franchement que je suis imperméable à ce " moyen
d'expression ". Il n'a même pas l'air de m'avoir
entendue ; d'ailleurs, ce que l'on dit, il s'en fiche,
ça glisse sur lui comme l'huile sur l'eau. J'aurais
montré de l'enthousiasme, le résultat eût été le même,
il recule jusqu'au fond de la pièce comme pour prendre
son élan - l'important pour lui est de se griser,
l'interlocuteur, c'est un spectateur, et encore, à peine
- il ne cherche pas à me convaincre, il a fait son
numéro, tout simplement, il se soûle.
Moi, la danse m'exaspère, il peut toujours parler - à une vitesse
hystérique - se livrer à des démonstrations valsantes,
je ne marche pas, je me ferme. Mais enfin, quelque chose
à quoi se raccrocher : ce qu'il trouve dans cette
exaltation qu'est la danse, à cette parole sans mots,
rien qu'en gestes, c'est une ligne sûre, une flèche
indicatrice, une corde à attraper, le fil conducteur
de la mort, ce sont ses mots.
Il a le sens de la mort, comme d'autres parlent du sens de la vie. J'ai
été assez troublée, touchait-on au but ? Ce malaise dans
la vie, par moments intolérable, viendrait de l'attitude
humaine envers la mort ; on ne l'espère pas, on ne songe
pas à y naître, on la redoute, on la regarde comme une
rupture, non comme une continuation. Si l'on tenait le
fil de la mort, on n'aurait pas peur de la vie, on
pourrait vivre délivrés ; car nous vivons en prison,
tous.
(...) Les
mots sont impuissants. Est-ce pour cela qu'il en fait
une telle consommation ? Il gratte, gratte comme une
bête qui rejette la terre avec ses pattes pour faire un
trou, pour arriver à trouver... Il paraît que Denoël lui
a fait supprimer la moitié de son livre. Le Voyage
avait plus de mille pages. Que de terre rejetée !...
C'est un grand malade, atteint du vertige de Ménière, insomnies et maux
de tête, comme un train de marchandises qui lui passe
sans arrêt dans l'oreille.
Puisqu'il a
tant voyagé, tâté de tant de milieux divers, je lui pose
la question qui me brûle : à l'étranger, ailleurs,
est-ce aussi horrible qu'à Paris ? Se heurte-t-on à
cette même froideur, cette même surveillance de son
personnage, cette même ambition sociale, ce besoin "
d'arriver " qui refrène tout élan, toute liberté, tout
contact humain ? Ces façons " d'esprit " qui empêchent
de reconnaître l'intelligence authentique du vernis,
etc.
Il me dit que, en Amérique, c'est encore plus affreux, différent dans la
méthode, et encore plus bête. Si, un lieu : à Vienne,
parmi les Juifs intellectuels, les médecins, surtout les
femmes médecins, il paraît qu'elles sont remarquables ;
il m'encourage à aller là-bas : " Vous en serez
folle. "
Il dégringole l'escalier, redevenu gouailleur, gamin, rigolo, lançant des
grossièretés de carabin à chaque marche, comme soucieux
- toujours - de gommer toute impression qu'il aurait pu
laisser de " sérieux ", une peur bleue d'avoir fait "
l'important ".
(Céline, il y a trente ans, La
Nouvelle Revue Française, 1er sept. 1961, dans BC n°303,
déc. 2008).
Visite
d'Henri POULAIN, au dispensaire et chez Gen
Paul en 1936. Témoignage inédit, écrit en 1964 et
destiné à la seconde livraison des Cahiers de L'Herne.
J'ai fait la connaissance du docteur
Destouches au dispensaire de Clichy, en
présence de deux personnes du sexe aimable : une Danoise
blonde, surnommée " " La Petite Sirène ", et la
remplaçante occasionnelle de Céline, une doctoresse
noiraude au nom patronymique bizarre qui ne cessa
d'insister sur ses origines arméniennes.
Céline souriait, ricanait un brin, mais appréciait beaucoup la dame
médecin. C'était en 1936, sous le premier règne de M.
Blum. A l'époque, Louis-Ferdinand Céline écrivait sans
doute Mea culpa, songeait certainement à
Bagatelles pour un massacre, mais il ne parlait pas
de ses projets.
 Dès lors, j'ai commencé à voyager avec l'auteur du
Voyage au bout de la nuit. D'abord en autobus. De
Clichy à Montmartre, ou de Montmartre à Montparnasse.
Côté deuxième classe, bien droit sur la banquette,
Céline parlait à voix basse, mimait, riait, écoutait, et
aucun Parigot ne soupçonnait qu'il avait pour compagnon
de route le père de Bardamu, de qui le génial bouquin
était lu partout à des centaines de milliers
d'exemplaires.
Dès lors, j'ai commencé à voyager avec l'auteur du
Voyage au bout de la nuit. D'abord en autobus. De
Clichy à Montmartre, ou de Montmartre à Montparnasse.
Côté deuxième classe, bien droit sur la banquette,
Céline parlait à voix basse, mimait, riait, écoutait, et
aucun Parigot ne soupçonnait qu'il avait pour compagnon
de route le père de Bardamu, de qui le génial bouquin
était lu partout à des centaines de milliers
d'exemplaires.
Figurez-vous une haute silhouette, l'allure altière, des épaules de
charpentier de marine, un manteau brun à carreaux, un
gros foulard noué en désordre. Un front haut, la
chevelure rejetée en arrière, un visage noble et beau
que plus souvent la joie éclairait. L'œil
était bleu, transparent, le regard le plus vif,
pétillant de malice ou plein de songe. La bouche forte
pouvait se changer en grande gueule, mais le sourire
était d'un enfant. Ses mains de toubib étaient longues
et fines, extraordinairement belles, au point que les
femmes de goût les remarquaient aussitôt et commençaient
à rêver, ainsi que le faisait, paraît-il, devant Joseph
aux onze frères l'épouse de l'Egyptien Putiphar.
Je n'ai connu qu'un peu après
l'extrême étendue du registre de la voix célinienne.
Cela se passait à Montmartre dans l'atelier de Gen Paul,
où les copains de Céline se réunissaient certains soirs
de la semaine, sur le tard d'onze heures.
Cette assemblée méridienne, les habitués l'appelaient d'ailleurs " la
messe de Ferdinand ". En vérité, c'était Ferdinand
ou les grandes orgues. Le grand jeu, à pleins tuyaux, de
la flûte à la trompette et au tonnerre, engendrait tour
à tour des ballets d'opéra, des exodes à fond de train,
des retours triomphants, des cités rasées net par un
géant coiffeur méticuleux, ou la répétition générale du
Jugement dernier.
Mais dans les fracassants monologues de Céline, on voyait aussi surgir et
s'animer un monde de danse macabre : des pitres, les
pignoufs, les résignés aux abattoirs, les loups qui
fabriquaient les pièges à hommes, les lanceurs de filets
à mailles d'acier pour la grande pêche dernière, les
pantins qui façonnaient les catastrophes, la suite, le
déclin.
(BC n°148, janvier 1995).
Francis PUYALTE.
Les souvenirs de la femme de Céline. Rencontre avec celle qui a
sacrifié sa vie au docteur Destouches. " Ma féerie ",
disait-il.
" on ne l'a pas compris. Il
aimait les pauvres gens, les malades, les souffreteux,
les prisonniers, les vieux, les chiens moches... "
Ça a
débuté comme ça. Moi, j'avais rien dit, seulement sonné.
Roxane est arrivée la première, au galop du fond du
jardin, tous crocs dehors. Dans son sillage, Fun se
prenait pour un loup. Feindre la hargne est une vieille
habitude de la maison. Il ne faut pas s'y laisser
prendre. Quelques caresses et on copine. Tout de même,
on n'entre pas dans l'univers célinien comme à la Sainte
Chapelle.
Rien n'a changé au fond, route des Gardes à Meudon. Si, quelque trente
années sont passées. On n'y voit plus Michel Simon,
Arletty, Marcel Aymé, Blondin ou Nimier. Et on n'y garde
plus qu'un souvenir, mais si passionné, si
compromettant, toujours en éruption...
Encore un journaliste, un voyeur, un dévot en extase, un célinomane à
deux doigts de l'overdose. On en finira donc jamais avec
le scandale. Avec ce brasier. Le Feu de l'enfer. Lucette
est fatiguée par tout ça. La candeur, la douceur, la
grâce, encore et toujours confrontées à cette lave en
fusion : Louis-Ferdinand Céline, son mari. Et on trouve
des gens pour dire : " Ce sera pareil en l'an 3000
".
La maison de style louis-philippard
perchée sur les hauteurs de Meudon sera ou ne sera pas
classée comme " lieu de mémoire ". Peu importe.
Désormais, Lucette s'en moque. Elle y tenait seulement
pour les animaux, les compagnons du malheur, tous
enterrés là, Bébert le chat, Toto le perroquet, Bessy la
chienne, et tant d'autres... A présent, elle n'attend
plus que le repos éternel.
A quatre-vingts ans, la femme du Dr Destouches est pourtant bien alerte.
Même si elle se plaint d'être " fatiguée ", il
faut la voir dans la salle de danse. Droite, souple,
légère, une plume au vent. Ou au volant de sa voiture,
prendre la direction de Dieppe où elle a un petit
appartement. Sûr qu'il est difficile de se faire obéir
par ses chiens, tous tirés des cages de la SPA, de
costauds bâtards, elle est si frêle, mais elle l'a
toujours été, n'a jamais opposé que tendresse et sourire
aux grêlons comme aux frelons, elle est comme ça et on
ne se refait pas.
Avec Louis non plus, elle n'avait jamais le dernier mot, la discrète
Lucette. Mais que dire encore sur celui qui l'a séduite
lorsqu'elle avait 23 ans ? Que dire encore sur Céline ?
" J'ai déjà tout dit, cent fois, mille fois... Oh !
pas grand-chose, vous savez, et toujours la même
chose... Mais je n'ai plus rien à dire sur Louis... Plus
rien. "
On n'ose trop insister. Lui
quémander quelque anecdote inédite sur la vie au château
de Sigmaringen, devenu un camp retranché pour "
collabos " aux abois et où Céline est arrivé un
vilain matin comme un cheveu dans la soupe avec Bébert
dans sa musette. On voudrait bien, mais on hésite à
l'interroger sur la délirante épopée de l'apocalypse
sous les bombes, à travers l'Allemagne en flammes, ou
sur l'exil au Danemark, ses onze jours de prison à la
forteresse de Vestre Faengsel, où son mari, lui, est
resté un an et demi, " un cul-de-basse-fosse ",
se lamentait-il.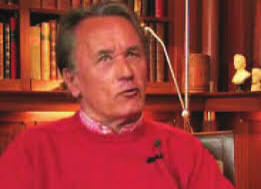
D'ailleurs, tout est dit dans la trilogie (D'un château l'autre, Nord,
Rigodon) et dans les nombreuses biographies qui lui
sont consacrées, notamment celle, en trois volumes, de
l'avocat François Gibault, devenu l'ami et le confident
de Mme Destouches. Il vient la voir chaque dimanche
depuis trente ans, lui téléphone chaque jour à midi et
elle l'appelle chaque nuit à minuit... Mais enfin,
lorsqu'on tient un témoin si privilégié, personnage d'un
roman vécu de ce tonneau, lorsqu'on se trouve en face de
la compagne de tant d'années, de tant d'épreuves, la
femme de Louis-Ferdinand Céline, on ne la lâche pas
comme une baudruche dans l'air des jardins du
Luxembourg.
Qu'il ait été un rêve enchanté ou
un cauchemar, il est toujours pénible de revenir sur le
passé lorsqu'on a parcouru un tel chemin. Les amis ont
presque tous disparu. Arletty que Céline, natif comme
elle de Courbevoie, appelait " ma payse ", est
partie aussi pour le grand voyage... Lucette la voyait
souvent rue Rémusat. Elles déjeunaient en tête à tête,
simplement, un plat de pâtes, des yaourts. Elles
parlaient cinéma. Et de Céline aussi. Ah ! Céline, un
sujet inépuisable... Bien sûr, elle était à ses
obsèques, effacée comme toujours, personne ne l'a
reconnue.
Mme Lucie Destouches, née Almansor, danseuse étoile, puis professeur de
danse, sourit d'un air tendre à l'évocation de ses
souvenirs. Tandis que Bonhomme, un cocker au caractère
joyeux, lui mordille les mollets, elle regarde Paris au
loin, lève lentement son bras droit avec grâce comme si
elle revoyait ces visages d'amis fidèles, de la Butte à
Meudon. " Marcel Aymé venait nous voir chaque
dimanche matin. Mais il fallait qu'il nous quitte à midi
pile car sa femme l'attendait à Paris pour déjeuner.
Faussement bougon, Céline le laissait partir à regret en
lui disant à midi moins cinq : " Allez, tire-toi, tu vas
te faire engueuler, y a ton rôti qui t'attend. "
Avec Michel Simon, le dialogue
n'était pas triste, on s'en doute. Lucette les laissait
souvent bavarder entre hommes. D'ailleurs, elle avait
ses cours de danse dans la salle du haut. Que se
racontaient ces deux compères ? Des histoires d'animaux,
souvent. Chacun avait un perroquet et lui apprenait des
mots rarement employés dans les salons. Ou des histoires
salaces, peut-être... En tout cas, le rire, pour ne pas
dire le ricanement de Michel, résonne encore dans ses
oreilles.
Leurs points communs étaient nombreux. Entre autres, ils ne se lassaient
pas de railler Sartre, traité de " méchant pitre
" et, plus généralement, de dénigrer les "
raisonneurs ", les " intellectuels " en
appuyant bien sur les syllabes. Céline disait : "
J'ai pas d'idées, moi ! aucune ! et je trouve rien de
plus vulgaire, de plus commun, de plus dégoûtant que les
idées ! Les bibliothèques en sont pleines ! et les
terrasses de cafés ! tous les impuissants regorgent
d'idées ! " L'acteur applaudissait gaiement
l'artiste.
C'était le folklore de la maison. L'ermite de Meudon, nid de
contradictions, excellait dans tous les numéros. Eternel
provocateur, grommelant souvent, se lançant soudain,
après un long silence, dans un flot imprécatoire que
rien ni personne ne pouvait arrêter, jetant ses
anathèmes à défaut de ses oripeaux, mais toujours
cocasse cependant, même lorsqu'il prédisait
l'apocalypse, il pouvait faire le charmeur, jouer de la
flûte, et séduire aussi bien les dames que les
messieurs. Demandez donc à Claude Sarraute, devant
laquelle l'ogre de Meudon se fit tout miel un jour pour
les lecteurs du Monde, " avec qui on doit se
montrer aimable, gentil... " La journaliste le
quitta épatée, presque envoûtée par cet " homme
délicat et délicieux ".
Pour Bardamu, mais aussi pour
beaucoup d'autres, Mme Destouches regorge d'indulgence.
Entre sa cuisine, petit capharnaüm très célinien, et le
salon, qui fut autrefois, avant que la maison ne brûle
en mai 68, le bureau foure-tout de son mari, où
cohabitaient un couple de tortues et un hérisson
apprivoisé, elle murmure tristement, comme si elle se
parlait à elle-même. " On n'a pas compris Céline. Il
aimait les pauvres gens, les malades, les souffreteux,
les prisonniers, les vieux, les chiens moches... Ah !
ça, il n'a jamais voulu d'un chien de race. S'il avait
pu, il aurait recueilli tous les chiens perdus, tous les
oiseaux blessés. "
On dirait que les animaux du coin se sont donné le mot. Dans le jardin
soigné de Meudon où Bébert a chassé ses dernières
souris, on rencontre des hérissons, des lapins, sans
parler des chats, bien sûr, qui connaissaient bien
l'adresse...
En 1953, le Dr Destouches s'était réinscrit au Conseil de l'Ordre (alors
de Seine-et-Oise), mais n'exerçait plus
qu'occasionnellement pour des voisins et toujours " à l'œil
".
Mais l'antisémitisme de Céline ?
Il faut évidemment, il faudra toujours, y revenir.
Lucette, qui s'était opposée fermement à son mari
lorsqu'il lui lisait des pages de ses pamphlets, a son
explication, qu'elle répète inlassablement, sans
toujours convaincre : " Il voyait en eux des fauteurs
de guerre. Je lui ressassais : " Tu as tort, tu
t'envoies un pavé à la figure, jette ça au feu ". Mais
il ne m'écoutait pas. Il me répétait : " Tu verras, tu
verras, ils vont tous s'étriper ". Mais il était si
excessif, si outrancier, que cela en devenait dérisoire
".
 Les faits demeurent et ne pourront jamais être gommés : si Bagatelles
pour un massacre et L'Ecole des cadavres ont
été publiés avant la guerre et même si on n'imaginait
pas alors la réalité des camps de la mort, Les Beaux
draps sont bel et bien sortis en 1941. Il faut donc
prendre Céline tel quel, tel qu'il était. En bloc. "
Admirez Céline, ne le défendez pas " a écrit un jour
François Nourissier. Les faits demeurent et ne pourront jamais être gommés : si Bagatelles
pour un massacre et L'Ecole des cadavres ont
été publiés avant la guerre et même si on n'imaginait
pas alors la réalité des camps de la mort, Les Beaux
draps sont bel et bien sortis en 1941. Il faut donc
prendre Céline tel quel, tel qu'il était. En bloc. "
Admirez Céline, ne le défendez pas " a écrit un jour
François Nourissier.
La vie avec cet homme, chacun s'en
doute, ne devait pas être drôle tous les jours.
Consciente d'avoir rencontré et d'aimer un génie,
Lucette lui avait sacrifié la sienne, une vie d'artiste
qu'elle qualifie d' " amusante ". Danseuse dans
une troupe recherchée, elle était partie en tournée aux
Etats-Unis pendant un an, puis à Tunis, à Cracovie, en
Lituanie... Elle avait dû renoncer à tout pour rester à
ses côtés, le materner. " Il en avait tant besoin.
Oui, il était exigeant, mais par amour, il ne voulait
pas que je fasse le ménage, ni la cuisine. Seulement, ma
présence lui était indispensable ". Elle était sa "
féerie ", ne cessait-il de dire.
Leur vie était bien réglée. Le mardi, elle n'avait pas de cours de danse.
Elle " descendait " à Paris en train pour faire
des achats, surtout chez Fauchon. Il s'inquiétait,
connaissait toutes les heures d'arrivée des trains,
imaginait toujours une catastrophe ferroviaire
lorsqu'elle n'était pas revenue à l'heure. " Louis
était un anxieux perpétuel ", dit-elle, songeuse,
regardant Paris au loin.
Parfois, lorsqu'il estimait qu'elle avait dépensé trop d'argent, "
il m'engueulait ". Le soir, de son débit
saccadé, il lui lisait ce qu'il avait écrit, toujours à
l'encre sur des feuilles abondamment raturées de papier
jaune qu'il réunissait avec des pinces à linge et
suspendait dans sa cave, un endroit où il se plaisait
bien. Il se nourrissait peu et mal : du thé léger, des
croissants, quelques gâteaux dans la journée, "
il adorait les croissants ", une soupe le soir. "
Chaque matin, il tenait à me préparer mon bol de café ".
Puis il allait chercher son Figaro dans la boîte
à lettres. Il s'y était abonné dès son arrivée à Meudon,
" pour le carnet du jour et plus précisément la
chronique nécrologique ", affirmait-il.
Lui, ne sortait jamais, sauf pour
se rendre chez le dentiste et, deux ou trois fois, chez
son éditeur, Gaston Gallimard avec lequel il
entretenait une correspondance tumultueuse. Un soir, et
ce fut un évènement, il alla à Paris pour applaudir une
pièce de l'ami Marcel, La Tête des autres. Mais,
de son arrivée à Meudon en 1951 à sa mort dix ans plus
tard, il ne s'est plus jamais rendu à Montmartre. Ses
amis venaient le voir : le peintre Gen Paul, son grand
pote, le danseur Serge Perrault, de la compagnie Roland
Petit, un ami de sa femme qui s'était pris de passion
pour lui, et deux confrères, le Dr Brami, un fidèle, et
le Dr Willemin, qui lui fermera les yeux, quelques
autres.
Tout cela est bien loin. Bien
vieux. Aujourd'hui, route des Gardes, à Meudon, il ne
reste qu'une vieille dame entourée d'animaux, de
souvenirs, de quelques amis. Et un fantôme qui voyage au
bout de la nuit. Un fantôme tout noir.
(Francis Puyalte, Le Figaro, 30 décembre 1992, in BC n° 127, avril
1993, p. 15).
Jacques ROBERT.
Maintenant, que je vous
narre un peu comment j'ai retrouvé Céline... Hein ? Quoi
? Qu'est-ce ? Ferdinand, l'affreux antisémite ? Après
mon retour de Bergen-Belsen, ma passion pour Israël ?
Aurais-je perdu l'esprit ? Logique ! Descartes !
L'hystérie politique a depuis 1789 si bien oblitéré l'intelligentsia
française qu'un homme un peu sensible et de bon sens
qui, en des temps troublés, n'a d'autres vues que de
regarder palpiter le pauvre cœur
des hommes dans quelque camp qu'il soit, est
immédiatement tenu, à Paris, pour suspect.
Ah, diable, nous le fûmes, suspects, en cet après-guerre, nous, les jeunes
reporters, les voyeurs officiels, dépêchés par nos
rédactions sur tous les théâtres d'Europe pour " mater "
les victimes, les torturés, les déportés, les épurés,
les regarder de bien près saigner, gémir, agoniser, afin
que nul n'en perde !
[...] J'ai dit ma tendresse pour
Israël. Comment aurais-je pu pardonner à Céline ses
pamphlets contre les juifs ? Comment, ennemi du
sectarisme et de la passion aveugle, n'aurais-je pas
frémi devant sa rage antisémite ? Seulement,
Louis-Ferdinand Céline n'était pas qu'un antisémite. Il
était bien autre chose et d'abord un écrivain illustre
pour avoir fait éclater notre langue. Le Voyage au
bout de la nuit demeurera l'un des évènements
littéraires de ce siècle.
La disparition de Céline, après la Libération, fut un autre évènement.
Vingt fois, on le crut mort. Le mystère dura quelques
deux ans jusqu'au jour où l'on apprit qu'il s'était
réfugié au Danemark. Aussitôt, le gouvernement agit
auprès des autorités danoises pour obtenir son
extradition. Ils étaient des milliers en France à
vouloir la peau de Louis-Ferdinand. Copenhague, qui a le
sens de l'honneur, refusa de livrer l'émigré.
Et puis un jour, à Samedi-Soir, la
bombe ! Nous recevons un télégramme daté de Copenhague
et signé " Céline ". Il est ainsi rédigé : " Suis prêt
dans vos colonnes à torcher l'avorton Sartre. " Suit un
numéro de téléphone de Copenhague que nous reniflons
avec une extrême méfiance. Le télégramme sent le
canular. Nous appelons, cependant, à tout hasard, le
numéro de Copenhague. Un avocat nous répond. Nous lui
parlons du télégramme de Céline. Il nous répond avec un
gros accent qu'il ne sait pas qui est Céline et nous
raccroche au nez. Conférence au sommet. Allons-nous
mettre au panier le télégramme ? Et si, malgré tout, il
était bien de Céline ? L'avocat s'est peut-être méfié au
téléphone. Une idée nous vient. Nous allons faire une
enquête pour tenter de savoir si Céline a une raison
particulière, ces temps-ci, de vouloir " torcher
l'avorton Sartre ". Sans doute les deux hommes ne se
sont jamais aimés, mais quelle mouche a-t-elle piqué
Céline pour qu'il prenne tout à coup le risque de sortir
de son silence ?
Nous tombons sur un pot aux roses,
qui nous donne à penser que le télégramme a bien été
envoyé par Céline. Un article de Jean-Paul Sartre vient
de paraître dans Les Temps modernes. Il est
intitulé : " Portrait d'un antisémite ".
L'antisémite, ce n'est pas Céline, c'est l'antisémite en général. Mais,
page 462, Sartre n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre à
Céline : " Si Céline a pu soutenir les thèses des nazis,
c'est qu'il a été payé. "
Ici, je vais marquer un temps. L'envie de dire un peu ce que je pense de
cette jolie petite phrase. Au vrai, elle me fait rêver.
Je ne comprends pas. Sartre, dieu de ma jeunesse
estudiantine, que j'admirais tant, et qui, soudain, se
transforme en " donneur ". Il n'y a pas d'autre mot, si
l'on s'arrête un peu sur la chose.
[...] Alors, on se perd en conjectures. Comment un homme comme Sartre, qui
a passé sa vie à dénoncer les dénonciateurs, a-t-il pu
soudain se comporter de cette façon à l'égard d'un de
ses concurrents - car, on avait assez dit que La
Nausée devait beaucoup à Céline. Le plus étonnant,
et qui trahit une espèce d'inconscience - voyez à quoi
mène le sectarisme ! - c'est que dans ce même article où
il assassine Céline, Sartre écrit, quelques pages plus
haut (page 451 de la revue) : " Un homme qui trouve
naturel de dénoncer des hommes ne peut avoir notre
conception de l'honneur. " C'est tout simplement insensé
!
[...] Où l'on voit déjà poindre
l'intention de Céline de " torcher " son ennemi. Où l'on
voit aussi que son avocat danois ne l'y encourageait
guère, ce qui explique qu'il nous répondit, lorsque nous
l'appelâmes à Copenhague, qu'il ne connaissait pas
Céline. Cependant, la tentation pour Céline avait été la
plus forte et, passant outre les conseils de son avocat,
il nous avait adressé le fameux télégramme.
C'est ici que j'entre en scène. Samedi-Soir me chargea de
contacter Céline. Je pris, la nuit même, l'avion pour
Copenhague et téléphonai le lendemain matin, à la
première heure, à l'avocat qui m'accueillit comme un
chien dans un jeu de quilles. Je lui demandai néanmoins
l'adresse de Céline. Il me dit qu'il voulait réfléchir
et me pria de patienter vingt-quatre heures. Le
lendemain, il me lâchait l'adresse, et je pris,
fringant, la direction du repaire.
[...] En attendant, j'avais le cœur
qui battait : Céline était derrière cette porte. Je
frappai, ne me doutant pas de ce qui m'attendait : un
des moments les plus extravagants de ma carrière. La
porte ne s'ouvrait pas et je n'entendais aucun bruit. Je
frappai de nouveau. Je frappai une dizaine de fois, et
de plus en plus fort. Tout à coup, je perçus un souffle,
une respiration. Céline était derrière la porte, tout
contre. Peut-être m'observait-il par le trou de la
serrure. La porte n'était qu'une maigre planche. D'un
coup d'épaule, j'aurais pu l'enfoncer.
Je dis alors très haut qui j'étais. L'envoyé de Samedi-Soir qui
avait bien reçu le télégramme. Pas de réponse.
J'entendais toujours le souffle, comme celui d'un
asthmatique. Alors je suppliai Céline. Est-ce qu'il
n'avait pas envie d'échanger quelques paroles avec un
jeune Français qui ne lui voulait pas de mal et qui
était venu spécialement de Paris pour le rencontrer ?
Soudain, j'entendis un
gémissement. Puis la voix de Céline s'éleva derrière la
porte, une voix rauque, oppressée.
- Non, ne me dites pas ça, c'est très mal ce que vous
faites ! Allez-vous en ! Laissez-moi tranquille ! Je ne
veux voir personne !
- Mais c'est vous qui avez pris contact avec nous.
- J'ai réfléchi, j'ai eu tort, je ne veux pas vous voir,
jamais je ne vous ouvrirai.
Je compris ce qui s'était passé : l'avocat danois, m'ayant fait attendre
vingt-quatre heures, avait prévenu Céline de mon arrivée
et l'avait retourné contre moi. Après quoi, il m'avait
généreusement donné l'adresse de son client sachant que
celui-ci ne m'ouvrirait pas.
Je tremblais de rage. Ce n'était pas possible ! Etre si près du but, ne
plus être séparé de cet homme, qui malgré tout
passionnait la république des Lettres, que par une
méchante planche...
Je suis resté une heure et demie derrière cette porte, continuant
obstinément à adjurer Céline - et lui continuant à me
repousser. Il y avait des moments où je sentais qu'il
faiblissait, sa voix se faisait plaintive, comme si
vraiment je le torturais, et je comprenais que c'était
sa tentation de pouvoir parler enfin, de laisser éclater
le volcan qu'il portait dans sa tête.
Je lui arrachai cependant, peu à
peu, une interview étrange que j'aurais pu intituler "
Dialogue avec Céline à travers une porte ".
- Est-ce que vous sortez quelquefois Céline ?
- Non, jamais.
- Vous n'allez pas au restaurant ?
- Vous êtes fou ? Avec quel argent ?
- Vous écrivez ?
- Oui, bien sûr.
- Un roman ?
- Oui. Féerie pour une autre fois.
- Le sujet ?
- Atroce. Une petite Apocalypse à l'usage de notre
humanité démente.
- Les juifs, Céline ?
- Taisez-vous !
- Non, je veux savoir.
- C'est fini, c'est dépassé. Plus jamais je ne parlerai
des juifs. D'ailleurs les catastrophes qui se préparent
dans le monde font que ces petites questions aryennes
sont complètement dépassées.
- Pourquoi êtes-vous allé à Sigmaringen ?
- Je ne voulais pas mourir, ce n'est pas plus compliqué.
Je risquais un mauvais coup à la Libération. Des amis
gaullistes m'avaient bien proposé une cachette en
Bretagne. J'ai hésité et puis, finalement, j'ai préféré
Sigmaringen. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi
on m'ennuie tellement avec cette histoire de
Sigmaringen.
 -
On a dit qu'à Sigmaringen vous avez soigné Pétain. -
On a dit qu'à Sigmaringen vous avez soigné Pétain.
- Menteries !
- Et Doriot ?
- Ça, je peux vous dire
qu'il est mort. Mille regrets pour le PPF. Le Jacques a
bien rendu son âme. J'ai constaté son décès.
- Laval ?
- Je ne pouvais pas le sentir. Il me faisait des
tracasseries. J'ai toujours pensé qu'il était juif.
Voilà que ça le reprend. Je le lui fais remarquer et lui demande pourquoi
il pense que Laval était juif.
- Puisque je vous dis que je ne pouvais pas le sentir,
c'était louche, non ?
Inouï !
- Estimez-vous que vous avez collaboré, Céline ?
- Menteries, menteries ! Innocent, je suis ! Mes
quelques articles dans La Gerbe ? Des interviews
truquées. Guignol's band ? Une histoire de
mauvais garçons sur la Tamise en 1914-1918, vous voyez
le rapport ! Avec ça, tous mes livres étaient interdits
en Allemagne. Il y a encore une chose : j'aurais pu
faire un très bon haut-commissaire aux Questions juives.
Vichy me l'a offert, j'ai refusé. Les juifs devraient
m'élever une statue pour le mal que je ne leur ai pas
fait.
De plus en plus étonnant !
- Pourquoi vous êtes-vous réfugié à Copenhague ?
- J'en avais le béguin. J'avais connu une femme, à
Copenhague, dans ma jeunesse. Et puis, les Danois, je
pensais que c'étaient des gentlemen, qu'ils n'allaient
pas me laisser fusiller comme ça. Ils m'ont quand même
collé dans un donjon pourri. Dix-sept mois, je suis
resté dans le donjon.
- Votre santé ?
- Je suis en train de crever. Le donjon qui m'a fini. Ma
tête, ma blessure de 1914, je deviens fou.
- On pourrait peut-être parler de Sartre, puisque je
suis venu pour ça ?
- Non, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas un mot. Trop à
dire ! Un jour, plus tard, je jure !
Je suis reparti pour Paris sans
avoir vu Céline. Il est rentré quelques années plus tard
en France pour mourir et je n'aurai pas connu son
visage, mais je reconnaîtrais entre mille sa voix, si
elle retentissait encore dans ce monde.
Il y eut une suite à mon voyage au bout de la nuit de Copenhague. Le jour
de mon arrivée au Danemark, Albert Paraz avait reçu
cette lettre de Céline :
Mon cher Vieux,
Voilà que Samedi-Soir a envoyé ici un reporter sans crier
gare ! Comme ça ? Au flanc [sic] ! Tu parles ! Je
demandais à ces noms de Dieu un coin dans leur canard
éventuellement pour un démenti... Pas un journaliste par
avion ! Mon avocat m'interdit formellement de le
recevoir bien sûr. Je suis prisonnier sur parole, je
n'ai pas à faire de conférences... ce ne serait pas long
le retour à Fresnes !... Bref, ce futé téméraire va
rentrer bredouille, il va être furieux. C'est pour son
pied ! De là à me recouvrir d'autres baves, d'autres
bouses, d'autres conneries sensationnelles... je m'y
attends !...
Ton pote
Le " futé téméraire ", comme
Céline m'appelait assez drôlement, n'était pas
rentré bredouille. Mon article parut la semaine suivante
dans Samedi-Soir avec ce titre : " Nourri
d'avoine dans un grenier de Copenhague, Céline jure de
torcher l'avorton Sartre. " Il devait faire quelque
bruit...
Céline eut connaissance de mon article et fut surpris de mon objectivité.
" Tout considéré, il est excellent ", écrivit-il à Paraz.
Cependant, il n'avait pas renoncer à " dérouiller "
Sartre et il finit par écrire un texte féroce, dédié " à
l'agité du bocal " - qu'il annonça en ces termes à Paraz
:
Une fessée pour Sartre
est là toute prête, mais il me faut l'accord de Naud à
Paris et de mon avocat ici, je la crois assez bien venue
cette fessée. Croustillante. Mais j'ai déjà terriblement
payé pour le brio.
Paraz devait finalement publier ce
texte en appendice de son livre Le Gala des vaches.
(Jacques Robert, Mon après-guerre, Julliard, 1969, p.178)
Claude SARRAUTE. Ecrire, c'est
un truc qui vous tue le bonhomme...
On était difficilement admis
dans ce pavillon Louis-Philippe tout de guingois sur la
pente du bas-Meudon où Louis-Ferdinand Céline vivait
retiré depuis son retour de Copenhague. Avec son
perroquet, sa pie et ses chiens, des molosses chargés
d'effrayer les importuns, de décourager les curieux, de
ne laisser passer que les fidèles, les amis, les
admirateurs impénitents de cet enterré vivant. Et des
élèves de sa femme Lucette-Lili, la compagne des mauvais
jours, qui a installé au premier étage son studio de
danse. amis, les
admirateurs impénitents de cet enterré vivant. Et des
élèves de sa femme Lucette-Lili, la compagne des mauvais
jours, qui a installé au premier étage son studio de
danse.
Guidée par les instructions qu'elle me lançait de sa fenêtre, je pénétrai
seule il y a un an passé dans la pièce où Céline, trop
fatigué pour venir à mes devants, se préparait en
fulminant au supplice de l'interview. Pièce à vivre,
capharnaüm encombré
de meubles nécessaires : divans, tables, coussins. Dans
un coin la cage de Coco, dans l'autre le plateau du
petit-déjeuner : " Je n'ai rien à bouffer ".
Bardamu ne quitte déjà plus ou presque plus son fauteuil
: " Je vais crever. Je suis un grand malade, moi
madame, gazé à 80 pour cent. "
Dans ce corps, dans ce visage
d'anachorète raviné, blanchi, le regard est resté
fulgurant. Regard où se mêlent méfiance, agacement et
fureur. Il faudra oser lui parler de son
œuvre pour que ce regard
s'apprivoise, se détende, qu'il y passe l'expression
rassérénée de qui sent qu'il " peut y aller ".
Louis-Ferdinand Céline avait naturellement - dans le verbe comme dans ses
écrits - le ton torrentiel, flot douloureusement
tumultueux charriant la rancœur,
le dépit, la rage, le dégoût et une sorte de lucidité
tranchante dans l'humour. Le tout destiné à divertir la
galerie...
Car Céline n'est pas dupe de lui-même. Il y avait des mots-clés :
Stalingrad, la civilisation blanche, les juifs,
Gallimard, Sartre, l'Académie, la pêche à la ligne, qui
appelaient immédiatement le couplet. Et, le numéro
terminé, la rêverie reprenait son cours momentanément
assagi pour parler de lui-même et de ce sacré besoin
d'écrire : " Ecrire comme je le fais, ça n'a l'air de
rien... mais c'est d'une difficulté qu'on imagine pas...
c'est horrible... c'est surhumain... c'est un truc qui
vous tue le bonhomme. "
(Claude Sarraute, Le Monde, 5 juillet 1961).
Denise THOMASSEN. Témoignage à
Olivier Rolin.
Mme Thomassen, qui tenait à
l'époque la librairie française de Copenhague,
Badstuestroede, et erre encore, bougonnante et bien
crounie, comme aurait dit Bardamu, dans les rayons
aujourd'hui tenus par sa fille, n'est guère plus tendre
: " Il prétendait qu'il n'avait rien à manger. Je lui
apportais de la viande, du porc. Un jour, je me suis
aperçue que c'était son chien qui la mangeait. Je n'acceptais pas qu'il m'achète des livres,
je les lui donnais. Et bien, quand il est rentré en
France en 1951, il est parti sans dire au revoir ni
merci. Je lui ai écrit, il ne m'a jamais répondu. Il
avait beau m'écrire " ma géniale libraire " du temps où
je pouvais lui rendre des services, pour lui, sans
doute, je n'étais qu'une libraire de province. J'en ai
bien eu un peu d'amertume.
mangeait. Je n'acceptais pas qu'il m'achète des livres,
je les lui donnais. Et bien, quand il est rentré en
France en 1951, il est parti sans dire au revoir ni
merci. Je lui ai écrit, il ne m'a jamais répondu. Il
avait beau m'écrire " ma géniale libraire " du temps où
je pouvais lui rendre des services, pour lui, sans
doute, je n'étais qu'une libraire de province. J'en ai
bien eu un peu d'amertume.
Le moins qu'on puisse dire,
pourtant, est que Mme Thomassen n'éprouve pas de
réticence envers le Céline de Bagatelles... "
Moi, je n'ai jamais pu lire le Voyage... Je le
lui avais dit, d'ailleurs. Il était très en colère. Il
était très fier de ce livre. Ce qui me plaisait,
c'étaient les pamphlets. Je trouvais ça très amusant. "
Eh bien, les choses sont claires. Mme Thomassen en rit
encore, à petits coups secouant ses joues creuses
effondrées autour des chicots disparus, à la manière des
grand-mères de Chaval.
La bonne blague... Assise sur une
chaise au fond sombre du magasin, les larges mains
posées bien à plat sur sa vieille robe noire, l'œil
assez vif quand même, Mme Thomassen ramone sa mémoire :
" Une chose, par exemple, il était grossier comme un
pain d'orge. Il avait remarqué que je détestais les gros
mots, alors il en remettait, j'essayais de rester bien
impassible, il me regardait sous le nez en disant : "
Tiens, elle bronche pas. "
(Propos recueillis et mis en forme par Olivier Rolin, Libération, 25
oct. 1985, dans D'un Céline l'autre, D. Alliot, 2011,
p.901).
Jean-Marie TURPIN-DESTOUCHES.
Seule et unique visite à son grand-père à Meudon.
Jusqu'alors j'avais toujours
évité qu'on connaisse mes liens de parenté avec Céline.
Il fallait que j'arrive à un point de réflexion pour
écrire sur lui sans me planter. [...] Lorsqu'il était en
prison au Danemark, ma mère m'a demandé de lui
écrire. J'avais alors une douzaine d'années. Nous avons
eu une correspondance suivie et très gentille pendant
plusieurs années. Dans mon adolescence, ma mère s'est
toujours débrouillée pour que j'aie accès à tous ses
écrits. J'ai tout lu.
[...] J'étais avec un copain, mais
il était resté dehors. Je suis rentré dans la maison
sans sonner. Je suis tombé directement
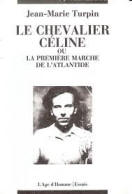 sur
Céline, surpris de me voir. Il n'avait pas beaucoup de
temps pour me recevoir. Il était malade, submergé par la
presse qui s'intéressait de nouveau à lui. Il n'avait
pas envie d'accorder d'interview, il souhaitait terminer
son œuvre. J'ai débarqué
là-dedans ! Il m'a interrogé sur mes études, a été
surpris que j'aie lu son œuvre
et a vérifié mes connaissances en me posant des
questions. L'entretien a été drôle et caustique. Céline
avait un humour fracassant, une ironie féroce. C'était
un grand-père comme je le rêvais. Malheureusement
l'entretien fut bref et il me demanda de revenir le voir
avec le baccalauréat en poche. Il devait mourir quelques
mois après. sur
Céline, surpris de me voir. Il n'avait pas beaucoup de
temps pour me recevoir. Il était malade, submergé par la
presse qui s'intéressait de nouveau à lui. Il n'avait
pas envie d'accorder d'interview, il souhaitait terminer
son œuvre. J'ai débarqué
là-dedans ! Il m'a interrogé sur mes études, a été
surpris que j'aie lu son œuvre
et a vérifié mes connaissances en me posant des
questions. L'entretien a été drôle et caustique. Céline
avait un humour fracassant, une ironie féroce. C'était
un grand-père comme je le rêvais. Malheureusement
l'entretien fut bref et il me demanda de revenir le voir
avec le baccalauréat en poche. Il devait mourir quelques
mois après.
Nous avons une tradition
littéraire dans la famille et j'avais besoin d'écrire ce
livre. Il fallait que je me situe en tant que philosophe
face à tout ce qui se raconte sur Céline. J'avais une
responsabilité morale, je devais dire comment je voyais
les choses. [...] Je voulais rendre justice au grand
Céline de Voyage au bout de la nuit, couper court
aux pamphlets en donnant une sorte de non-lieu, montrer
que l'œuvre se tient, du
Voyage à Rigodon.
Ces pamphlets sont d'abord mal écrits, ils font tâche par rapport à
la qualité littéraire du reste de l'œuvre.
Ma grand-mère et ma mère ont toujours pensé qu'il
avait écrit ça par provocation. Il a fait pas mal de
conneries dans sa vie et cela en fut une de plus. Ses
éditeurs de l'époque souhaitaient quelques écrits
scandaleux qui se vendent, il a répondu à leur désir. Je
ne défends pas Céline, mais il a résumé très bien cela
par un : " J'ai été trop con. " Il a souhaité avant sa
mort que ces écrits ne soient jamais republiés. Je pense
qu'il faut ignorer cette mauvaise littérature et
s'intéresser à l'écrivain du Voyage.
(Propos recueillis et mis en forme par Bertrand Arbogast, L'Echo
républicain, 2 fév. 1995, dans D'un Céline l'autre, D.
Alliot, 2011, p. 964).
Visites de
Pierre VALS, de Montmartre à Copenhague. Grand
reporter-photographe à Paris-Match Pierre VALS
collabora à l'hebdomadaire Nuit et Jour qui
publia en 1947 un article sur Céline au Danemark
illustré de bouleversantes photos dont il était
l'auteur.
J'ai
connu Gen Paul en 1937 à l'occasion d'un reportage
photographique sur le pavillon des vins de France de
l'Exposition internationale. Il était chargé de la
décoration du pavillon. Nous avons sympathisé et par la
suite, tous deux montmartrois, nous nous rencontrions
dans les bistrots de la Butte.
Ce n'est que plus tard, en 1943, que j'ai connu Céline chez Gen Paul. A
cette époque, Montmartre n'était plus Montmartre. Les
touristes avaient disparu. Seuls les soldats allemands
venaient sur la Butte. Montmartre avait perdu sa joie de
vivre. Les habitants de la place du Tertre rasaient les
murs. Les Parisiens manquaient de ravitaillement et de
charbon. Les bistrots de la place n'avaient plus de
clients.
Pour ma part, le journal pour lequel je travaillais avant l'occupation -
Match, un grand magazine d'information, le frère
aîné de l'actuel Paris-Match - s'était replié à
Lyon en zone libre. Son fondateur Jean Prouvost avait
demandé à trois de ses photographes restés à Paris,
Roger Scaal, Jean Moral et moi-même, de réaliser, dans
la mesure de nos possibilités, des reportages sur la vie
des Parisiens sous l'occupation. Nous envoyions nos
documents grâce à des correspondants qui
 passaient
clandestinement la ligne de démarcation. passaient
clandestinement la ligne de démarcation.
Gen Paul -
Gégène pour les intimes - recevait des amis en qui il
avait confiance (il fallait se méfier de la Gestapo), le
dimanche matin dans son atelier au 2 de l'avenue Junot.
Parmi eux : Céline, le dessinateur Soupault, Zavaroni,
un jeune architecte, René Fauchois et moi-même étions
les plus assidus. C'était des discussions très animées.
Soupault disait : " Les politiques, les Allemands,
tout le monde en prend plein la gueule. " Nous
appelions ces réunions " la messe chez Gégène ".
En fait, c'était Céline qui prêchait. Et Gen Paul
servait la messe. Céline discourait dans son langage si
particulier, Gégène approuvait tout en regrettant que
Céline tienne " le crachoir ". " Si on
enregistrait ce mec, disait Gen Paul, on aurait
un bouquin de plus en librairie. " Chaque dimanche,
Ferdinand demandait qu'il y ait un invité surprise,
quelqu'un qui avait vécu une aventure étonnante, en
langage célinien " un branque " qui dise des
choses vraies, mais aussi des conneries. C'était
quelquefois un ouvrier du travail obligatoire en
Allemagne, un spécialiste du marché noir, ce marchand de
vin qui vendait aux Allemands une affreuse piquette
qu'il appelait " pommero " en changeant les
étiquettes.
L'invité le plus pittoresque, ce fut le petit homme qui ressemblait
au " Topaze " de Marcel Pagnol qui a réussi à
vendre à l'état-major allemand qui manquait de bois de
chauffage, cinq hectares de la forêt de Fontainebleau.
Il a falsifié le cadastre, fait un piquetage en forêt
sur la parcelle avec des pancartes " Propriété privée
". Il s'est fait passer pour le propriétaire après la
visite sur place des acheteurs. Il les a traité
royalement dans une auberge du " marché noir "
des environs, muni d'un confortable chèque en acompte.
Il a disparu après nous avoir raconté son exploit et le
bois n'a jamais été livré.
Après ces
réunions dominicales, Céline rentrait chez lui rue
Girardon. Nous allions, Gen Paul, Zavaroni et Soupault,
à la recherche d'un steak-frites, denrée très rare à
Montmartre, avant de nous séparer. Gen Paul, imitant
Céline, nous demandait de ne pas oublier un " connard
" pour le dimanche suivant.
Céline n'avait pas que des amis sur la Butte et ces réunions du dimanche
intriguaient. On disait qu'un communiste recherché par
la Gestapo assistait aux réunions. En 1943, la vie à
Paris devenait de plus en plus pénible. Nous nous sommes
dispersés. Puis ce fut le débarquement, le départ de
Céline en Allemagne, la libération de Paris. La presse
pensait que Céline était en Espagne. En fait, le journal
Nuit et Jour, crée en 1945, avait son adresse à
Copenhague mais Céline refusait de recevoir des
journalistes. Comme on savait que je le connaissais, je
suis parti pour le Danemark.
Je l'ai retrouvé malade physiquement et moralement dans une modeste
chambre de la banlieue de Copenhague, hanté par la
crainte d'être arrêté s'il rentrait en France. La
première question qu'il m'a posée était : " Est-ce
qu'on s'est battu sur la Butte quand les Allemands sont
partis ? " Je lui ai montré une série de photos que
j'avais prises sur la prise de la Kommandantur, place de
l'Opéra. La deuxième question était : " Comment va
Gégène ? ". Il avait la nostalgie de la Butte et de
ses potes. Le grand fauve agressif de chez Gégène
n'était plus qu'un oiseau blessé.
Nous avons passé une heure ensemble, avec de grands silences. Il
était très fatigué. Il ne dormait que deux ou trois
heures. Il était affalé sur son lit dans une chambre
anonyme. Ma présence lui rappelait les dimanches de la
Butte. Qu'il me pardonne d'avoir pris ces photos
d'un Céline qui n'était plus que l'ombre de celui que
j'avais connu. Pierre VALS.
(BC n°152, mai
1995).
CELINE à GROSROUVRE.
C'était en cette saison des
feuilles mortes en 1959. Je roulais avec ma Triumph dans
le département des Yvelines, et j'étais revenu, quelques
mois plus tôt, de la guerre dite " maintien de l'ordre "
en Afrique du Nord où j'avais été rappelé en 1957, comme
officier de réserve de l'Armée de l'air.
Le gouvernement Guy Mollet avait ainsi cassé mes études au profit de ce
qu'on nous apprit plus tard à ne pas appeler une "
guerre ".
Marcel Aymé n'était pas milliardaire, je l'ai suffisamment côtoyé soit à
Montmartre, rue Paul Féval, puis à son dernier
domicile, rue Norvins, en face de chez Gen Paul que nous
allions voir souvent lorsque le peintre voulait bien
recevoir " les gens de la haute ", disait-il, puis au
Cap Ferret près de Bordeaux, pendant mes vacances, où il
vivait l'été, villa Pouquette, petite maison dans la
pointe du Cap près du quartier modeste " des Pêcheurs ".
Mais, grâce à ses pièces de théâtre, il gagna suffisamment pour s'acheter
une maison à Grosrouvre, " La Voisine ", à quelques
minutes de Montfort-l'Amaury. Il y passait d'heureux
automnes avec sa femme Marie-Antoinette, sa fille
Colette, ses petites-filles Françoise et Isabelle. J'ai
connu là quelques heures fruitées d'automne et de
roboratives amitiés.
 Dans le gazon, sous les grands arbres, une
gentilhommière blanche écoutait les silences de Marcel
Aymé qui ne parlait que par monosyllabes ou même pas du
tout.
Dans le gazon, sous les grands arbres, une
gentilhommière blanche écoutait les silences de Marcel
Aymé qui ne parlait que par monosyllabes ou même pas du
tout.
Ce week-end, je n'avais pas de
rendez-vous avec lui à Grosrouvre. Mais j'arrêtai ma
Triumph et sonnai à la grille. Marcel Aymé m'ouvrit,
accompagné d'un homme en pèlerine et qui s'appuyait sur
une canne. Marcel Aymé me le présenta comme quelqu'un
que j'aurais dû connaître, mais que je n'avais jamais
rencontré, et je n'entendis pas le nom du personnage sur
les lèvres de Marcel Aymé.
Nous marchions sur les feuilles mortes, et j'étais fort gêné, me sentais
involontairement piégé entre Marcel Aymé qui se taisait
et un personnage que je ne connaissais pas de visu.
C'est l'homme à la canne qui
débouta le silence. Il me demanda :
- D'où venez-vous ?
Je croyais qu'il me demandait si, en voiture, je venais de Paris ou
d'ailleurs.
- Je rentre de la guerre d'Afrique du Nord.
- Ah ! Moi, je n'ai jamais été violent, j'ai dénoncé la
violence. Même en 39.
On apporta les apéritifs. Il buvait de l'eau.
D'une voix pâteuse, j'osai lui dire que j'étais peintre.
- Ah ! peintre. Oui, peintre, dit-il. Dans quel style ?
C'est rare, un style. Ce qui m'intéresse, c'est le
style. Moi, je suis lyrique...
- Je peins la guerre. Pas celle que j'ai vécue en
Afrique du Nord. Je peins Les Croix de bois de
Dorgelès.
Il parlait " du nez " avec une
petite voix murmurante. La lippe désabusée. Je ne savais
plus quoi répondre. Je me rappelais ma première
rencontre, de nombreuses années auparavant, avec Marcel
Aymé à Montmartre. Pendant une demi-heure, il me
laissait parler. Et plus je parlais, plus ses paupières
se fermaient comme des persiennes, des jalousies, et son
mince regard presque fermé me transperçait.
Je lui parlais de tout, des poètes, d'Apollinaire et, au hasard, de Max
Jacob, " mort au camp de Drancy en 1944 ", ajoutais-je
pour faire étalage... Et Marcel Aymé, ouvrant ses grands
yeux, prit son dictionnaire en main, ouvrit la page à la
lettre J et me dit : " C'est vrai, c'est bien à Drancy.
- Oui, je peins la Guerre, avais-je dit à
l'inconnu à la canne, qui me répondit :
- La vraie inspiratrice, c'est la mort...
Marcel Aymé ajouta :
- Céline a raison, pour les écrivains comme pour les
peintres.
Je venais d'apprendre que l'homme à la canne s'appelait Louis-Ferdinand
Céline...
Guy VIGNOHT.
(BC n° 201, septembre 1999).
Ole VINDING.
On installa une piste de danse dans
le salon d'été de la petite maison en bordure de la
forêt afin que madame Lucette puisse se maintenir en
forme. Tous les jours elle devait faire ses entrechats
et ses pointes sur le petit plancher, sous la
surveillance de Céline, montre en main, apparemment un
bourreau, sadique. Mais on se trompait. Il ne voulait
pas que la carrière de sa femme fut brisée à cause de
l'exil. Ses nerfs n'auraient pas supporté l'épreuve
supplémentaire d'en être tenu pour responsable.
Elle sautait et se mettait sur la pointe des pieds :
- Une-deux ! Une-deux ! Nom de Dieu et merde !
L'écume aux lèvres, montre toujours en main, il tapait du pied en mesure.
Il n'y avait pas de musique, seul le bruit sourd de ses
pieds à elle sur les planches. Dehors, le soleil
brillait, les oiseaux chantaient, tout était vert et
beau ; la lumière et les senteurs des pommiers entraient
dans la maison, faisant distraction et ignorant ce monde
obscur où elles n'avaient pas place et n'éveillaient
aucune joie.
La nuit ne pouvait pas être assez
longue.
Il souffrait d'insomnie, les douleurs le tourmentaient, les pensées, le
bruit dans sa tête qui, disait-il, lui fendait le crâne
comme une grenade. Maupassant avait utilisé la même
image avec ses migraines et, comme lui, il avait écrit
jusqu'à l'extrême limite de ses forces. A six heures du
soir, les rideaux étaient tirés dans la maison près du
bois, il se couchait et madame Lucette ne devait pas
rester debout ni bouger à cause de son hypersensibilité
au bruit. Elle acceptait cela et chaque soir, alors que
la lumière jouait sur les eaux du Grand Belt, elle
restait parfaitement tranquille, écoutant les voix
joyeuses du clair soir d'été et regardant les poutres
basses où Céline accrochait des feuilles de timbres, des
pense-bêtes, des reçus et des pages écrites, comme des
guirlandes.
- Inhumains nous sommes ! soupira un jour madame Lucette
avec une petite expression comique sur le visage.
- Inhumains nous sommes !
Mais elle l'aimait, elle l'aimait d'une façon surhumaine, et surhumain il
l'était et le devenait lorsqu'on commençait à comprendre
ce qu'il y avait derrière.
Il parlait avec une verve dont je
n'ai rencontré l'égale que chez Jean Renoir. Une
parfaite maîtrise du mot. Il n'y avait pas une nuance
qui ne fût justifiée, pas un trait de savoir qui ne
jetât tous ses feux, pas un mot lancé au passage qui
n'eût une profonde perspective. C'était un miracle que
d'en être témoin.
Mais madame Lucette pouvait parfois s'angoisser quand il avait fini de
parler : elle craignait qu'il y succédât un abominable mal de tête.
mal de tête.
Nous en étions arrivés à cette époque où l'on avait renoncé, en France, à
lui faire un procès, mais cela ne signifiait pas qu'il
voulait rentrer aussitôt chez lui. Il avait appris que
ce serait encore trop risqué. En outre, il se sentait
plus faible que jamais. C'était au cœur
de l'hiver 1949.
Il était terrorisé par sa
constipation chronique, l'attribuant à une insuffisante
sécrétion biliaire, et fit remarquer que depuis quarante
ans il prenait des lavements tous les jours. Il était
médecin et devait savoir ce qu'il faisait. J'objectai
que d'autres médecins m'avaient dit que le gros intestin
ne supportait pas sans dommage les laxatifs, que ses
parois devaient rester imperméables aux substances
toxiques qu'il contient, et que les laxatifs nuisent à
cette imperméabilité. Mais il ne voulut pas le croire. A
la Vestre Faengel, où il avait été détenu, on lui avait
refusé d'appliquer son traitement plus d'une fois par
semaine.
Cependant, dans l'ensemble, il
resta stoïque. Les accusations continuaient à pleuvoir
sur lui, il reçut des lettres de menace, et aussi des
articles de France : tout cela, mis à part les lettres
de Marcel Aymé et de quelques autres fidèles, était fort
déprimant. Mais il pouvait oublier le tout et raconter.
Un humour baroque se fit jour quand il rapporta comment
il avait été " engagé " par la Fondation Rockefeller
pour mener une campagne contre la tuberculose dans les
provinces de France. En fait, il n'avait pas du tout été
engagé, il avait simplement volé l'ordre de mission sur
le bureau d'un personnage important. Cet homme important
avait une chaire professorale et dirigeait l'Ecole
polytechnique. Céline était venu le trouver pour lui
demander de faire des recherches et de se prononcer sur
une invention qu'un de ses amis avait faite. L'ami était
un des protagonistes de Mort à crédit, Courtial
des Pereires, et son invention était une machine à
contrôler les votes durant les élections. Le
directeur-professeur ayant eu à faire dans un autre
bureau, Céline avait remarqué sur sa table une lettre de
la Fondation Rockefeller qui demandait à l'éminent
personnage de bien vouloir aider à trouver des gens
susceptibles de mener à bien la campagne contre la
tuberculose. Céline avait lu le papier sur la table,
c'est-à-dire " à l'envers ", puis l'avait
subtilisé. Il se présenta de la part du grand homme avec
son compagnon, un ancien garçon de café nommé Milon,
chez les Américains. Ils montrèrent les documents et
obtinrent le travail. Céline le garda deux ans, Milon
quatre. Ils allèrent jusque dans les villages les plus
reculés, brandissant la menace de la tuberculose. Milon
faisait sa part de travail rien qu'en répétant
mécaniquement d'une voix saccadée :
" La tuberculose-est-très-dangereuse-il-ne-faut-pas-cracher-par-terre ! "
Et ainsi de suite. C'était comme dans Knock de Jules Romains. Et
Céline s'esclaffait et bavait en étalant des détails
affreux mais irrésistiblement comiques.
Puis, d'un coup, il redevint
sérieux et déclara :
" Je le répète : je n'ai jamais ressenti de vocation littéraire, seulement
une vocation médicale, c'est la vérité vraie. Et j'ai
étudié par mes propres moyens, fait les choses les plus
incroyables pour sauver ma peau - car je n'étais allé
qu'à l'école primaire et n'avais aucun bagage littéraire
ou scientifique ! "
(Ole Vinding, Au bout de la nuit, Capharnaüm et Ed. de la Pince à
linge, traduit du danois par François Marchetti).
Louis-Albert
ZBINDEN Ma
visite à CELINE.
En 1957, Céline sortit
de l'ombre. Rentré du Danemark en 1951, il s'était
installé avec sa femme dans un pavillon de Meudon, aux
portes de Paris, comme s'il avait craint de rentrer dans
la ville. C'était étrange. On le savait là, mais le
silence l'absentait. Des ombres l'enfermaient, des
remugles de prison, de procès, d'exil traînaient après
lui. On le disait malade et déjà, pour beaucoup, perdu
pour la littérature.
C'est alors qu'on annonça brusquement la prochaine publication de
D'un château l'autre. Cela fit le bruit d'une bombe.
Les journalistes furent alertés. On nous promettait un
grand livre. Roger Nimier, qui courait de Paris à
Meudon, s'en portait garant. Il n'avait pas tort.
C'était un grand livre. Céline n'était pas mort. Son
second souffle était même un renouvellement : une prose
moins artiste peut-être, mais plus prenante, allant au
pathétique sans cynisme.
Peu après, on nous informait que Céline consentait à
rencontrer la presse. Je soupçonne Nimier de l'avoir
convaincu d'accepter cette corvée. Aucun journaliste ne
l'escomptait. On nous offrit Céline sur un plateau. Nous
nous précipitâmes.
Un après-midi de juillet, annoncé par Nimier, je pris le chemin de
Meudon, jusqu'à la porte de sa maison , ou plutôt de son
mur. Sur une plaque, on lisait : " Docteur L.-F.
Destouches, de la Faculté de médecine de Paris, de 14 à
17 heures, sauf vendredi ". Et au-dessous, en plus gros
caractères, sur une autre plaque : " Madame Lucie
Almanzor, danse classique et de caractère. "
la porte s'ouvrit. Elle donnait sur un jardin en friche. Des chiens
aboyèrent. La maison était un petit pavillon de banlieue
en pierre grise, comme il y en a tant en Ile-de-France,
avec un peu de verrière sur le côté où l'on entre.
J'avançai avec émotion vers elle. Que de fois, depuis une semaine, n'en
avais-je pas imaginé quel concert m'y attendait : des
voix d'enfants sur un air de piano. C'était la classe de
Madame Almanzor, la femme de l'écrivain.
Pendant tout le temps que je fus avec Céline, sauf celui de
l'enregistrement de notre conversation, pour lequel nous
obtînmes le silence, tomba sur nous cette pluie sonore,
fraîche et joyeuse. Elle contrastait avec le singulier
décor où l'on me fit entrer.
UN BRIC-A-BRAC
Céline était gris et sale. Il
portait sur un corps affaissé un visage marqué de fièvre
et d'angoisse. Ses yeux, alourdis de paupières qu'il
semblait avoir du mal à tenir l evées, étaient comme
délavés et cependant brûlants. Son regard était
difficilement soutenable. C'est pourquoi je m'accrochai
d'abord au décor, avant de lui revenir. evées, étaient comme
délavés et cependant brûlants. Son regard était
difficilement soutenable. C'est pourquoi je m'accrochai
d'abord au décor, avant de lui revenir.
Le bureau de travail de Céline était encombré de livres, de caisses, de
pots, de cartons, d'ustensiles divers, vides ou pleins,
qu'il fallait enjamber pour se mouvoir. C'était un
bric-à-brac, avec des choses poussiéreuses. Un perroquet
trônait sur une pile de vieux journaux.
Comment Céline se retrouvait-il dans ce désordre ? Plus tard, il
m'indiqua ses repaires : des flèches au crayon gras
désignant des liasses tenues par de grosses pinces à
linge : ses manuscrits parmi les chiffons.
Mais Céline s'était mis à parler. Sa voix m'apprivoisa. Toute fêlée
qu'elle fût, elle avait du charme, et les mots qu'il
disait en avaient un autre. Bardamu avait été séducteur.
Il en restait des traces. Une femme m'accompagnait. Il
se mit en frais pour elle.
Son visage, cependant, demeurait douloureux, bien qu'il s'animât. Il
était pâle, mal rasé et au bout de quelques phrases sa
salive moussait sur ses lèvres. Un pull-over sans
couleur enveloppait son corps. Il avait aux pieds de
grandes pantoufles de feutre qu'il faisait traîner en
marchant. On était en été, il était vêtu comme en hiver.
" Je suis frileux ", dit-il. Il était malade. Je ne
devais pas le revoir.
Assis face à face, je mis mon magnétophone en marche et lui posai mes
questions. Il se livra. Allai-je avoir une confession ?
Ce fut un numéro. Céline était plus vrai dans le lyrisme
que dans la sincérité. Je le mis sur les Juifs, il se
défendit ; sur la politique, il attaqua. Il finit par sa
mère, et c'est moi, la gorge nouée, qui ne pouvais plus
dire un mot.
UN MISANTHROPE QUI AIMAIT SE
JUSTIFIER
C'était d'ailleurs inutile. Parti
dans son discours, Céline le poursuivait sans qu'il fût
nécessaire de le relancer, allant seul, chevauchant ses
idées et ses souvenirs, tour à tour accusateur ou
plaidant sa cause. C'était parfois de longues tirades.
Les mots, pressés de jaillir, se bousculaient au passage
de ses dents, parfois des pauses, ou bien des dérapages
de phrases qui finissaient en légers grognements de tête
; rien de commun, en tout cas, avec son langage
littéraire. Céline ne parlait pas comme il écrivait, ce
qui prouvait, s'il eût été encore utile de le démontrer,
que son style parlé était un style écrit et même très
élaboré.
Je me souviens de ses mains, qu'il avait longues. Il leur faisait faire,
en parlant, de grands gestes dans l'air, un peu
saccadés, comme on le voit faire aux vieillards, avant
qu'elles ne retombent, comme de fatigue, sur ses genoux.
Bien plus tard, il serra la mienne. Il y mit une chaleur. On m'assura,
par la suite, qu'il avait apprécié l'entretien. Je n'y
étais pour rien. C'était un bon jour. Je crois avoir su
faire ce qu'il fallait surtout faire : écouter, et lui
donner l'impression d'être compris. Ce misanthrope
aimait qu'on lui fournît l'occasion de se justifier.
Quand je redescendis vers Paris, le soleil m'avait précédé et la ville
était déjà dans le bleu du soir.
(BC n°192, nov.
1998).
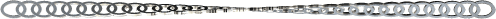
|